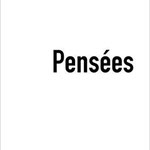D'Agata au BAL

Anticorps d’Antoine d’Agata
Exposition de photos au BAL jusqu’au 14 avril 2013. (Impasse de la Défense, 75018)
Le plus simple est d’aller droit à la conclusion : c’est une des plus belles expositions et une des plus fortes que j’ai jamais vue. Voilà. On pourrait dire qu’ayant dit cela, il n’y a plus rien à dire ! On rembobine et on recommence, en commençant par le commencement.
Le BAL semble avoir décidé d’une politique de programmation d’exception, celle qui présente le travail d’Antoine d’Agata en est une nouvelle illustration.
« Présentation de Travail » ? Le mot est inapproprié. On devrait évoquer un voyage initiatique, une plongée vers un « autre monde », une démarche qui part de l’extérieur et mène vers l’intérieur, des corps, des lieux et des temps.
Le lieu qu’offre le BAL pour ses expositions comporte un rez-de-chaussée (aveugle) et un sous-sol (idem) auquel on accède par un long escalier. La salle au sous-sol est d’une taille impressionnante et dispose d’une hauteur sous plafond très inhabituelle pour des lieux d’exposition « souterrains ». L’exposition elle-même se répartit en deux temps, qui correspondent aux deux niveaux du « lieu ».
Premier Niveau : rien. Pas une œuvre n’est présentée. Pas une photo. Pas même un petit négatif. C’est rare pour un artiste de ne pas se saisir de l’espace qu’on lui offre même s’il décide de présenter une œuvre à la dimension d’un timbre-poste sur un pan de mur de 100 m2! Ou bien, ce rien, c’est autre chose. Avant d’entreprendre le« voyage vers l’autre monde », un avertissement en forme d’introduction.
Dans cette grande salle blanche, un écran de télé. Il est noir. Sauf le sous-titrage d’une parole qui se déploie dans le sombre de l’écran. Une voix de femme parle sans passion, sans flamme. L’écran reprend et traduit ses propos. Discours monocorde et terne, ainsi qu’une voix de l’intérieur qui se fraierait un chemin, lentement, vers ceux qui écoutent et qui ne voient pas. Vers ceux qui n’ont pas envie d’entendre et encore moins de voir. Rien à voir dans cette salle sauf un écran noir d’où sort la voix. Voix cachée ou part audible d’une personne qu’on ne peut voir. Qui ne veut pas ? Que la caméra, l’appareil ne pourraient pas extraire du sombre de l’écran ? Celui-ci ne serait donc pas vide. Mais noir d’une obscurité qui le remplit et porte cette voix. Dans le noir de l’écran, elle serait la voix de tous ceux, toutes celles qui sont en bas, au sous-sol, qui ne diront rien. On ne photographie pas les voix.
Issues de l’écran noir. Voix de prostituée qui parle des hommes, de leurs désirs, de la souffrance d’être un homme à la recherche d’un désir à combler, de la souffrance d’être une femme, le lieu, le fond, la béance où ce désir voudrait, veut être reçu, forcer le passage. Voix de prostituée qui n’est rien dans le regard des hommes et tout dans leur désir… long prologue qui ne dit pas seulement l’horreur des « bas-fonds » mais aussi le couple animal né d’un amour dégradé en miasme et en soubresauts, couples humains qui ne cherchent que des miettes, quitte à les mendier, quitte à les arracher, quitte aussi à tuer après consommation. Long prologue, d’une voix monocorde venant d’un univers poisseux pour déboucher dans un lieu immaculé. Transition blanche, avant transfert. Sur un côté de ce niveau de non-exposition et de non-voir sont installées des piles de photocopies, reproduction de trois photographies emblématiques du travail d’Antoine d’Agata et des textes qu’il a écrits, noirs sur fond rouge. Les photos on les reverra en bas. Les piles de copies, sont-elles là pour que nous allions annoncer : « passant va dire à Babylone, qui nous perd, que nous mourrons pour obéir à ses lois ».
Le deuxième niveau, le sous-sol est-il une crypte ? Un lieu de religion antique, secret, couvert de haut en bas, comme dans les églises romanes, comme dans les sanctuaires byzantins, sans qu’un centimètre carré de paroi soit libre ?
Couvert de photos, composition avec des photos, accumulation, successions. Couvert de moments-avant et de moments-après, les fresques on le sait, introduisent le temps de l’homme et s’efforcent de l’inscrire dans l’éternité du divin ou de l’enfer. La mise en page des parois conduit ainsi à se demander si l’œuvre qu’on veut montrer, est constituée des dizaines, des centaines de photos exposées ? Ou si l’œuvre voulue est l’ensemble lui-même dont les composants ont été recherchés et choisis, des années durant, dans le dessein d’un grand œuvre. On ne pourrait y accéder qu’après avoir entendu ce qu’on ne peut pas voir, sachant que, dévoilées, on ne peut plus les entendre.
Les deux vont de pair, l’ensemble et les composants. Le dit et l’indicible. Le visible et l’insoutenable. L’ensemble constitué par toutes ces photos parle différemment de chaque photo prise à part ou de chaque sous-ensemble de photos. Car, c’est la force de l’œuvre qu’il tienne par une combinaison complexe de sous-ensembles, de tissages qui les relient les uns aux autres, de briques posées pour bâtir, de bâtiment en ruines et de constructions en quête d’une âme, de correspondances par-delà les continents, les temps et les êtres. L’ensemble, ainsi articulé, sur toute la surface du lieu, impulse puissamment le sentiment que l’œuvre s’inscrit dans un temps qui se déroule et, dans le même moment, affiche une universalité où le déploiement du temps n’a pas de sens. Il est dit ici que ce qui est à un bout de l’univers à un moment donné est le même à l’autre bout, dix ans avant, ou dix ans après. Les femmes combustibles, jetées comme aliment à la dévoration, aux passions-pulsions, se ressemblent toutes en toutes positions, en toute souffrances. Il est dit qu’au fond de notre être, sans qu’un devoir de mémoire ait à les convoquer, toutes ces images, de tous temps, sont là, intimes compagnes de l’Homme dans ses basses œuvres. Est-ce en ce sens qu’il faut comprendre le titre de l’exposition : « Anticorps » ? Tous les éléments rassemblés dans cette salle unique, comme sont rassemblés dans notre esprit et notre corps, les peurs, les angoisses et les hontes, seraient alors les mêmes que ces particules biologiques destinées à défendre les corps contre toutes attaques et intrusions, mais, qui dévoyées, devenues folles peuvent aussi dévorer ce qu’elles devaient défendre. Photos « anticorps » qui parlent des corps que consomment des corps.
Au-delà de l’ensemble, ses parties. Pourquoi ne pas cheminer le long des panneaux exposés, partant de la gauche en rentrant pour revenir sur la droite. Ou l’inverse. Rien n’impose ce parcours. On peut tout aussi bien, aller ici et là, commençant par un mur pour aller à son opposé. Rien donc, n’oblige à introduire le temps dans l’œuvre par le moyen d’un déplacement. Tout cependant rappelle que dans l’œuvre et les éléments qui le composent, le temps se déploie, et conduit à la surface de la conscience, la possibilité des négations, des destructions et des anéantissements. Il est vrai que le temps en vient à s’autodétruire après avoir fait surgir le néant depuis le fond, les fissures et les béances. Auto-destruction, anticorps… les lieux s’annulent dans leurs diversités. Les accumulations de photos montrent que le même est partout, en tous temps. Les bordels de Madrid sont les mêmes que ceux de Siem Rap ou de Mexico. Même couleurs, même corps disloqués, quelques soient les années, quelques soient les lieux.
Aux lieux de l’intérieur, aux chambres multicolores des bordels de Bangkok, viennent s’opposer les murs de l’extérieur, photos des lieux nouveaux ou de villes anciennes. Le temps du bâtir précède-t-il celui du détruire ? D’Agata sait rendre les villes et leurs différents états. Depuis, Tbilissi où la destruction est en bon ordre de marche car, dans certaines parties du monde, on ne casse pas n’importe comment. Ailleurs, à Groningen, des constructions en bon état de marche, méthodiquement, proprement construites. Deux temps du monde, deux temps de la ville. Les villes neuves et propres auraient moins d’âmes que les villes construites ou vieilles, abandonnées : Alexandrie contrepoint de Groningen ou de Marseille. Opposition de la ville tremblée et de ses façades couturées et ridées à la ville ferme et solide sur ses pieds, froide, propre et nette à l’extérieur.
A l’intérieur des villes et des maisons, au bout des chemins dans les champs ou à l’orée des bourgades et des grands ensembles trouvera-t-on des chambres de bordels aux lits colorés, couverts de charmantes couvertures ? Ou des prisons, cellules vides de Tripoli, peintes en gris Trianon, comme en rêvent les décorateurs modernes ? A l’intérieur, partout, mêmes formes, même monstres ou bêtes rugissantes, gémissantes, qu’on n’entend pas, corps agités de tous leurs huit, douze, seize membres. Mais il est aussi des corps allongés, seuls et nimbés de clarté inattendue, écartant le sombre et le noir. Sont-ils des corps en repos ou des corps offerts ? Des corps étalés comme il y a de la viande sur les étals ? Ou les restes abandonnés des corps consommés? Corps Kleenex, amours à jeter. Il ne reste rien. Le temps est mort d’avoir servi à extraire de l’écran ce qu’il ne donnait pas à voir.
Il faut cheminer, tout au long de ce long parcours qui traverse le temps pour se retrouver, aujourd’hui, à chaque instant. Il faut aller de ces séries de photos d’identité, au format de carte postale, à ces très grandes photos, rouges, noires, orange qui subliment les femmes dans l’amour qui les défait. Au sein de ce concert sauvage et de ses accents dissonants, les grandes photos de d’Agata confèrent relief et tonalité. Points d’orgues dans le flot sourd des photos de petites et de taille moyenne sans cesse répétées, photos d’identité sur le net ou ramassées à Tripoli, ou photos de femmes sans sourire, photos-planche contact du « sex » en train d’être consommé, qui s’accumulent. Autant de phrases musicales qui se succèdent en lourdes vagues et rythmées par ces grandes formes, battements monstrueux en hurlements inaudibles, qui les entourent et les portent à notre conscience.
Musique de fonds, basses continues, grandes phrases musicales sans relief, les hommes que d’Agata représente, ouvriers, ou anonymes sont, sans formes, sans personnalité, vus de dos et presqu’immobiles. Ils sont dehors. Ils ne sont pas encore dedans. Ils ne donnent rien à voir que leurs dos effondrés avant qu’ils se vident de tout.
Il faut regarder attentivement les photos prises dans les Vosges. Le monde est dangereux et dur, partout.
Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau