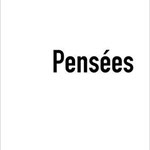Soliloques sur le Vaste Monde: Juillet 14
- Moi-Président: mourir en sous-préfet
- Landesbanken, el'agujero negro' del sector financiero alemàn
- Retraites: est-ce la Bérézina ou Madoff à la manoeuvre
- Les banksters sont parmi nous
Moi-Président : vivre en sous-préfet ?
On ne l’a su que bien après… Moi-Président avait été retrouvé, errant, hagard, dans un cimetière, auprès d’une tombe ouverte. Il tenait serré dans ses bras un linge blanc sale. Il faisait des moulinets pour chasser l’œil qui avait quitté la tombe et qui le regardait sans pudeur.
Non, ce n’est pas ainsi qu’il faut commencer. Une information ne prend de sens véritable qu’après en avoir exposé les tenants et les aboutissants. Procéder à l’inverse, ce n’est plus informer, c’est dicter, imposer, décréter.
Moi-Président, si on avait voulu le comparer à un héros de la littérature, aurait sûrement choisi Flambeau. On ne dit pas assez combien l’esprit contemporain français est encore imprégné des accents lyrico-grandiloquents d’Edmond Rostand. Combien de Français n’aspirent-ils pas encore à la geste de Cyrano de Bergerac et surtout à son accompagnement par le verbe ? Entre les tirs ciblés des drones américains et les cavalcades des blindés légers des légionnaires français, qui ira défendre la guerre planquée, la guerre « jeu vidéo », celle des pleutres d’une certaine façon, la guerre sans soldats, la guerre sans guerre ?
Moi-Président était trop près du peuple de France pour se rêver Murat à la tête de ses hussards ou Kleber ou Hoche, purs généraux issus de l’ascenseur social de la République : jeunes espoirs de la levée en masse qui montaient au rythme où la lame de l’échafaud descendait. C’est bien au soldat de base, à l’homme des tranchées, au grenadier de la Garde, à Flambeau en d’autres termes, le vrai héros de l’Aiglon, le peuple tel qu’en lui-même représenté, celui des « sans-grades », celui « des obscurs » que Moi-Président rêvait dans certains moments, rares, de détente. Il avait avec Flambeau beaucoup de choses en commun. Lui aussi était « petit » et comme Flambeau, il marchait « sans espoir de duché ». Ces rêves lui venaient lorsqu’il était enfin libéré du monde, de ses attentions, de ses diatribes violentes et des pressions incessantes. Dans ces moments, il pouvait se penser autrement qu’en mannequin perché en haut des marches de l’Elysée, attendant tel ou tel personnage important ou,coupé à moitié, comme Président-tronc des allocutions télévisées,
Moi-Président n’avait pas voulu du pouvoir pour le pouvoir, pour la frime, la montre, les passions qu’il déchaîne. Très tôt il en avait perçu l’aridité mentale et les effondrements affectifs. Il avait vu à quel point le pouvoir rend fou. Pas seulement ceux qui en détiennent les manettes, mais surtout ceux qui veulent si passionnément se tenir au plus près des boutons nucléaires, des oukases qui tuent, des écoutes qu’on ordonne et des « rouges » qu’on distribue. Lui en savait la vanité. Il avait parfois le sentiment qu’il était bien le seul. Les femmes, avait-il observé, sont bien les premières à rechercher la proximité du pouvoir ! Lui qui n’était somme toute qu’un bonhomme de taille moyenne et de tour de taille plus que moyen, lui qui, dans une comédie de Molière aurait été un bourgeois gentilhomme accompli et non pas un Léandre, ni surtout un Don Juan, lui qui, par la grâce d’une éducation stricte avait mis l’idéal féminin au plus haut, se découvrait au milieu de manœuvres de séduction, de parades nuptiales et de démarches langoureuses les plus débridées.
Moi-Président avait été prévenu. On lui avait dit combien ces appétits avaient troublé les têtes les mieux arrimées. On lui avait raconté des réunions internationales les plus graves interrompues par le désir irrépressible de telle ou telle conquérante, et même, cela est arrivé, de plusieurs en même temps. On lui avait rappelé que ce sujet avait conduit de grands serviteurs de l’Etat à sermonner vigoureusement leurs princes, quitte à user d’arguments extrêmes : « …si la crainte de Dieu ne vous éloigne du commerce des femmes, craignez du moins s’y perdre votre santé ». Moi-président avait bien compris le message et s’était résolu : il ne connaîtrait que le rude appel au combat, comme Flambeau quand il se levait et avançait au son du clairon ; il n’aurait qu’un seul amour, une seule passion, une seule épouse et ce serait la France.
Moi-Président les avaient donc toutes écartées pour ne se consacrer qu’à une seule, la France, l’Epouse ultime, la Femme absolue. Les contraintes qui ne pèsent pas ne valent pas grand-chose ; or Moi-Président était comme le vin chaud même s’il savait faire montre de sang-froid. Il ne portait cependant rien qui, comme une chemise de cilice, eût pu laisser penser à quelques méchantes techniques de contraintes par corps. Il portait des talonnettes ? C’est que la France était grande. Il portait des lunettes ? C’est qu’il avait la vue basse ! Son langage était hésitant, voire bredouillant ? C’est que s’adressant aux fils de la France, l’émotion poignait. A l’instar de Saint Jérôme, les tentations lui venaient en de lascives créatures ? Il les repoussait, confiant dans cette belle et unique relation avec une belle et unique amante.
Moi-Président rayonnait. Qui n’aurait pas brillé de mille feux dans pareilles situations ? Il aurait bien pu, calquant le Cantique des Cantiques et encensant l’Aimée, lui chanter : «Nous te ferons des pendants d’or et des globules d’argent ». « Il aurait bien pu !!!… ». Formule étrange que ce conditionnel, car, Moi-Président ne savait pas exprimer des souhaits et des possibilités. Quand il énonçait « des lendemains » en rose, il voyait des « aujourd’hui ». Il ne promettait pas que le grain se multiplierait et avec lui le travail des laboureurs, il annonçait au travailleur français que la récolte était déjà là, dans les greniers, avant même que les semailles fussent achevées. Lorsqu’il venait à ses oreilles que le front des enfants de France se rembrunissait, il se portait en avant, sur les ondes, afin que craintes et soucis s’effacent sous le vent chaud et brûlant de son discours amoureux.
Moi-Président présidait sans l’ombre d’un doute et, fidèle à son aimée, lançait ici et là son bon regard à la vigueur un peu émoussée par des paupières plongeantes. Ses proches avaient tenté d’attirer son attention sur la gêne que ces replis protecteurs pourraient occasionner. « Son regard obscurci, lui épargnait la vigueur du soleil, mais lui faisait rater la froideur de l’opinion ». Ils n’avaient pas encore osé le lui dire. La France, épouse exigeante, n’écoutait plus les paraphrases du Cantique des Cantiques. La France s’écartait insensiblement de lui. La France, peut-être, pourrait se donner à d’autres. « Il n’aurait pas voulu entendre » a-t-on dit plus tard. Il aurait pensé à de souterraines jalousies, aux femmes qui lui parlaient trop de la vivacité de son intelligence, de la délicatesse des fossettes au-dessus de sa bouche et surtout, surtout, de ces paupières dégringolantes qui donnaient à s’attendrir « quand même on sentait une poigne de fer » comme elles savaient lui faire croire. Moi-Président dormait toujours du sommeil du Juste, de celui qui ne doute pas de lui-même ni, et surtout pas, de la passion pour la France qui le vivifiait. Certains sont dévorés par des amours absolus, d’autres, comme lui, y trouvent la fontaine qui revigore.
Mais, cette nuit-là, Moi-Président ne dort pas bien. Il rêve. En fait de rêve, c’est un cauchemar. La France, sa bien-aimée, est vêtue de noir. Sans raison, car, à la connaissance de Moi-Président, la France n’est pas en deuil. La France, auparavant si forte, est amaigrie. La France au teint de lait, parait sortir d’une cave où on l’aurait tenue très longtemps. Dans ce songe, la France, fière encore, marchedevant elle et ouvre la porte d’un cimetière. Moi-Président sent à présent sur son cou une froide pression et une humeur glacée tout le long de son dos. Il suit la France (le contraire eût été étonnant de la part de pareil amant !). Elle s’est approchée d’une tombe ouverte dans laquelle un cercueil l’attend. Un linceul d’un blanc douteux est déposé au côté de la tombe. Les Parques sont là, avec leur ciseau. Un seul geste suffit. La France est maintenant dans la tombe sous les yeux de Moi-Président épouvanté.
Comme l’eau d’un torrent nourri de tempêtes, l’émotion qui déferle détruit tout sur son passage. Le sang-froid se glace et la raison s’évanouit. Moi-Président qui s’est précipité sur le corps chéri recule maintenant d’effroi. Un œil sort de la tombe et le regarde sombre et haineux. Moi-Président voudrait sortir de ce sommeil torturé. Il sent à ses basques, les Erinyes qui le retiennent. Un voile noir tombe sur ses yeux. Un revolver s’est trouvé dans sa main. Un coup de feu éclate qui fait voltiger la cervelle dans les airs.
Contre toute attente, il lui reste encore deux sous de conscience pour apercevoir la France redevenue vigoureuse sortir de la tombe, écarter l’œil qui fixe Moi-Président et, guillerette, quitter le cimetière.
Moi-Président s’est réveillé tout à coup. Dans le lointain, il entend la France qui chantonne sur un air adapté du Général Boulanger : «il est mort, comme il avait vécu : en sous-préfet».
Landesbanken, el'agujero negro' del sector financiero alemàn

Il est toujours agréable d'être cité. Et plus encore quand la citation est le fait d'une revue économique étrangère. Voici un article "hispanisant" où "Ordonneau" est cité et nommé à plusieurs reprises. Je ne peux pas laisser passer cet article, pensant au plaisir qu'y trouveront les hispanisants parmi les lecteurs de ce site.
| Lunes, 20 de Mayo de 2013
Landesbanken, el 'agujero negro' del sector financiero alemán
No se sabe cómo de mal están los bancos regionales alemanes: “No tienen el hábito de explicar sus actividades", dice el investigador Martin Hellwig
Rescatar a los bancos alemanes ha costado cerca de 70.000 millones de euros a los contribuyentes germanos. Semejante salvamento ha llevado a que grandes instituciones financieras dependan de un Estado que no dudó en socorrerlas durante la crisis de 2008. De entre ellas, probablemente las más frágiles sean los Landesbanken, bancos de los Länder que en la década pasada cayeron en desgracia tras haber abandonado su carácter regional, en busca de beneficios en un desbocado mercado internacional.
Los Landesbanken componen uno de los tres apoyos sobre los que se sostiene el heterogéneo puzzle bancario alemán. Los otros dos son las cooperativas y, por supuesto, los actores privados, como el Deutsche Bank. A priori, que el mayor de esos bancos regionales, el Landesbank Baden-Wu¨rttemberg (LLBW), haya presentado recientemente beneficios por valor de 398 millones de euros correspondientes al ejercicio 2012 puede interpretarse como un síntoma de buena salud. Pero nada está más lejos de la realidad.
De los seis grandes Landesbanken, cuatro tuvieron que recibir ayudas estatales superar la crisis
De los seis grandes Landesbanken, cuatro tuvieron que recibir ayudas estatales para hacer frente a la crisis financiera. Según recuerda Martin Hellwig, del prestigioso centro de investigación Max Planck para Bienes Colectivos, con sede en Bonn, buena parte de los 70.000 millones de euros empleados en rescatar a bancos en Alemania se han utilizado para salvar a las entidades regionales. “Los Landesbanken son un punto débil para la economía alemana y han resultado muy caros”, mantiene Hellwig, que pone el ejemplo del desaparecido Westdeutsche Landesbank (WestLB): “Sólo ese banco costó a los contribuyentes unos 20.000 millones de euros. Con esa cantidad se habrían podido financiar muchas escuelas”, añade.
Actuando “fuera de sitio”
Los Landesbanken son bancos al servicio de otros bancos, que ponen en ellos su dinero para que rinda. “Tradicionalmente han ofrecido escasos márgenes de beneficio, y dada la falta de negociosos provechosos en Alemania, se fueron de aventuras a los mercados internacionales”, cuenta Hellwig, aludiendo a las millonarias apuestas perdidas por estas entidades debido a la crisis.
“Si no puedes vender un activo tóxico, pásalo a un banco regional alemán”, eso se decía en el sector
Se jugaron sumas faraónicas en las subprime (en referencia a las hipotecas basura) porque tenían abierto el grifo, pero algunos acabaron ahogados tras la bancarrota de Lehman Brothers. Al ser de titularidad pública, los Landesbanken se beneficiaban de “una garantía gubernamental” que les hacía “recoger más fácilmente capital e invertirlo” donde fuera, aunque hubiera “mayor riesgo”, según los términos de Ester Faia, economista y profesora en la Universidad Goethe de Frankfurt. Sin embargo, la tormenta financiera de 2008 puso al descubierto que los Landesbanken estaban actuando “fuera de su sitio”, según Timo Kline, economista de la consultora Global Insight.
Pascal Ordonneau, consultor con 35 años de experiencia en el sector bancario, rememora lo que solía decirse en el mundo de las finanzas sobre los Landesbanken: “Si no puedes vender de ninguna de las maneras un activo tóxico, pásalo a un banco regional alemán”. Ordonneau afirma que “esa boutade muestra que hubo un problema grande en los Landesbanken que residía en su competencia, o más bien, en su falta de competencia”.
Al final, hubo que mantener estos bancos a flote con dinero de los contribuyentes. Así, en el rescate a Bayerische Landesbank (BayernLB), octava institución financiera de Alemania afincada en el Land de Baviera (suroeste), “todo ciudadano bávaro ha pagado 800 euros, incluidos niños y ancianos”, según las cuentas del diputado regional de Los Verdes, Heike Hallistky. En Baviera, viven 12 millones y medio de personas.
Falta de transparencia
“Suele decirse que la crisis de 2008 golpeó de lleno a los Landesbanken. Pero la realidad es que la crisis, sobre todo, ha puesto de relieve lo peor de estos bancos”, constata Ordonneau. Porque más allá de los afectados por la especulación masiva practicada con las subprime, también forman parte de estos bancos NordLandebank y HSH Nordbank, que presentan igualmente una situación preocupante aunque por motivos distintos. Afincados en el norte del país, lo están pasando mal por su elevada exposición a una industria naval de capa caída desde hace un lustro. Lo peor, según Hellwig, es que “no hay atisbos de que esto cambie”. De ahí que “todavía haya cadáveres escondidos en los armarios”, apunta metafóricamente el investigador del Max Planck y profesor en la Universidad de Bonn.
LeerMás
· Que los Landesbanken sigan operando, pese a su precaria circunstancia, también se debe a su falta de transparencia. No se sabe cómo de mal están. “No tienen el hábito de explicar sus actividades ni lo expuestas que están, ni siquiera a la gente que los financia”, señala con sorna Hellwig, aludiendo al hecho que la banca regional germana ha jugado y juega un papel de herramienta financiera de los Länder. Esta circunstancia explica las reticencias de los Gobiernos regionales a la hora de reestructurar más el sector.
Reestructuración necesaria
Quien no parece ver negro el panorama de los bancos regionales es la canciller alemana, Angela Merkel. A rebufo de los resultados en positivo presentados por LLBW, la jefa del Gobierno germano ha señalado que el proceso de “reajuste” vivido en este sector tras la crisis constituía un “buen ejemplo” de reestructuración. No lo cree así Hellwig, quien sigue sospechando que los Landesbanken “serán los primeros candidatos a sufrir nuevos ajustes en el mercado, pues son las instituciones menos rentables”.
Los bancos regionales germanos “serán los primeros candidatos a sufrir nuevos ajustes en el mercado”
La desaparición de WestLB -reducida a Portigon Financial Services-, la adquisición de Sachsen Landesbank por LLBW y la disolución de Landesbank Berlin a manos de la Federación Alemana de Cajas de Ahorros, son los principales cambios registrados en el sector. Pero aún abundan quienes apoyan la idea de profundizar la consolidación operada con las necesidades destapadas en 2008.
Rainer Brüderle, político del Partido Demócrata Liberal, el socio en el Gobierno de la Unión Demócrata Cristiana que lidera Merkel, señaló que “un único Landesbank sería ampliamente suficiente para Alemania”. Dijo esto en 2010, cuando era ministro de Economía. Ahora, Peer Steinbrück, ministro de Finanzas entre 2005 y 2009 y aspirante socialdemócrata a canciller, sostiene que “una mayor consolidación del sector es vital”.
Sin embargo, “la técnica para consolidar estos bancos aún no está establecida”, previene Ordonneau, refiriéndose a algunas de las opciones que barajan el Gobierno alemán y los actores del sector. Se trataría, por ejemplo, de unir todos los Landesbanken en uno o de reducir a la mitad los ocho existentes. “Todos esos planes llevaban una década olvidados en el fondo de un cajón, pero ahora se han recuperado porque los Landesbanken son un problema de verdad”, mantiene el consultor. Él y otros observadores están más seguros de que “la unión de dos brazos rotos nunca suma un órgano sano”, al igual que “de la suma de dos bancos malos no sale uno bueno”.
Retraites : Est-ce la Berezina ou Madoff à la manœuvre ?

Lu dans les Echos : «Si rien ne change, les pensions complémentaires versées aux cadres baisseront de 11 % en 2019 et jusqu’à 14 % sur trois ou quatre ans…»
Vous y pensez ? Vous êtes jeune et vous vous dites que ce n’est pas au dernier moment qu’il faudra s’y résoudre ? Autour de vous, les cigales se multiplient. Pourquoi penser à quelque chose que n’arrivera peut-être jamais : la retraite. N’est-elle pas comme l’horizon, une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu’on avance ? Votre espérance de vie s’accroit. Valide encore à 90 ans ! On ne vous laissera pas partir comme ça ! Jusqu’à la mort vous travaillerez ! La retraite, décidément, ce ne sera pas pour vous ! On peut aussi imaginer que ceux qui l’ont prise un peu trop tôt soient « rincés » de réforme des retraites en réformes des retraites. La retraite ? Demain, vous entendrez peut-être un de vos enfants ou un de vos petits-enfants rire en disant : la retraite c’était quand les exo-squelettes n’existaient pas !
Certains mots sont lestés de sens ambigus, troubles et doubles.
Retraite en fait partie. Songez que faire retraite peut signifier que vous partez chez les bénédictins pour une période de recollection ; mais aussi qu’un soir d’hiver un peu dur, l’ennemi ne se résolvant pas à vous laisser la victoire, vous avez trouvé prudent de rentrer chez vous, quitte à traverser en désordre des rivières gelées sur des ponts de fortune; ou enfin, qu’après une vie bien remplie de sueur et d’effort, vous avez décidé de vous arrêter tout en demeurant payé pour ne rien faire. On remarquera que comparé à l’anglais, le mot français « retraite » est difficile à soutenir. Il n’a pas l’élégance du « retire » un peu aristocratique de nos voisins. Eux se « retirent », ils ne s’enfuient pas. Cette expression va chercher très loin son sens élégant, les Romains (les Empereurs) se retiraient sur l’Aventin, l’aristocratie savaient, en fin de vie, se retirer en ses châteaux.
Le Français « prend sa retraite ». Sur le plan sémantique tout est dit : « il prend » et il en a le droit absolu car ce qu’il prend a toujours été à lui. C’est « sa » retraite. Il n’en demeure pas moins qu’on rencontre une stance étrange dans l’idée « on doit «prendre» sa retraite ». A qui la prend-on ? N’y a-t-il pas là une dérive possible du sens. On « prendrait » sa retraite comme partenaire d’un jeu à somme nul. Ce que je prends en tant que retraite correspondrait à ce que quelqu’un d’autre aurait perdu ! Et si celui-là qui a perdu n’était autre que la collectivité, la nation, la France, quoi ! On voit donc que « retraite » est un mot difficile en tant qu’acte de la vie courante comme en tant que façon de penser. Limitons nous à la définition la plus simple : la retraite, très prosaïquement, c’est continuer à être rémunéré sur la base de ce qu’on ne fait plus.
Pourquoi le mot est-il non seulement ambigu mais aussi difficile à penser ? C’est que prendre sa retraite, n’est que l’exercice d’une liberté fictive. « Prendre » c’est agir et agir est une manifestation de la volonté libre et indépendante. Or, «Prendre sa retraite » revient à se mettre entre les mains d’un Moloch déshumanisé, à abdiquer toute velléité d’indépendance et à mettre à terre toutes prétentions à l’exercice de volonté. Jusque-là, l’employeur, celui qui rémunérait se trouvait dans une sorte d’humaine proximité. On était rémunéré pour ce qu’on avait fait. On pouvait aussi être mieux rémunéré à raison de ce qu’on avait fait de mieux. Et encore : on pouvait ne pas être content pour des tas de raisons, par exemple lorsqu’on pensait n’être pas payé à hauteur de la prestation fournie. Donc, un vrai rapport était posé, pas nécessairement égalitaire mais fondé sur l’idée que les choses et le travail ont un prix, c’est-à-dire sont l’occasion d’un échange : or tout l’homme se tient socialement dans l’échange. L’homme qui prend sa retraite s’écarterait donc de cette vie en société et se soumettant au Moloch perdrait son statut d’homme indépendant et volontaire. On voit que très vite, « retraite » retrouve tout son sens militaire. Ce n’est pas glorieux. C’est pourquoi le retraité n’est pas l’homme heureux qu’on pense. C’est une victime potentielle. Il suffira que de mauvaises pensées traversent la société et voilà que le Moloch s’acharnera sur celui qui pensait prendre « sa » retraite.
Bref retour sur le passé : la créativité des Révolutionnaires français
Pensons à la façon dont la Révolution française s’y est prise pour équilibrer les comptes de la Nation. Rappelons que ce mouvement politique ne se voulait pas sanguinaire. Il était mû par la recherche du BNB (Bonheur national Brut) plus de deux cents ans avant la lettre. En fait, la Révolution avait posé que l’amour ne serait universel et l’entente ne serait possible entre tous les hommes que si des groupes sociaux, dont l’utilité apparente n’était pas claire, les aristocrates et le clergé, acceptaient de revoir en profondeur les modalités de leur contribution au bien-être social. Et c’est en cela que la révolution a été vraiment novatrice : en invitant les gens dont l’efficacité marginale avait beaucoup décru à se sortir du circuit et à rendre les capitaux à des utilisateurs plus efficients. Il y eut des réticences ? Il y eut des « casualties » ? En fait des dommages collatéraux qui ne portaient pas atteinte à l’essentiel.
Et voilà qu’on entend ici et là «et si on faisait la Révolution ?». Les retraités seraient alors comparés aux aristocrates : payés à ne rien faire, exigeant leur dû en s’appuyant sur des titres, autrefois 16 quartiers de noblesse, de nos jours, 40 (max) années de cotisation. Pesant sur l’avenir avec des pensées du passé, ils consomment du capital comme au XIXème siècle on disait qu’ils le croquaient. En termes « XXIème siècle »on dira qu’ils le détruisent alors qu’on en a tant besoin pour financer le remboursement de la dette. Comme les aristocrates, ils vivent dans un monde à part, qui n’est pas la vraie vie, un monde de vacances et de loisir. Ils vont même au Maroc, au Portugal et certains s’en vont au loin dans le vaste monde pour vivre mieux encore pendant que leurs concitoyens souffrent. Ils vivent dans la pure vacuité et s’ennuient comme s’ennuyaient les aristocrates. Ils sont parfois, d’autant plus souvent qu’ils sont plus vieux, installés dans de grandes demeures avec des jardins et des serviteurs en livrée (blanche pour les temps modernes qui ne sont pas tape-à-l’œil) mimant ainsi l’aisance vraie des anciens aristocrates.
Ne faut-il pas les faire revenir au sein de la société ? Ce serait à la fois un service à leur rendre et une rédemption civile. Cela commencerait par l’abandon de ce privilège incroyable, issu de la nuit des temps, le droit, et même le devoir de ne pas travailler : le travail des seniors y trouverait toute sa grandeur. Revenus dans la vraie société. Débarrassés de cette chaine dorée qu’est le paiement de rentes à vie, ne devant plus enfin leur subsistance qu’à leur contribution réelle, ces aristocrates nouveaux mériteraient de la république et ne lui coûteraient plus rien.
Comment se sortir de ce qui ressemble à une farce.
Correspondances douteuses entre un passé heureusement révolu et la France passagèrement en crise ? Nous aurions poussé le bouchon trop loin ? Pas assez à notre avis. Dans un quart de siècle, les seniors pèseront 1 à 1 sur le dos des « autres ». Aujourd’hui, déjà, les comptes des organismes de retraite sont dans le rouge. Difficile de faire face à cette douloureuse question : les seniors représentent un poids électoral de plus en plus lourd. Voici la « donne » individuelle, celle que tout citoyen doit envisager : les retraites reposent sur une certaine « permanence » de la société. Quand elles sont organisées sur le principe de la « répartition », il faudrait que les jeunes (c’est-à-dire les futurs retraités) croient que la société n’a pas l’intention de changer, ni que des circonstances extérieures ne sont susceptibles de la faire changer. Quant à la capitalisation, elle suppose pour bien fonctionner que les retraites soient fondées sur de l’argent investi ailleurs, dans le vaste monde… au risque des choix douteux ou des guerres religieuses.
Il faut s’intéresser aussi à ceux qui ont « pris leur retraite » et s’attendent à passer un heureux quart de siècle à ne rien faire qu’à s’occuper d’eux-mêmes puis de leurs petites maladies avant que de laisser d’autres personnes s’occuper de légumes dans d’étranges jardins. Comment croire qu’ils vont vivre paisiblement ce que les jeunes retraités ne vivront jamais ! Dans la réalité, pour faire en sorte que les régimes de retraite soient au mieux possible équilibrés, leurs retraites seront gelées. Elles ne progresseront plus, même s’il y a de l’inflation. Alors, insensiblement, les mieux lotis n’auront plus à compter que sur des revenus médiocres, les médiocres seront ravalés au rang de pauvres et les pauvres erreront dans les rues.
Comment s’en sortir ? Faire comme les vrais aristocrates, ceux de 1789, Emigrer ? Partir en suisse par exemple ? Ou en Belgique ? Fuir… mais quoi fuir ? Les revenus des retraités dépendent de caisses installées dans la mère patrie. Fuir ne servirait de rien surtout quand on se souvient que la France est le pays le mieux doté en terme de démographie : les autres voient leur population décroître à grande vitesse !!! Plus il y a de vieux, moins il y a de jeunes !!! Alors, comment s’en sortir ? Une seule voie : fabriquer par soi-même les ingrédients utiles à cette fameuse retraite. Investir très tôt et ne pas trop penser aux versements des organismes de retraites. Investir en diversifiant pour éviter d’être prisonnier du Moloch. Investir en mixant le court et le long pour, surtout, ne pas se rendre prisonnier des changements imprévus, des chocs sociaux et économiques venant de partout et de la France aussi.
Décidément, « prendre sa retraite » va devenir obsolète : le vrai sujet sera de vivre quand on ne pourra plus travailler.
Les Banksters sont parmi nous !

Tous les jours des banquiers passent à l’aveu. Tous les jours, une banque, grande ou petite, (grande surtout) se trouve mise à la « une » des journaux : elle a facilité la fraude fiscale, elle a soutenu l’activité commerciale avec des gens que les Américains n’aiment pas, elle a assuré le transit et la compensation des sommes considérables d’argent entre producteurs et commercialisateurs de drogue…. La liste est longue. Les banquiers sont-ils devenus des Banksters ?
C’est pourquoi, en compactant en un seul les deux mots «Bank» et «gangster» on a fait : bankster !
Ne seraient-ils que des malfrats ou des complices de malfrats, passe encore. Ce n’est pas trop nouveau que dans l’esprit du « bon peuple » et dans celui même des personnes informées que sont les Présidents de la République, leurs diverses femmes, les journalistes, les banquiers soient une version civilisée du voleur. Le pire vient lorsqu’en plus, ils perdent de l’argent. Qu’ils le détournent à leur profit, soit ! Mais qu’ils le perdent, ça non ! Le pire vient quand le « bon peuple » et « la veuve de Carpentras » découvrent que les pertes sont provoquées par de jeunes types arrosés au bonus et gratifiés de salaires mirobolants. Trop de bonus mêlés à trop de pertes, c’est « trop » tout court : l’opinion est passée de « méfiant » à « hostile ». On entend ici et là dans les chaumières, dans le neuf-trois et les hôtels particuliers de la bourgeoisie que « Trader » n’est pas convenable et que travailler dans la Banque, ce n’est pas très net. Et dans les dîners en ville, il vaut mieux être chef de guichet à la Caisse d’Epargne que patron d’une équipe d’investment bankers.
Bankster ! Il est rassurant qu’il ait fallu créer un mot nouveau… Le pire aurait été de garder le mot «banquier» et de laisser son sens dériver négativement suivant l’exemple de certains noms de profession : « Promoteur immobilier », « Spéculateur », «Dentistes» ou plus atroce encore « Assureurs » se sont figés dans une image sinistre et irrécupérable.
Il y aurait d’un côté les banquiers qui sont des professionnels responsables et honnêtes, une minorité on l’imagine. Celle-là est esclave des ordinateurs. Quand on lui pose une question, elle fonce pour mettre des croix dans une grille, puis elle attend qu’en crachotant poussivement l’ordinateur réponde que tout est possible s’il y a des garanties et si les revenus du ménage équivalent à trois SMIC. On voit ces banquiers-là à la télévision. Ils sont près de chez tout le monde et ne pensent qu’à une chose : «ma petite entreprise» et «mon livret épargne-sécurité». Ils sourient franchement parce qu’il n’y a rien de trouble dans leur démarche et leurs clients sont heureux parce qu’ils n’ont pas encore perdu leurs dépôts à cause des folies des autres banquiers, les collègues des premiers, qui sont ailleurs, peut-être pas en France, à Londres souvent.
Ce sont les «banksters », ils représentent « le côté obscur de la force ». Les différencier des premiers est néanmoins peu aisé malgré leur perversité. À l’inverse de Darth Vader qui a le costume de l’emploi, les banquiers et les banksters sont habillés pratiquement de la même façon (peut-être les rayures tennis des costumes de banksters sont-elles un peu plus marquées) et ont des cravates identiques (celles des banksters peuvent être un peu plus voyantes). Seules les chaussures ( toujours parfaitement cirées-glacées dans des cuirs tirant sur le vert pomme ou le parme assombri) et les montres (à complication, évidemment) différeraient : on peut aussi relever que les banksters sont souvent équipés de larges bretelles de couleurs vives destinées à maintenir leur pantalon en place même lorsqu’ils perdent leur culotte
Donc, si vous êtes appelé à rencontrer un banquier et si vous voulez vous assurer que ce n’est pas un bankster, regardez ses pompes, sa montre et ses bretelles, non cumulativement.
Aux origines du monde, Banquiers et Banque n’ont jamais été associés à des qualificatifs positifs.
«Une banque c’est un commerçant, qui gagne sa vie avec l’argent comme matière première…sauf que la matière première ne lui appartient pas, c’est l’argent des autres». De là à considérer que Banquier et voleur sont la même chose ou les deux faces d’un même problème, l’argent, il n’y a pas loin. Or, l’argent ce n’est pas bien. La plupart des programmes de nationalisations, de dépossessions ou d’expropriations bancaires, qui sont la version moderne de l’élimination des templiers par Philippe le Bel, même (surtout) lorsqu’ils n’étaient pas désintéressés, se sont appuyés sur des considérations morales. Utiliser ce qui appartient aux autres pour gagner de l’argent et s’en mettre plein les poches n’est pas «juste». C’est même franchement injuste quand on s’aperçoit que, si des pertes apparaissent, ce sont les « autres » (vous et moi) qui vont faire les frais de l’opération!!!! Donc, de prime abord, un banquier est un individu difficilement aimable.
Cette vision négative, fondée sur une sorte de défaut génétique, s’amplifiait traditionnellement à l’occasion de la distribution du crédit et de la prise de risque : «le banquier est un individu qui ne sort jamais sans son parapluie», «on ne prête pas aux hommes et aux projets, donc à l’avenir, mais aux bilans et aux garanties, donc au passé» est un grand classique dans la réprobation générale à l’égard des banquiers. «Quand on n’en a pas besoin, ils nous pourchassent et veulent nos économies, quand on en a besoin, ils nous fuient et nous refusent leurs crédits».
Ces thèmes-là rassurent. Ils sont anciens comme Crésus. Pourtant, ça ne suffit pas pour faire un «Bankster». C’est désagréable de ne pas avoir le «feu vert» de son banquier pour un crédit mais ce n’est pas ça qui conduit à le traiter de « voleur », « gangster » etc…
C’est avec la financiarisation des économies et la mondialisation du marché des capitaux, c’est à dire une sorte de débancarisation, que les banquiers ont conquis leurs galons de Banksters. La crise de 2008, sur fond d’effondrement du système bancaire américain (faillite de Lehman Brothers), suivi de craquements sinistres dans le système anglais et la mise en danger des banques investies dans les « subprimes » (banques allemandes, anglaises, espagnoles), avec pour apothéose, la faillite de la quasi-intégralité des banques irlandaises et islandaises a provoqué un séisme économique considérable avec son cortège de chômage, de diminution du PNB, de pertes des régimes de retraite et des fonds de pension…. Oui, les subprimes, étaient des crédits immobiliers distribués «à la ramasse». Oui, l’effondrement de l’immobilier américain est venu d’une fièvre spéculative soutenue et amplifiée par la distribution trop généreuse de crédits bancaires. Mais, le fond de l’affaire est que ces crédits ont été replacés en forme de produits structurés et revendus à des « investisseurs ». Les Banques, pour tout dire, se sont débarrassées de leurs crédits vaseux et les preneurs qui n’étaient pas banquiers ne se sont pas un instant demandés si on ne leur repassait pas « la patate chaude » ! En vérité, ils ne savaient rien sur les patates et la gastronomie y attachée.
Les affaires Madoff, (qui n’ont rien de bancaire), Lehman Brothers, AIG (qui est une compagnie d’assurance), le Bank run sur la Northern Rock en Angleterre et les Banques grecques, ont mis l’accent sur ce qu’on a qualifié d’arrogance, de folie des grandeurs et d’avidité des banquiers.
La notoriété des banquiers, une cause perdue ?
Les bonus largement distribués, même au plus fort de la crise, à des dirigeants de banques qui n’avaient pas fait montre de prévoyance, ni de capacité à anticiper les évènements, mais aussi à des traders dont quelques éléments provoquaient des pertes comptées en milliards de dollars, ont contribué à rendre la cause des banquiers difficiles à défendre. En 2009, un sondage de la Sofres comportait la question «d'après vous, parmi les catégories suivantes, quelles sont les deux qui portent la plus grande responsabilité dans l'origine de la crise économique et financière mondiale actuelle ?», 58 % des Français répondent d'abord les banques.
Les banquiers dont la réputation a toujours souffert de la nature particulière de leur métier et de sa position dans les rouages des économies, qui créent de l’argent ex-nihilo et ont même su se passer de l’or pour bâtir des fortunes, se voient mis en accusation avec de plus en plus de véhémence. La Commission Européenne, pourtant d’habitude nuancée, en est venue à proposer qu’ «une responsabilité pénale individuelle des acteurs financiers soit enfin reconnue dans le droit européen», pour reprendre les termes du José Emmanuel Barroso, son Président. Ce dernier enfonçait le clou : «Nous avons vu des comportements abusifs sur les marchés, certains ont provoqué la crise actuelle. Nous allons réguler ces pratiques ! Ceux qui les violeront encourront des sanctions pénales. Ce sera une première dans la législation européenne et un signal fort». Après Lehmann, après les banques irlandaises, après la faillite d’HypoRéal, la «découverte» des ravages causés par une nouvelle catégorie de crédits n’a rien arrangé ! Il s’agit des fameux «crédits toxiques» montés au profit de collectivités locales innocentes victimes de l’imagination et de la créativité (nécessairement) diaboliques des banquiers. Après tout ce cortège d’horreurs, voilà que la justice américaine arrive maintenant comme, dans le fils de cow-boys et d’indiens, la Cavalerie Montée, une fois que la bataille a été perdue et la crise bien accrochée.
C’est ce même mouvement d’humeur qui conduit à redonner vigueur à une vieille idée : «la nationalisation totale ou partielle» ! Comme si la présence des Etats et de leurs fonctionnaires à la tête des banques donnait en toute certitude des garanties de sérieux et d’éthique dans leur gestion !
Les Banquiers sont-ils des banksters ? On le pressentiment qu’il leur faudra beaucoup de temps pour revenir au niveau d’hostilité « classique » qui est immanquablement attaché aux métiers de l’argent. Mais fort heureusement le dicton anglais est là pour annoncer des lendemains qui chantent « every cloud has a silver lining »… et surtout, le Président de tous les Français, François II, a lancé un nouveau mot d’ordre : « il y a les bonnes banques et il y a les mauvaises banques. Suivons les bonnes banques ! ».
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau