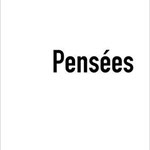Soliloques sur l'Art, Novembre 2017
- Guillaume Zuili, à la galerie Clémentine de la Ferronnière : chronique reprise par Mowwgli
- Eric Pillot, à la galerie Dumonteil
- Thomas Henriot, chez Céline Moine
- Marina Black, chez Vu
- Soccol chez BOA
Guillaume Zuili, chez Clémentine de la Ferronière

Galerie Clémentine de la Ferronière
51 rue Saint Louis en L’île 75004
Cette galerie vaut le déplacement sur le plan architectural : un splendide hôtel particulier, sa cour, tout ceci un peu restauré, les porches bourrés de câbles plus ou moins modernes. L’hôtel a été vampirisé peu après sa construction au XVIII-ème siècle. On oublie trop que nos ancêtres démolissaient les magnifiques constructions d’autrefois pour y poser des choses plus modernes…encore plus magnifiques…
Et puis, il y a une deuxième cour, avec un porche encore plus curieusement bourré de choses qui datent furieusement. Cette deuxième et (ouf !) dernière cour est occupée par des appentis artistement relookés…qui sont une belle illustration de la densification de « l’urbain » parisien (comme dit la mairesse) à des fins commerciales et industrielles de la deuxième moitié du XIXème à la première moitié du XXème. Fermez les bans, ce n’est pas « l’urbain » de la mairesse que je suis venu contempler mais une exposition de photos d’un monsieur Guillaume Zuili dont on m’a chanté les talents.
Et « on » a eu raison.
Il y a là, beaucoup de talent.
Indiquons sans détour que j’ai beaucoup aimé cette exposition et que j’en recommande la visite. Les prix ne sont pas excessifs ce qui n’est pas le moindre intérêt de l’évènement.
La photo en règle générale peut se résumer à « une image mise chimiquement et optiquement sur du papier ou du métal, tout support qu’on veut bien utiliser selon les ressources locales, selon les coûts comparatifs des ingrédients ou selon les foucades et tocades de l’artiste ».
Ici, la matière dominante est le lithium. Bon. Cela prouve qu’il n’y a pas que dans les smartphones et les Tesla qu’on en trouve ! Peu importe !
Les photos de Guillaume Zuili ont proprement une tessiture très personnelle, peut-être due au lithium… la thématique est très « américaine ». Villes sans charme, passants sans personnalité, objets du consumérisme ou de la consommation. Tout ceci en noir et blanc… enfin, pas tout à fait en noir et blanc : une sorte de sépia, pâle qui atténue les excès de contraste entre noir et blanc.
Ce qui vient très vite au regard relève d’une promenade très intérieure. C’est d’ailleurs ce que livrent les tirages, le sépia, le grain des photos et aussi leur format. On n’en parle pas souvent des formats. L’artiste les choisit et de ce fait, ils ne peuvent pas être neutres. Or, tout au long de cette promenade, alternent des formats moyens, de petits et même de très petits formats. Peu de gros tirages qui investissent les murs (on n’est pas chez Helmut Newton…). Pour moi, petit format signifie lecture, appel du regardeur par l’artiste, pour qu’il vienne se rapprocher de la photo, pour lui proposer de ne plus la dominer, de ne plus prendre de ces reculs qui font que le regardeur ne regarde plus mais tance (sévèrement évidemment). Ainsi l’exposition, en alternant les formats, rythme la démarche du regardeur et lui intime de ne pas se distancier mais au contraire de mettre ses pas dans les pas du photographe et ses yeux dans son regard.
Il faut alors aller et venir et ne pas se laisser trop impressionner par les halos de lumière en poussières qui troublent le regard et donnent parfois à voir des paysages ou des personnages qui se vaporisent ou mutent en nuages ; en s’éloignant de la photo, des lignes force remplacent le brouillard ; les subtils évanouissements de constructions ou d’objets deviennent des formes solidement campées. C’est en ce sens qu’il y a promenade, rien n’est donné d’un point de vue, ni celui de la lecture des petits formats, ni celui qui fait que tout disparaît à être regardé de près, ni celui qui, grâce à la distance rend aux formes leur solidité et leurs angles nets et aigus.
C’est ainsi qu’entre quelques tempêtes de lumière qui paraissent emporter une automobile, un personnage marchant sur un pavement rythmé de bandes claires et une silhouette féminine au bord de l’effacement, des formes simples trouvent leurs places. Ce sont comme des signaux que le hasard a laissé s’accrocher aux murs, c’est un homme vu de dos qui se déplace tout au long d’une leçon de perspective, c’est la trace que vient de laisser le soleil en projetant sur une rue, l’ombre d’un support publicitaire ou d’un portail commercial, ce sont aussi ces mille raies qui courbent l’espace d’une plage ou d’un jardin.
Très belles photos où mélancolie et douceur l’emportent. C’est vraiment une promenade pour soi-même que Guillaume Zuili a construite, avec des signaux, des impressions et des images qu’on s’attend à voir disparaître comme s’effacent un rêve ou un souvenir.
Eric Pillot, à la galerie Dumonteil

Je devais retrouver une galerie qu’on m’avait recommandée. Pas de chance : introuvable. La cherchant (j’avais oublié l’adresse et retenu le seul nom de la rue de l’Université), je tombai par hasard sur la galerie Dumonteil (38 rue de l’Université ) qui, présente un travail photographique fort attirant. C’est là, bien sûr ! Je pensais avoir trouvé la galerie recommandée… ce n’était pas celle-là. C’en était une autre (si ce n’est toi…) qui présente le travail d’Eric Pillot.
Eric Pillot serait venu récemment à la photo. Avant, polytechnicien, « il avait fait ingénieur ». C’est en tout cas ce qu’on m’a aimablement expliqué dans la galerie Dumonteil. Les photos exposées sont magnifiques. Et, étrangement, elles font partie de ces photos qui provoquent un pur questionnement technique tant elles ont de similarité avec le dessin. On regarde de très près les très grands formats accrochés aux murs de la galerie pour essayer de débusquer le trait, le crayon ou la plume, puis, il faut bien en venir à consentir que ces « impressions » sont bel et bien des photographies.
Mais avant de les commenter, il faut remarquer qu’elles tranchent déjà avec les travaux antérieurs d’Eric Pillot, animalièro-ironiques, en couleurs, ou bien crues à ce point qu’on a le sentiment que ses photos sont peintes ou bien posées sur les fonds colorés « façon papiers peints » des artistes photographes officiels et portraitistes de quartier.
Et voici que cette nouvelle série est un jeu de noir et de blancs. Encore que …
Le thème : la mer et les terres qui la bordent. La mer et l’air qui l’enveloppent. La mer et l’horizon qui se dissout. Les photographies sont menées jusqu’au plus extrême dépouillement. On ne dit pas la vérité en évoquant des photos « en noir et blanc ». Ce sont des photos en blanc dont les plissements laissent un peu de place aux blancs moins blancs, et ici ou là, à des traces noires, minuscules parfois, des restes de noir, quand le blanc recouvre tout. Ce dépouillement conduit à ce qu’un paysage de mer, classique, où on devrait voir au loin la fameuse ligne d’horizon qui a pour mission de séparer l’eau et l’air, a perdu « sa ligne » comme si elle avait été vaporisée, comme si, des brumes blanches étaient allés affadir les contrastes. Illustration involontaire des derniers moments du fameux roman d’Edgar Poe « Arthur Gordon Pym »?
Il ne faudrait pourtant pas s’en tenir à ce triomphe du blanc dans les images d’Eric Pillot. L’une d’entre elles propose un contraste si violent entre noir et blanc qu’elle semble sortie directement du travail d’un graveur sur bois, un de ces artistes qui extraient le blanc du noir pour lui faire dire des personnages ou des paysages. La mer et le rivage, blanc et noir, sont posés comme en une paisible rivalité. Mouvements du ying et du yang ? ici, les tonalités franches sont clairement opposées.
Photos simples, « réduites à l’essentiel » dira-t-on. Je ne sais pas si l’essentiel est nécessairement là mais cette série de photos offre une belle représentation de ce qu’immanence, sérénité, lenteur étendue de l’instant qui se prolonge veulent dire.
Thomas Henriot, chez Céline Moine

Cela tombe sur mon S-Phone comme ça sans prévenir, trois messages qui se ressemblent tous comme des triplés : ils contiennent une seule et même invitation, « comme suit »
La galerie Céline Moine et la Pijama galerie
ont le plaisir de vous convier à leur première exposition commune
Deux en 1
Dans les 520 m2 de Station
13-15 rue Pont-aux-Choux - 75 003 Pqris
Vernissage le mardi 21 novembre de 16h à 21h30
Exposition du 22 au 26 novembre 2017 de 10h à 20h
Avec Anya BELYAT-GIUNTA / Chloé COISLIER / Jessy DESHAIS
Marc DONIKIAN / Thomas HENRIOT / Akira INUMARU
MUZO / Seung Hwan OH
Je suis justement à deux pas.
Encore un de ces miracles de la technologie : les ordinateurs de la planète savent que j’aime « l’art qui bouge », ils m’ont senti prêt à une rencontre, ils m’ont géo-localisé à deux cents mètres de la rue du Pont aux choux, marchant dans la bonne direction… et ils ont canardé, bombardé, trois messages d’un seul coup. Un seul serait sûrement passé inaperçu, deux n’auraient eu qu’un impact modéré, trois, c’était faire mouche : quand on reçoit trois messages en même temps votre S-Phone se transforme en arbre de Noël et en sirène d’incendie. Donc, j’ai lu le message le plus vite possible. J’étais à deux pas maintenant, il suffisait de tourner à droite, de quitter la rue de Turenne et de trouver l’endroit.
Bien avant l’heure du vernissage, j’arrivai dans un lieu impressionnant par sa taille, nouveau apparemment. Quelques personnes s’affairaient à préparer les petits fours, les jus de fruit et le beaujolais nouveau. Un ou deux visiteurs qui avaient dû être hameçonnés comme moi. Des tas d’œuvres au mur. Des biens et des moins bien. Il y a un étage d’exposition en sous-sol. On l’aperçoit depuis le rez-de-chaussée.
Et là, dans ce sous-sol assez désert, je tombe sur l’incroyable : des œuvres d’un monsieur Thomas Henriot.
Incroyable, impensable, inimaginable : des rouleaux de 10, 15, 25 mètres, les uns complètement déployés, les autres à moitié, dégringolant du plafond, perchés à plus de 5 mètres et déroulés sur le sol en longues bandes de papier de je ne sais quelle sorte, bambou ou coton …
On a beaucoup débattu voici quelques mois du fameux manuscrit en rouleau de « sur la Route » de Kerouac, Thomas Henriot a produit une série de rouleaux, comme des routes spirituelles imagées, d’où sortent aussi bien des paysages, que des personnages, des annonces publicitaires, des copies de journaux et des bouts de cigarettes et d’asphalte.
Tracées au crayon, à l’encre, en lavis, en dessin, en aquarelle ou en traces fines d’encre de chine noire. Parfois, au milieu d’un univers de noir et de blanc, surgissent des couleurs, celles de fleurs, d’autres comme les échantillonnages de tissus, qui viennent scander çà et là un discours sur le monde, sur l’homme, sur la vie.
Thomas Henriot est un peintre de la vie qui passe, qu’on saisit immédiatement, comme on prend une photographie, comme se déroule un film. Peintre de la rue, il travaille comme un artiste du street-art au sens où il est dans la rue, partout où on peut poser un rouleau, une feuille et saisir un moment, une voix, le déroulement d’une histoire. La rue sujet et cadre, mouvements des foules, piétinements et grands espaces où se déroulent (encore !) les scènes de la vie.
Déroulement, déroutement, bande dessinée ou bien pellicule d’un film très lent, dont les images seraient saisissables les unes après les autres. Ce déroulement ne se fait pas à la chinoise quand de grandes histoires sont illustrées, latéralement mais verticalement, comme s’il fallait lire « à l’ancienne » les rouleaux d’une aventure.
Une œuvre passionnante à découvrir très vite.
Marina Black, chez Vu

Marina Black
Galerie Vu, jusqu’au 13 janvier 2018
Parmi les photos exposées par Marina Black à la galerie Vu, l’une met en scène un couple, lui, le visage blanc, comme surexposé ou effacé ; d’elle, il ne reste qu’un œil et surtout un regard. Le reste n’est rien que plongée dans l’obscure, le noir, le sombre ; seules tâches de lumière, des effacements, des visages évanouis.
Une autre photo représente un visage comme coupé en deux, déchiré où la béance créée est maladroitement réparée par des sortes de bandelettes. Elles seraient posées pour empêcher cette béance de s’accroître, pour maintenir les lèvres de la blessure et sauvegarder ce qui peut l’être du visage ainsi mutilé.
Ces deux images : pour dire une impression venue de toutes les images exposées à la Galerie Vu. Derrière l’image, il y aurait quelque chose qu’une fissure fait venir au regard. Une béance, une épaisseur rompant avec la forme bidimensionnelle de la photo. Les visages qui disparaissent sont comme effacés par la lumière, remplacés par une clarté. La déchirure du visage que montre l’autre photo, au contraire fait venir l’obscurité. Il y a bien quelque chose d’autre si on efface ou si on déchire.
L’ensemble des images de Marina Black paraît être tout entier tourné vers la mise en valeur de l’épaisseur, si on veut bien « ouvrir » visages et personnages, mise en valeur de l’effacement, remplacement, substitution qui fait passer les choses et les visages et les remplace par ce qui vient du fonds de l’image.
C’est pourquoi les images sont griffées, traces d’une recherche au couteau ou au ciseau du « beyond the photo » pour paraphraser Lewis Carroll. C’est pourquoi, une fois le travail de recherche de l’épaisseur, une fois la béance créée qui font surgir le sombre ou le noir, des bouts de n’importe quoi sont posés, réparations de fortune, premières interventions sur le « théâtre d’opérations ». Tenter de ne pas aller trop loin et de ne pas faire venir à la lumière ce qui pourrait être dangereux ou dommageable ?
Photos griffées, personnages menacés quand les griffes forment des nœuds coulants, visages qui disparaissent, où ? absorbés dans l’épaisseur de la vie ou effacés d’un coup de gomme rageur. Ce seraient aussi des souvenirs qui se déverseraient sur un support en papier japonais, papier buvard, papier tissu, au grain lourd qui vient par son poids ajouter encore de l’épaisseur à des formes arrachées et qui absorbe l’image, n’en laissant que des brouillards de points ou des diffus, parfois informes, entre effacements et déchirements.
Arrachées, extirpées, projetées les formes jaillissent effacées déjà, elles s’apposent sur la toile, dans l’état où elles veulent bien émerger.
Parfois viennent des comparaisons Witkin, Ballen
Soccol, chez Philippe Ageon, "la nuit tous les labyrinthes sont bleus"

Philippe Ageon expose, 11 rue d'Artois, Giovanni Soccol, Vénitien, pas Italien… allons pas de catalanisme, il est Vénitien d’abord et Italien sans discuter !!!
Et puis, cela n’a aucun rapport avec l’Art. Giovanni Soccol est peintre et ce qu’il propose durant l’exposition de ses dernières productions est la preuve par la ligne droite qu’il est vénitien.
Pourquoi jauger de sa venitiennitude par le moyen de la ligne droite ? On le dira tout droit et directement, les Vénitiens ont un rapport très distant avec cette définition venue en ligne directe de la Grèce selon laquelle « le plus court chemin d’un point à un autre est la droite ». Essayez donc d’aller d’un point à un autre de Venise et vous verrez que la droite n’y peut rien. Elle serait même néfaste. Ce n’est pas que les Vénitiens aient eu un goût immodéré pour la sinusoïde et tous les objets qui s’en rapprochent. Mais, quand même ! Quand on vit depuis sa plus tendre enfance dans un univers où la ligne droite ne mérite pas grande considération, on conçoit progressivement que le territoire ne se laissera pas attraper par la carte sans que celle-ci fasse des concessions.
Ces concessions telles que Soccol les a mises en œuvre durant cette exposition prennent la forme de labyrinthes et de navires. Et ces deux formes d’expression, ces deux concessions, sont curieusement en opposition, ce seraient des contraires si on ne pensait pas que les derniers peuvent emprunter leurs routes aux premiers.
Expliquons-nous : Le labyrinthe est la forme la plus logique portée à l’encontre de la définition qu’on a donnée de la droite. La ligne droite n’existe pas à Venise, on ne va pas d’un point à un autre, la forme géométrique « qui passe par deux points » n’a pas de sens concret. Alors le labyrinthe. Mieux encore, des formes labyrinthiques qui en appellent aux fractales, se répliquant à l’identique quelles que soient l’échelle de la représentation. C’est ainsi qu’une part importante de l’exposition montre des labyrinthes, volutes de murailles qui s’enroulent dans un ordre parfait mais sans cesse changeant. C’est que la droite chez ces gens-là, passe par des centaines de points et que ces points ne sont pas immobiles « par construction ».
Il fait nuit dans le monde de Soccol. Les labyrinthes seraient sombres et peut-être maléfiques ou ne s’agit-il pas de prendre purement et simplement le contre-pied de la Grèce antique : à la lumière crue qui baigne l’Attique et la mer qui illumine entre Cyclades et Ionie, à cette lumière qui ne laisse pas planer l’ombre d’un doute sur le trajet géométrique entre deux points, Soccol oppose la nuit et ses ombres portées. Il laisse à imaginer les hésitations sur les formes qui émergent de la lumière affaiblie.
Comment sait-on qu'on est dans un labyrinthe? Les tableaux de Soccol, illustre parfaitement cette énigme: si les formes qu'il présente laissent à imaginer que le regardeur est face à l'entrée de bâtiments massifs et étranges qui annoncent sans ambiguïtés les labyrinthes qu'ils contiennent, rien ne dit que le regard porté vient d'un regardeur déjà engagé dans le labyrinthe. Et aussi, on pourrait penser à des châteaux, certaines œuvres montrant de puissantes ziggourat aux escaliers en volutes , renvoient aussi au château Saint-Ange, labyrinthe spirituel qu'on ne peut vraiment parcourir mais qui a connu tant de destinations qu'on ne peut pas dire laquelle est la bonne...
Et les bateaux ? S’il est un objet digne de considérations pour un Vénitien, le bateau en est l’exemple ultime. Une ville de mer et de marchands est une ville d’armateurs, de navires et de longs cours. Mais cette ville conquérante par les mers et ses flottes marchandes est aujourd’hui menacée par les grands bateaux de tourisme, monstres des mers étroitement apparentés à ceux des temps antédiluviens, gigantesques et stupides. Ces bateaux s’en viennent par les sinusoïdes de Venise et l’affrontent. Giovanni Soccor les représente de face, en étraves effilées et menaçantes, émergeant des brumes, indifférents et glacés.
Giovanni Soccor est un peintre vénitien de longue date. Dans cette phase créative, il s’est fait le témoin des traces éternelles laissées par la Ville et des menaces qui surgissent de la mer, dont elle est issue et qui, autrefois l’avait enrichie.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau