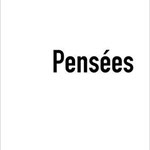Soliloques sur l'art, janvier 2018
- Une ligne éditoriale stricte et convaincue : Christian Berst Art Brut
- Anastassia Bordeau : Le passé dans le rétroviseur
Une ligne éditoriale stricte et convaincue : Christian Berst Art Brut

Parmi les galeries qui suivent une ligne éditoriale stricte et convaincue : Christian Berst Art Brut.
Il est dommage que je n’aie pas rendu visite à la galerie plus tôt. L’exposition qu’elle proposait jusqu’au 20 janvier était d’autant plus intéressante qu’elle rassemblait plusieurs artistes et offrait au regardeur une ouverture exceptionnelle sur l’Art dit « Brut ». Avant le nouvel accrochage, après cette exposition « œcuménique », mon propos n’est pas de chroniquer des œuvres mais de laisser aller une méditation sur cet art. Elle est ancienne cette méditation et je la fais venir au fil des mots. Une façon de lancer un débat ou de mettre au point des idées.
Tout est dans l’intitulé : Christian Berst Art Brut. On vous offre dans ce charmant passage des Gravilliers, le fin du fin de l’Art Brut. Comment disait-on, il n’y a pas si longtemps ? « L’art des fous » ? L’art des gens qui n’ont pas le même rapport au monde que nous et qui, très souvent, en souffrent, sans compter les cas où nous les faisons souffrir.
Art dont on dit que Dubuffet fut l’un des premiers à l’avoir identifié et catégorisé comme une branche particulière de « l’Art » avec un grand « A ». Il lui aurait donné ses lettres de noblesse. Il aurait constitué une collection extraordinaire d’œuvres (picturales) accomplies par des malades internés dans des cliniques psychiatriques ou des hôpitaux qui y voyaient le moyen de les mieux comprendre et de les canaliser. Le dessin, la peinture, la sculpture ont souvent paru être les bons moyens pour qu’ils se découvrent, se livrent et, à la fin, s’autothérapeutisent, croyait-on. Mon sujet n’est pas là. Ce n’est pas de soins et de maladies qu’il est ici question mais de leurs sous-produits ou de leurs instruments que sont les dessins, peintures, crayonnages, encres etc.
Quand, je pense à Dubuffet, que j’admire comme un des plus grands artistes du XXème siècle, je ne peux pas m’empêcher de faire la comparaison avec ces grands découvreurs de l’art africain (celui qu’on nomme ethnique). L’expression en usage dans les cartouches qui, dans les musées, identifient et présentent cet art si particulier est « récolte » : telle œuvre a été récoltée, collationnée par Monsieur, le Docteur, le Commandant Machin, en telle année, dans tel village ou à proximité. Les statues, les bâtons de sagesse ou de culte, les figures tutélaires n’étaient pas achetées, elles étaient « ramassées ». Elles n’étaient pas volées, elles étaient prises, parce qu’après tout, ne s’agissait-il pas de choses produites par des peuples non-civilisés. Primitifs. Récoltées parce que si proches de la nature en tant que bouts de bois. Récoltées aussi parce que, parfois ramassées dans des dépôts où les primitifs stockaient les objets du culte qui, ayant beaucoup servi, avaient perdu leurs pouvoirs et n’étaient finalement plus que des bouts de bois sans âme ni esprit. Sans valeur, pour eux. Pour les « récolteurs » aussi. C’était ça de gagné !!!
Donc, Dubuffet et ses amis auraient procédé comme les Belges et les Français dans leurs colonies africaines. Ils auraient ramassé des productions abandonnées tant il est vrai que les fous ne s’attachent pas à leurs œuvres en tant que produits finis mais en tant que thérapeutiques et que les pouvoirs de leurs travaux émergent non pas de l’œuvre finie mais de l’acte qui l’élabore.
J’ai, ici ou là, chroniqué certaines œuvres exposées par la Galerie Christian Berst. J’aime le travail qui y est mené, pourtant, les œuvres exposées me troublent souvent non pas en tant qu’œuvres artistiques mais surtout en tant qu’œuvres d’Art Brut. Peut-être, depuis le temps où Dubuffet avait lancé ses recherches, les conditions et les manifestations de l’Art Brut ont-elles changé ? Peut-être, autre grande différence, certains mouvements artistiques modernes puis contemporains ont-ils tellement investi ce champ-là que la production propre des « fous » s’est trouvée marginalisée et infériorisée ? Comment dire que les œuvres photographiques d’artistes exceptionnels comme d’Agata, Wilkin, Ballen etc. ne sont pas, à l’instar de celles d’un bon nombre d’artistes peintres du mouvement Cobra, des œuvres marquées par la folie. Je fais référence à Appel, Asger Jorn et leurs suiveurs, œuvres au sombre ou au noir, marquées par la dérive des sens ou de l’esprit.
L’art brut aurait-il été libéré par la découverte de cet art des « fous » avec pour conséquence que les professionnels s’emparant de ce registre d’émotions et de pensée s’y sont imposés. Mais il y aurait un autre phénomène : Dubuffet n’avait pas « découvert » l’art des fous, pas davantage que les « coloniaux » n’avaient « découvert » l’art des primitifs. Ce qu’ils ont fait est d’une autre nature que celle de la mise au jour. Ils ont « catégorisé » une forme d’expression artistique d’après leurs auteurs et en fonction du statut de ces derniers. Basquiat ne fait pas de l’Art Brut, selon les canons « dubufetiens » et pourtant… mais il n’est pas fou et s’il exploite un champ de sensations qui ressort de la folie, ce n’est pas en tant que fou mais en tant qu’artiste qui produit de l’art. N’est-ce pas pour aboutir à une observation : les œuvres des fous étant devenus des œuvres d’art, exposées en tant que tel, dans des lieux dont c’est le métier, valorisées en tant que telles sur le marché de l’art, accrochés aux murs des collectionneurs comme toute œuvre d’art qu’elle soit sublime ou banale, n’y a-t-il pas dérive dans la « production » de ces œuvres ? Car, nous ne sommes plus à cette époque innocente et bénie où la découverte permettait de sortir les productions des limbes où elles se perdaient pour les faire accéder à la lumière du jugement artistique. Les « fous » qui savent dessiner, peindre ou sculpter sont encouragés à le faire toujours pour des motifs thérapeutiques mais au surplus pour des raisons artistiques. Les fous ne feraient-ils les artistes plus souvent qu’à leur tour après que les artistes auraient mimé les fous ?
Cela doit-il conduire à mésestimer une forme d’art, une expression qu’on ne peut pas ne pas qualifier d’artistique ? Sûrement pas : de la même façon qu’il est des œuvres qui ont l’extraordinaire faculté d’être avant tout des questions, les œuvres des « fous » forment un corps extraordinairement riche de questions qui viennent, s’apposer, se former, se tracer et qui doivent conduire les regardeurs à questionner leur propre regard.
Anastassia Bordeau : Le passé dans le rétroviseur

BOA, 11 rue d'Artois, 75008
jusqu'au 31 janvier
Philippe Ageon, continue son travail de galériste du possible. Œuvres à portée de regard et de portefeuilles, tous genres confondus : les meubles ne sont pas de pures choses utilitaires, les photos décrivent des mondes d’aujourd’hui et d’hier, la peinture est abstraite ou … Concrète ?
Cette nouvelle exposition qui présente les œuvres d’Anastassia Bordeau, ne dépare pas les précédentes, elle ne dépare pas une autre exposition du travail cette peintre (sse ?) qui s’était tenue chez BOA voici deux années.
Je l’avais longuement commentée (suivre ce lien)tant le projet d’Anastassia m’avait paru à la fois bien pensé, bien construit et remarquablement exécuté. Ce que j’avais aimé dans ce travail d’artiste, c’était à la fois son exceptionnelle concision au service d’idées claires et son évocation en toute simplicité de thèmes forts, « éternels ». Pour elle plus l’ombre est profonde, plus la clarté est intense : opposition du flash blanc et de la nuit noire. Pour l’artiste, le regard contemporain est marqué par une obsession : celle du rétroviseur. Nous ne regardons pas l’avenir mais, dans ces nouveaux miroirs que sont les écrans du cinéma, nous nous obstinons sur le passé.
Anastassia Bordeau développe ce thème depuis longtemps, dans des œuvres fortes où la vie se réduit à des salles de spectacle et des stations de chemin de fer, devenues elles-mêmes, théâtres pour les voyageurs. Devant des rangées de fauteuils rouge, au long de quais absolument rectilignes, des écrans ont pris la place des acteurs des publicités. On y joue des films « culte ». Des films anciens. En noir et blanc, d’où émane une vie plus vivante que dans les fauteuils de velours où les quais des stations.
J’avais suggéré que, grâce à l’œuvre de peintres comme Anastassia, on comprenne mieux certaines « connexités » ou « apparentements », apparemment insensés et qui se trouveraient tout à coup évidents. Ainsi, la communauté d’esprit et de réalisation que j’ai toujours suspectée entre les images de Hopper et celles de Magritte trouve sa « démonstration » dans le travail d’Anastassia.
Cette dernière montre par sa thématique et son style pictural que l’un et l’autre de ces deux peintres vivaient dans le même monde avec les mêmes obsessions et la même volonté farouche d’en raconter toutes les facettes au moyen de formes et de structures simples. Son travail « évacue » le mouvement et donc le temps ? Anastassia, comme on le trouve dans l’œuvre de ces deux artistes, propose de simplifier la dimension temporelle et de la rendre « lisible » et pas seulement « visible » dans et par l’accumulation de signes simples, Rails, sièges rouges, quais rectilignes, rétroviseurs. Lignes claires ? Serait-ce paradoxal de relever que chez elle l’ombre n’a pas pour objet de montrer qu’il existe une vie des objets et des personnages, ni de leur donner contenance, les rassurant sur leur participation au réel. De même qu’il n’y a pas d’ombre qui vaille chez Hopper et Magritte, l’ombre chez Anastassia, c’est la nuit, reine ou déesse, elle est « dans la machine », en tant qu’acteur dans l’œuvre et y joue sa partition. Serait-elle le symbole d’un présent éternellement figé propice au retour du passé dévoilé par la projection de films anciens ? Sans le sombre, le noir et l’ombre, rien ne serait visible ? Regardant devant eux, les regardeurs verraient ce qui est maintenant derrière eux.
L’exposition reprend cette thématique et propose de grands tableaux où ce projet s’exprime dans sa plus grande pureté. Parmi ces œuvres déjà présentes chez BOA, le tableau qui ne cesse de me séduire et que je trouve très fort et très profond, au point que l’ai installé en tête de cette chronique. A l’inverse des autres œuvres, pas de rouge pour suggérer la théâtralité du sujet (hormis la « petite tâche de couleur rouge », sac que tient la jeune femme sur la droite du tableau). La nuit n’y est pas déesse lourde et obsessionnelle. Un triptyque rythme l’œuvre et propose une histoire aux confins de l’absurde : dans une station de chemin de fer, les emplacements publicitaires sont éclairés de scènes où le chemin de fer est cadre et acteur d’une histoire en noir et blanc. La construction du tableau, combinant lignes verticales et horizontales, les lignes de fuite qui lient le tout, conjointement avec la pure clarté du dessin et de la pose des couleurs, tout ici, renvoie à cette formule que j’ai un jour proposée à Anastassia : « l’art français en trois mots ? ». Réponse : « rien de trop ».
Outre ce que BOA avait montré dans la précédente exposition, l’artiste propose une série de petits tableaux. Certains étaient déjà là, d’autres sont plus récents et marquent une évolution thématique. Le fil rouge qui traverse le travail d’Anastassia est toujours là, rapport entre spectateur et spectacle, rapport entre nature et temps présent d’un côté et art et passé de l’autre, rapport entre d’une part l’art éternel présent à tous et de l’autre des regardeurs vus de dos, ou des sièges vides de regardeurs marquant l’absence au monde.
L’opposition regardeur-regardé s’atténue dans ces nouvelles œuvres, le temps s’inscrit et repousse le noir absolu ou le rouge théâtre. Ce sont des ciels colorés, des crépuscules d’été, des bleus chaleureux qui apportent avec eux, l’histoire et le contexte et écartent certaine froideur des œuvres antérieures : le discours est moins abrupt et plus psychologue. Il mêle bien davantage texte et contexte : l’artiste installe les écrans de cinéma dans des parcs, sur les bords de mer, dans une prairie à deux pas d’une église de « village » ou au bord d’un lac de montagne. Sur certains écrans, les montagnes paraissent poursuivre le dessin des « vraies montagnes » qui forment à l’horizon le cadre naturel du spectacle, comme si la nature se portait au secours de la culture, comme si l’espace du spectacle était indissociable de l’espace naturel. Le discours devient ouvertement magrittien quand un parc « à la française », décor d’un film, vient percuter un autre parc, décor de la vie, mais parc « à l’anglaise » ! Et aussi, l’artiste débusque de merveilleuses ambiguïtés : dans une scène sur un écran planté devant la mer, un acteur « s’en va », tenant son chien en laisse, en suivant un rivage. Comme lassé de ceux qu’il ne voit pas et qui ne sont pas là, il tourne le dos aux rangées de « fauteuils transat » quasiment vides de regardeurs.
Tout en maintenant ses thèmes de prédilection, l’artiste quitte les oppositions frontales au profit de nuances qui adoucissent son trait et son propos.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau