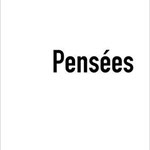Essai sur l'histoire de l'Art de demain
1- Dove Allouche, Mea Culpa d’un sceptique
2- John Henderson, ou la tentations académique
3- Faut-il brûler l'Art Abstrait?
4- Avec quels yeux voit-on?
L’intérêt des foires, des « Fair », des expositions multipliées, voire simultanées réside dans la possibilité de regarder, en un laps de temps réduit des œuvres fantastiquement différentes les unes des autres ; essayer de comparer, de comprendre des tendances, d’identifier des projets. N’existent pas seulement les foires, les autres modes d’exposition, fondations, galeries, c’est plus lent. Il faut marcher beaucoup plus. Mais, à ce rythme plus lent, on peut associer davantage de réflexion. Ajoutez à cela que dans beaucoup de cas, vous êtes là seul, alors que les foires risquent d’être encombrées.
Alors quoi ? Que voit-on ? Y a-t-il des choses frappantes ? Des évolutions claires ? Je ne reviendrai pas sur un de mes thèmes favoris : comment peut-on apprécier des choses qui ne sont pas encore reconnues ? Qu’est-ce que le beau quand les modes de représentation changent, quand les techniques même évoluent à toute vitesse ? Je propose de rester au plus près des œuvres, celles que j’ai retenues ou celles qui m’ont déplu. Et là, à partir de ces « faits » esthétiques, comprendre ce qui se passe, s’il se passe quelque chose, esquisser des tendances, imaginer des passés qui radotent aussi.
1- Dove Allouche, Mea Culpa d’un sceptique

Dove Allouche
Premier fait : une exposition de la fondation d’entreprise Ricard. Elle expose un monsieur Dove Allouche et cela s’intitule « Mea culpa d’un sceptique ». Pourquoi pareil mea culpa ? On le sait à condition de se plonger dans la lecture d’un petit livret qui commente la geste de l’artiste, ses gestes et le résultat de tout cela. Cette littérature renvoie directement à Alta Mira, aux grottes recouvertes de calcite, à la matière et au trait d’il y a très, très longtemps, à la vertu de la lampe à huile (il faudra attendre des milliers d’années supplémentaires pour qu’on découvre les vertus de la peinture à l’huile). Si ce n’est pas clair, le petit livret en appelle à Dérida pour tenir une lampe pigeon intellectuelle (version moderne de l’antique lampe à huile). Le résultat ? Des images issues d’un rapport complexe entre la chimie photographique, l’art du verrier etc… Art pariétal moderne qui n’est pas supporté par les parois des grottes mais sur des objets bien identifiés qu’on peut accrocher aux murs d’une exposition ou ailleurs. Les grottes sont inamovibles ? Pas les œuvres de Dove Allouche, heureusement pour lui ! Quoi de commun avec le travail de nos ancêtres d’il y a très longtemps : on ne voit pas davantage ce que Dove Allouche veut représenter sur ses supports néo-pariétaux et que, sans éclairage (huile ou électrique), on ne verrait pas davantage que ce que les grands ancêtres avaient dessiné sur les murs. Le petit livret ne permet pas de voir les œuvres mais de les lire. En s’approchant, on voit bien quelques irrégularités. De type calcite ? Quoi de commun avec l’art pariétal ? La taille des œuvres peut-être ? Les préhistoriques n’hésitaient pas et aimaient à s’étaler sur de grandes surfaces. Ils étaient prémodernes à ce compte-là. Américains même. Dove Allouche fait aussi dans la « King Size », mais, modeste, il se contente du XL (pas le XXL comme Richter et Newton) …
S’agit-il des derniers soubresauts d’une forme d’art qu’on a connu flambante et heureuse. Les teintes terreuses et les bouffissures indistinctes des œuvres de Monsieur Allouche, laisseraient penser qu’en effet, l’art abstrait vit quelques dernières heures difficiles. Dernière ressource pour lui donner un tonus perdu : utiliser les techniques photographiques, revenir vers les grands ancêtres (les préhistoriques d’Alta Mira) et les plaques des premiers photographes (les préhistoriques de la photo « shopisée »). Et pour finir, raconter, faire raconter, dire l’histoire, story telling. C’est essentiel : depuis Duchamp, on ne montre plus une œuvre, le regardeur a muté en écouteur, il faut raconter l’objet. Ce serait un signe des progrès de l’alphabétisation dans les sociétés occidentales et la preuve que nous avons dépassé le stade du « sapiens sapiens » débutant, que regarder ne suffit plus, il faut lire, raconter, narrer, expliquer. Peu importe ce qui est produit, c’est l’idée, l’intention, le désir qui doivent être là et doivent être racontables : le livret qu’on lit à défaut de l’œuvre qu’on ne peut plus regarder. Cela ressemble à Duchamp dont le grand œuvre ne peut être regardé sans avoir préalablement consulté les dizaines de pages de notes destinées à lui conférer davantage de proximité vis-à-vis des regardeurs (des lecteurs, en fait).
Tout au long des visites récentes à Art Paris ou à Drawing Now, j’ai eu un fort sentiment de déclin de l’art abstrait, des signes apposées sur la toile pour dire qu’on ne peut pas représenter mais seulement signifier la représentation ou lui proposer d’aller voir ailleurs. Il y a encore des émules du carré blanc sur fond noir et réciproquement ou du dripping hasardeux (balancez tout, l’art reconnaîtra les siens) ou de la déchirure noble. Preuve s’il en fallait que l’univers de l’art est animé par des types d’acteurs assumant des rôles assez bien définis : il est des visionnaires et des passeurs. Mais il est aussi des suiveurs et de purs artisans, les copieurs, qui ont compris comment on faisait et qui répètent inlassablement les gestes des anciens…rangeons Dove dans cette dernière catégorie.
Deuxième fait : John Henderson, où la capture du regard
Ou bien, associons-le (Dove Allouche) avec John Henderson que présente le célèbre galeriste, Perrotin. Peintre du subliminal, de la trace qui demeure quand tout a disparu, de la couleur qui tue ce qui est noir ou blanc, du monochrome parce qu’il est des couleurs si belles qu’on n’éprouve pas le besoin de les mêler aux autres. Il semble que l’artiste ici n’ait pas breveté ses couleurs mais on sent bien qu’une partie de son œuvre renvoie à un certain monsieur Klein et à son bleu breveté.
Il n’y aurait rien à voir ? Bien sûr que si ! Il y a à voir une œuvre qui parle de l’œuvre qui parle de l’œuvre. Sous le bleu ciel, le monde, en filigrane, caché, illisible. Mais c’est ça la leçon. Le trop visible empêche de voir. L’excès de lumière écrase les ombres. John Henderson fait des efforts surhumains pour faire disparaître l’œuvre, peinte, photographiée, dessinée, gravée. A force d’empêcher la réalité de poindre autrement que sous des formes subliminales, il en vient à l’annihiler dans un projet d’a-réalité. Au prix d’un déferlement de techniques picturales ou graphiques, elle n’existe plus … On peut se demander s’il n’aurait pas été judicieux de les utiliser pour faire apparaître quelque chose plutôt que de le faire disparaître ! La réalité, si elle existe, a été effacée, abstraite… rien n’apparait plus que du bleu, de l’orange, du marron. A nouveau, l’abstraction sous la forme primitive du rien que l’artiste ne s’efforce même pas de montrer.
Il faudrait ici tenir compte de mes choix de regardeur. Inconsciemment, j’ai regardé ces œuvres (celles de Dove Allouche comprises) parce que j’ai dû penser aux « texturologies » de Dubuffet. A son travail extraordinaire de découverte de la matière et au travail de l’artiste pour la montrer. Il est vrai qu’il est difficile de modifier les repères qu’on s’est construits. Un regardeur ne regarde pas avec un système optique mais avec son cerveau, avec les outils dont il l’a doté. J’ai dû me pencher vers ces œuvres sans me rendre compte que Dubuffet veillait. J’ai choisi d’entrer dans les galeries qui les présentaient. Je n’y suis pas venu au hasard. Je suis non seulement entré mais j’y suis resté pour voir. Pour voir quoi ? Pas le plancher, ni les murs, ni même les jolies filles qui gardent le saint des saints. Pour voir les œuvres exposées. J’aurais pu, mobilisant des couches de cribles bien installées, tourner immédiatement le dos à ces « œuvres » et repartir avec la conscience tranquille d’un œil qui ne s’expose pas à n’importe quoi. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé : je suis entré, je suis resté, j’ai regardé, j’ai même exploré, m’approchant des œuvres, pour les lire un peu mieux, m’en éloignant pour mesurer leur effet en tant qu’objet accroché à un mur.
Au fond de tout ceci: le crible « Dubuffet ». L’adhésion aux Texturologies, et leur extension à Pollock, à ses Drippings. Peut-être, sans cette référence mentale, n’aurais-je jamais considéré ces œuvres. Je n’aurais pas exercé mon œil de regardeur.
Je suis entré sur cette impression. Je suis sorti morose, me faisant cette remarque : la vision de Dubuffet, c’était il y a trois quarts de siècle. Reprendre aujourd’hui la méthode et l’ambition de Dubuffet 70 ans après qu’il les ait proposées aux regardeurs, c’est exactement comme, si en 1945 on avait refait des œuvres à la manière du « salon des refusés » !!!
C’est trop dur ? Ces deux artistes qu’on est en train de pourfendre, ne sont-ils pas dans des musées et dans des collections particulières ? Celles qui comptent évidemment. Peut-être même ont-ils été vendus lors de ventes-record par les grandes maisons de vente à Londres ou à New-York ? Et puis, 70 ans après le Salon des Refusés, nombreux étaient les d’artistes qui ânonnaient encore la leçon impressionniste. Songez que 140 ans après, il y a toujours des copieurs convaincus. Songez aussi, que 140 ans après, il est des acheteurs satisfaits de se procurer des œuvres impressionnistes contemporaines : les « Monet » sont inabordables et un bon amateur d’art n’aime pas acheter des reproductions ou des copies de Monet même bien faites. Il lui faut de l’authentique. Du fabriqué à la main, à la lisière de l’artisanat d’art, du style « Monet » comme au Faubourg Saint-Antoine, il n’y a pas si longtemps, on fabriquait encore des cabinets Louis XVI, des bureaux dans le plus pur style boule, des meubles à système comme au temps du régent.
C’est ici qu’on voit poindre ensemble l’académisme et le beau. Les cribles bien installés ne laissent plus passer que les choses qui le méritent. J’entre dans les galeries ou les lieux d’exposition pour voir ce que mes cribles m’invitent à considérer. Ils me guident. Ils obstruent aussi mon regard. Ils ne cherchent que ma quiétude. Le plaisir du regard donne la mesure du repos de la pensée.
3- Faut-il brûler l'Art Abstrait?
Troisième fait : Faut-il brûler aujourd’hui ce qu’on adorait hier ? L’art abstrait dans toutes ses tendances est-il à envoyer dans les greniers ?
Certainement pas.
Une bonne raison à cela : on ne saurait si vite s’en déprendre et changer nos regards de regardeurs. Nous regardons avec nos cerveaux, mais nos cerveaux ne sont en rien la pellicule photo en attente d’être impressionnée. Il n’y a pas de terre vierge dans notre tête qui attend les images avec la ferme intention de les traiter comme il convient. Il n’y a pas de machinerie qui se mettrait en branle au premier stimulus pictural, photographique, graphique, sculptural, pour mouliner l’image et qui, après quelques temps de travail souterrain, énoncerait le fameux « Géme » ou le non moins fameux « J’aime po ».
Nous ne regardons pas malgré nous et le jugement que nous portons sur ce que nous voyons sort de cribles, ceux qui se sont forgés au long de nos recherches ou de nos observations. Ceux aussi, et très fréquemment, qu’on nous a donnés car nous sommes les produits d’une culture avant d’en être les producteurs et nous regardons avec des lunettes déformantes, grossissantes ou au contraire minimisantes selon les guides mentaux que nous avons reçus, que nous les ayons adoptés ou que nous les suivions sans nous en rendre compte. Parmi les cribles, il faut retenir aussi ceux qui résulte de nos propres choix esthétiques, de nos recherches, de notre regard sur le monde.
Ces cribles ne sont pas amovibles en fonction d’un enthousiasme ou d’une dénégation. Les regardeurs dont les cribles et critères paraissent amovibles et d’une souplesse admirable, sont des professionnels de l’art. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Ils sont l’offre, or, dans toute économie, les offreurs n’ont pas intérêt à croire que leurs produits sont inscrits sur les marchés, immobiles et intemporels jusqu’à la nuit des temps ! Ils ne sont pas seuls, ils ont des concurrents qui annoncent de nouvelles visions, de nouveaux cribles et donc de nouveaux artistes. Il leur faut bouger quoiqu’il en soit de ces fameux cribles, voire les violenter, quoiqu’il en soit de la qualité des œuvres. Il faut vendre pour vivre et parfois pour vendre adopter des stratégies de rupture.
En dehors de ce cas particulier, il faut considérer que nous voyons ce que nous avons appris des autres, ce que nous nous sommes appris à voir. Il en est dans ce domaine comme dans le domaine de la foi : ce n’est pas parce qu’on voit qu’on croit, c’est parce qu’on croit qu’on voit. Admettons que ce qui est dit ici est aussi valable pour la musique et dans bien d’autres domaines.
La conséquence de cette proposition devrait être la suivante : puisque nous sommes dotés de ces cribles mentaux, nous ne devrions jamais voir que ce que nous avons appris à voir ou ce que nous avons pris l’habitude de voir. En matière d’art ce qui vient d’être écrit est profondément vrai sauf quelques nuances à part, voire plus haut, qui font justement sauter cette proposition.
Mais revenons tout d’abord sur elle : 140 ans après le Salon des Refusés, on trouve encore des artistes impressionnistes en activité. Jeunes et engagés. Inversement, le marché de l’art moderne, contemporain, de l’art en train de se faire, en France mais probablement aussi ailleurs, ce marché de l’art souffre. Combien de fois a-t-on pu surprendre cette remarque désastreuse « mes enfants pourraient faire la même chose ». Peu importe l’occurrence, peu importe que le peintre sous critique ait été très mauvais, ou ridicule. Peu importe : c’est dit donc c’est pensé… et si cela ne l’est pas, ce n’est pas trop différent : les cribles ont parlé.
Et ainsi observera-t-on que tel maître du XVIIIème siècle est immédiatement lisible quand Anselm Kieffer parait incompréhensible, tel auteur des grandes machines historiques du XIXème est regardé avec émotion et empathie quand, il n’y a pas si longtemps « Guernica » passait pour une sinistre plaisanterie. Faut-il généraliser le propos ? Le peut-on dans le domaine musical par exemple ? On peut avancer que c’est encore plus vrai. La musique est plus complexe à « écouter » que les tableaux le sont à « regarder ». La permanence des cribles issus de la musique dite « classique », celle du XVIIIème siècle par exemple, est remarquable. Vous ne lasserez personne dans une salle d’attente si vous la plongez pour vous attendre dans un flot de type « quatre saisons » de Vivaldi ou un choral de Bach.
Remontons en arrière, quand la télévision française « accompagnait » de musique ses principales émissions : La musique du « Grand Siècle », la Musique des musiciens de la cour de Louis XIV était sans cesse sollicitée. Notre intellection de la musique comme celle de la peinture n’est donc pas libre et si nous nous prétendons indépendants de toute opinion extérieure lorsque nous formulons nos jugements, il faut en conclure que nous ne nous rendons pas compte que nos «guides » intérieurs font leur travail efficacement : ils ouvrent les vannes toutes grandes dans certains cas. Dans d’autres, ils ne se rendent pas compte que quelque chose aimerait aussi passer et ne le peut pas : les mécanismes d’ouverture des vannes n’ont pas les bons capteurs, ceux dont la sensibilité déclencherait cette ouverture.
Avec quels yeux regarde-t-on?

quatrième fait : Il y aurait des couches de cribles ?
Des sédimentations de critères ? Il y aurait aussi de degrés de fixations de ces critères. D’aucuns seraient restés bloqués sur une couche de crible, par exemple : la peinture à la fin du XVIIIème siècle français. Pensez à toutes ces gravures de Greuze qui traînaient dans les maisons de nos campagnes. La fiancée de village, la présentation du promis, le contrat de mariage, dont le sentimentalisme a correspondu si fort à une période de la peinture de mœurs française. A l’opposé de cette peinture un peu larmoyante, pensez à Fragonard et à ses friponneries. Pensez aussi au Pierrot de Watteau comme au « Blue boy » de Gainsborough. La liste pourrait être complétée on en viendrait toujours au même constat : bon nombre de nos contemporains jugent encore la production d’art en usant de ces cribles-là, en la passant sous les fourches caudines d’un art vieux de plus de deux cents ans, comme à la fin du XIXème siècle, le buffet Henri III était devenu le must du mobilier de salle à manger bourgeoise.
Un bon indicateur se trouve dans les reproductions « en couleur ». Greuze et ses compatriotes vulgarisaient leurs œuvres à coup de gravures en noir et blanc. S’ils avaient eu la ressource de la photographie en couleur, combien de reproduction du Fiancé de Village auraient orné les salons ou pièces à vivre. Ils auraient peut-être pulvérisé les "Blue boy" de Gainsborough, les joueurs de fifre de Manet, les Cuirassiers blessés de Géricault, tout ceux-là qui sont apparus suffisamment tard pour que l’idée d’en reproduire les images n’aient pas été ni impossibles, ni incongrus.
Qu’ont-ils donc de « supérieurs » pour que leurs reproductions dominent le champ visuel de bon nombre de nos contemporains ? Quelles sont donc les recettes de cette esthétique démocratique : d’où ces œuvres, importantes certes, tirent-elles qu’elles s’imposent dans une sorte de bonne conscience esthétique ? Si elles s’accrochent aussi vigoureusement aux murs, il faut qu’il y ait d’excellentes raisons. Mais il est aussi d’étranges paradoxes. Il n’est pas du tout sûr que le Balzac de Rodin soit considéré comme une œuvre marquante du sculpteur alors que la représentation de l’homme de Cro-magnon aux Eyzies, n’attire que les regards intéressés et empathiques !
Si on voulait pousser l’argument à son maximum on en viendrait à se demander si dans la part reptilienne de notre cerveau, n’existent pas, enfouies, des sous-couches sédimentaires, de vieux cribles qui nous ont laissé des images d’Alta-mira comme repères dans des mondes qui bougent trop vite.
C’est bien sûr pousser le bouchon fort loin, mais cela vaut de rappeler que si nous pouvons avoir conservé sous formes de couches sédimentaires mentales des cribles fort anciens, il ne faut pas s’étonner de voir ré-émerger des formes qui étaient devenues historiques. C’est ainsi qu’il faut peut-être comprendre l’émergence des pré-raphaélites (dont la caractéristique principale a été d’être en fait des post-préraphaélites avec près de 300 ans d’écart) et d’un style « revival » des peintres dits primitifs italiens à la fin du XIXème siècle. On dira que cet art-là était un art pour élites cultivées, choisi et imposé. Mais on pourrait tout aussi bien dire que ces élites avaient décidé un grand retour aux cribles d’autrefois. Façon de refuser des révolutions en cours. Façon d’affirmer que les cribles ne sauraient évoluer sans contrôle.
Dans ce même ordre d’idée, l’idée que la sédimentation des cribles puisse être interrompue ou niée, c’est-à-dire imposée, trouve son expression la plus caricaturale dans la peinture à caractéristique idéologique dont celle à dominante religieuse : La peinture du réalisme soviétique oppose à l’encontre de toutes les évolutions dans la constitution des cribles un blocage des couches de sédimentation. La peinture religieuse n’est pas exempte de l’instauration de blocages sévères. Pour le dogme pas de couches de sédimentation. Il y a des canons et ceux-ci s’imposent à la pensée et à son exécution : les œuvres d’art. Les condamnations à l’encontre de l’art et de la conception « autonome » à laquelle les artistes se référaient relevaient de cette simple idée qu’il n’y a pas de cribles, ni de couches de sédimentation. Il y a une doctrine. Ce qu’on lit, ou qu’on apprécie dans une représentation ou dans une image, n’en sont que la traduction plus ou moins parfaite, plus ou moins respectueuse : la peinture des icônes l’illustre à merveille, mais aussi la peinture médiévale, en particulier la fameuse peinture gothique.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau