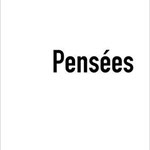Banques
- La finance et la banque à l'état gazeux (Paru dans les Echos)
- Le retour d’une vieille obligation : la sécurité des avoirs financiers (paru dans les echos)
- Les néo-banques, poissons-pilote ou vraies banques?
- Bad Banks, Bank run, Banques de l'ombre ou shadow banking, Bancarisation, Banque Centrale, Banque Centrale Européenne, Banques systémiques ou Sifi, Banque Universelle, Banque de groupe, Banque Commerciale, Banque Electronique et banque en ligne,
Le retour d’une vieille obligation : la sécurité des avoirs financiers :
Il est des fonctions bancaires qui paraissent si banales, caricaturales ou dépassées qu’on vient à douter qu’elles puissent encore avoir un sens dans le monde moderne, celui de l’informatique et du « tout à distance ». A quoi pouvaient-elles bien servir les banques dans le rude Far-West pleins de gangsters armés de carabines et de winchester. Basiquement, elles servaient à conserver l’argent de leurs clients à l’abri de leurs « vaults » et à faire du recouvrement de créances pour le compte de ces derniers.
Parvenaient-elles toujours à conserver l’or et les billets de leurs clients ? c’est un débat pour historiens ! En revanche, la sécurité des valeurs conservés par les banques d’ordre et pour compte de leurs clients est un thème qui revient de plus en plus sur le devant de la scène.
Protéger les avoirs un rôle essentiel des banques
Est-ce un absurde archaïsme que de mettre en avant cette vieille évidence : les banques, on s’en sert pour mettre l’argent à l’abri. N’est-ce pas très moderne que d’y répondre que « Si les banques ne sont que des coffres-forts, il vaut mieux ne pas se vanter d’être banquier ! ».
N’est-ce pas pour cette raison que les banques sont des tiers en qui les geeks n’ont plus confiance ? Quand elles annoncent qu’elles ont des vaults physiques ou comptables, quand la monnaie fiduciaire peut être conservée dans les coffres, quand la monnaie tout court se retrouve sous forme d’inscription comptable, quand elle finit par se nommer monnaie de banque, les geeks crient au détournement et à l’infantilisation des citoyens.
C’est ainsi qu’on voit émerger des banques « open ». Des néo-banques. Des banques en ligne où tout s’organise autour d’une informatique légère comme un régiment de cavalerie du même nom. Elles épargnent à leurs clients des lourdeurs administratives, des opérations où les précautions l’emportent sur la rapidité d’exécution, ou en un clic, on compacte toutes les manipulations auxquelles étaient consacrées les célèbres armées de « middle men ».
Beau programme. Et comme au temps de l’Ouest Lointain, certaines de ces néobanques disparaissent dans un cambriolage dantesque, mais en ligne. Il y avait des failles de sécurité dans leurs logiciels. Les ressources affectées à la traque des anomalies n’étaient pas assez nombreuses.
Le Pire avec les crypto-monnaies
Ajoutons les Crypto-monnaies : « Le vice-président de la Fed met en garde contre l'engouement pour les monnaies numériques ». Il évoquait la création de monnaies digitales souveraines, les fameuses « CBDC » et pointait du doigt l’excès d’enthousiasme qui les entoure. La police anglaise, il y a peu annonçait qu’elle avait saisi des saisies de crypto-monnaies pour un montant de 130 millions, succédant à d’autres saisies. Ces belles opérations de police donnent une belle leçon à tous ceux qui vantent l’anonymat, l’internationalisation débridée des transactions en crypto-monnaies.
Les monnaies cryptées, qu’on dira privée par opposition avec les monnaies digitales souveraines, les CBDC, sont bien fragiles et ont montré leurs faiblesses dans la conservation informatiques des jetons. Plateformes qui disparaissent sous les attaques de Hackers, ou sociétés financières nouvelles qui mettent trop de temps à devenir rentables et mettent la clef sous la porte, emportant par la même occasion les fonds qu’on leur a déposé.
Même pour les CBDC, la barre à franchir est haute compte tenu des coûts potentiels et des risques de sécurité. "Une CBDC de la Réserve fédérale pourrait présenter une cible attractive pour les cyberattaques et autres menaces à la sécurité", ou être utilisée pour le blanchiment d'argent, a énuméré Randal Quarles.
Au fond, ici de quoi parle-t-on ? De cette mission primaire des banques : la mise à disposition de services de sécurité au profit de leurs clients ! La naissance de la banque moderne repose sur cette idée qu’il vaut mieux que l’or soit dans les coffres de la banque et que ne circulent que des billets qui le représente ? Faut-il rappeler que les banques ont non seulement le devoir de protéger les avoirs mais aussi les opérations.
C’est beaucoup plus cher à mettre en place et à gérer qu’un logiciel en ligne avec des télétravailleurs pour le surveiller. La récente aventure du crypto Titan montre que l’absence de systèmes de surveillance conduit directement à des risques gravissimes pour les porteurs. Cette monnaie était sûre puisque définie comme « stable coin » c’est-à-dire des actifs financiers libellés en fiat monnaie. Son effondrement n’a été que la conséquence mécanique d’une « couverture » en deçà de ce qui était promis et de ce qui était annoncé.
Progressivement, l’évidence devient criante, elle vient du fonds de l’histoire de la monnaie et de la banque. La garantie que ces deux dernières procurent à leurs porteurs et clients, ne pourra jamais être le résultat de cette « légèreté d’être » dont se parent les néo-institutions et les néo-monnaies privées.
La finance et la banque à l'état gazeux
La finance et la banque d'autrefois étaient entre les mains d'organisations solides et localisables. Progressivement, les néo-banques, fluides, et parcellisées les transforment en un étrange «état gazeux».
«L’art à l’état gazeux» est un livre de chroniques et critiques artistiques rédigées par Yves Michaux, célèbre essayiste. Son livre est construit autour d'un paradoxe. Nous vivons dans le monde du triomphe de l'esthétique. Tout est supposé être beau : les produits packagés, les corps du «body-building», l'environnement protégé et préservé, la nourriture dans les assiettes..Ce n'est pas la fin de l'art et il n'y a pas lieu de crier au scandale. Mais c'est la fin du régime traditionnel de l'art, celui où il produisait des objets.
Quelles banques pour quels clients ?
Les nouvelles façons d’emprunter et de prêter auraient radicalement changé. Comme pour l’art, la finance serait maintenant un peu partout gérée, animée et distribuée par de nouveaux acteurs suivant une position de principe : les tiers de confiance (les banques) ont disparu du paysage financier. Les sollicitations de crédit ne sont plus adressées à des banques ou institutions financières. Il n’y a plus de middle-men pour recevoir ces demandes et éplucher le contenu du dossier portant demande de crédit. Donc, enfin, les demandeurs de crédit n’ont plus à s’embarrasser de notes, d’explications, de dessins et d’assaut d’amabilité à l’égard d’un personnel bancaire dressé à n’avoir aucune imagination et convaincu qu’il ne peut être tenu responsable pour quoi que ce soit puisque les documents qu’il manipulait devaient atterrir dans le ventre des ordinateurs maisons, transformés en data et moulinés dans l’esprit de tel organisme de crédit, en fonction de ses critères et selon les notations qu’il attribuerait.
La question «qui ?» prend une tournure de plus en plus disruptive. Le monde de la finance et de la banque bascule plus vite qu’on le pensait et ses fondements craquent sous la pression de forces de plus en plus violentes. Sous l’effet d’une dislocation des plaques bancaires et financières, on observe le passage d’un monde massif «rockefellerien» à un monde gazeux, d’un monde où la finance et la banque sont exercées par des organismes qui ont la consistance de mégalithes à un monde où les fonctions de l’entreprise, y compris celles de l’entreprise de financement sont éclatées entre des apps, des logiciels, des protocoles sans qu’il soit possible de répondre au «qui ?» et par voie de conséquence, sans qu’on soit sûr du «où ?» de la prestation bancaire et financière.
Gazeux, parce qu’il n’est plus possible de localiser les prestations de service .
Elles sont livrées à partir d’une combinaison délocalisée de compétences à l’opposé du modèle ancien de la banque et des institutions financières, nécessairement localisables, solides grâce à des hiérarchisations pareilles aux lignes de force qui assurent la parfaite stabilité d’un édifice, lieux où on sait se rendre et qui, pour se rapprocher, se démultiplient en lieux secondaires, sous la forme de guichets d’agences, succursales, filiales ; à l’opposé, donc, de ce modèle ancien qui mobilise des compétences humaines installées dans des locaux adaptés à l’accueil de la clientèle, un nouveau modèle se mettrait en route.
Si nous maintenions l’expression «ma banque», il faudrait réellement la prendre dans l’absolue vérité du terme et en décliner les composantes : je mobilise ma banque à partir de mon ordinateur, de ma «wallet», de mon réseau, de ma clé et j’active le «smart contract» garantie, le «smart contract» intérêt, etc.
Pourtant, J’active le «smart contract»… n’est pas même cohérent : en vérité, j’ai choisi parmi les différentes solutions disponibles sur le marché des apps et j’en ai retenu un, que j’oublierai peut-être un peu plus tard pour un autre moins cher, plus efficace.
Ainsi, la néo-banque ultime sera un conglomérat instable de morceaux de fonctions bancaires fonctionnant sous la garde et la protection sécuritaire d’une blockchain, la meilleure bien entendu, ou plus précisément, la meilleure pour le moment.
Mais reconnaissons que les consommateurs seront enfin libérés des tiers de confiance, tous ceux-là qui se gobergeaient sur leurs dos de consommateurs sous-informés. Mais aussi reconnaissons que mettre en place de solides règles de supervision et de régulations ne sera pas facile. Aussi difficile que de cantonner un gaz et de vérifier la conformité de ses particules.
Les néo-banques, poissons-pilotes ou vraies banques?
Première partie : Des OBNI (objets bancaires non identifiés)
La multiplication de ce qu’on nomme les néo-banques a quelque chose à la fois d’émouvant et d’inquiétant. Emouvant parce qu’enfin les grandes et massives organisations bancaires sont challengées par des « chevau-légers » de la banque et de la finance appuyées sur l’état de l’art en matière de technologie informatique et de communication pour développer une banque réactive, imaginative et proche des clients. Inquiétant, parce que même si ces « néo » ne prennent place sur la scène bancaire et financière que dans le cadre de réglementations contraignantes destinées à protéger monnaies et utilisateurs de la monnaie, leur foisonnement, la concurrence qu’elles se portent entre elles et aux banques traditionnelles, comportent des risques élevés de dérive et de dévoiements à l’encontre des utilisateurs et des pouvoirs publics.
Les néo-banques, une espèce à croissance ultra-rapide.
Les néo-banques se multiplient à une vitesse étonnante, c’est un fait incontournable. Le Journal du net citait une étude qui en identifiait 46 en Europe et 12 opérationnelles en France. Pour les néo-banques nées dans un pays « euro », le champ d’action géographique est naturellement « Euro-péen ». Mais, elles débordent souvent et, dans quelques cas, ont franchi l’océan. Elles visent en général les particuliers, les start-ups et auto-entrepreneurs et les PME. Leurs prestations, en ligne, sont très basiques et se concentrent en général sur ce que le système classique qualifie d’opérations de caisse : compte en banque, carte de paiement, chèques, virements, prélèvements, et toutes informations les concernant. Elles ne prêtent que très rarement et n’offrent pas de produits d’épargne particulièrement innovants. Parce qu’elles sont modernes, innovantes et en ligne, elles ne recourent qu’à un nombre très réduit d’agents. Parfois moins d’une centaine alors qu’elles couvrent des zones géographiques fort larges.
Voilà, pensera-t-on une remarque typiquement conservatrice ! Quelle importance, le nombre d’agents disponibles pour le fonctionnement de la néo-banque et la satisfaction de sa clientèle, puisque justement, son but est de se débarrasser des paperasses, ronds-de cuir et autres ralentisseurs d’actions, de financements et de paiements ? Il est certain que, vu sous cet angle, l’idéal serait certainement une banque conçue comme une version élaborée d’un « smart contract » ou mieux une DAO façon Ethereum. Plus de « Middle Men » qui ne sont pas des partenaires mais des empêcheurs de tourner en rond.
Valeur ajoutée fictive ou marketing hyperbolique?
Il faut revenir aux réalités bancaires et à la valeur ajoutée des néo-banques avant d’envisager le pire. Les néo-banques sont-elles si « néo » que cela ? On peut dire sans se tromper que, dans la plupart des cas, les néo-banques sont une couche bancaire qui vient se superposer aux précédentes. Bien sûr, elles fonctionnent dans le cadre et selon les règles d’une directive européenne sur l’accès aux données des banques traditionnelles. En d’autres termes, elles dépendent des relations que ces dernières entretiennent avec leurs clients. Et elles se les approprient pour développer des services qui prétendront être supérieurs. On comprend pourquoi il n’est pas besoin de beaucoup de dépenses en ressources humaines. Si on ajoute le fait que les néo-banques, lorsqu’elles s’attachent à offrir des crédits, le font en sous-traitant à quelques plateformes spécialisées les fonctions clés que sont le KYC assessment, l’analyse de risque, la constitution de notation à partir des informations bancaires (venant des banques traditionnelles) on ne peut qu’être inquiet et étonné. Si la banque n’est finalement qu’un agrégat de services sous-traités à des non-banquiers comment peut-elle se définir en tant que banque ? Une banque n’est-elle qu’un agrégateur ? Si un des sous-traitants dépose son bilan qu’adviendra-t-il des données qui lui ont été confiées. Si une plateforme de notation, cherchant à faire plaisir à ses clients, assouplit ses critères, que peut-on attendre des néo-banques concernées ? Pas davantage de sécurité que lors de la crise de 2008 quand certains régulateurs découvrirent que des notations hyperboliques avaient conduit au montage de produits « pourris ».
Ce sont des questions basiques que les régulateurs se posent « basiquement » depuis que l’idée de réguler le fonctionnement des banques est devenu une contrainte institutionnelle normale. La liberté du commerce est un sain principe mais dans le cas des banques, on a vu que cette liberté peut être dévoyée et ruiner des milliers d’épargnants. On a vu aussi que contraindre les banques à respecter des règles de gestion avait le mérite de mettre leurs clients à l’abri contre les fraudes et escroqueries diverses. On a vu que l’obligation de porter des fonds propres à un niveau suffisant non seulement protégeait les économies nationales contre les risques macro-économiques des défaillances de banque mais aussi conférait une garantie contre les risques de pertes subies par leur clientèle.
Deuxième partie : les vieilles banques à la manœuvre
On a insisté dans la première partie sur le caractère souvent fictif des qualités des néo-banques. Il faut maintenant s’interroger sur leurs rapports avec les vieilles banques et les ambiguïtés qu’ils comportent.
Quelques doutes sur la disruption des néo-banques
S’agit-il ici de défendre « les institutions » contre les néo-banquiers ? En vérité, il faut rappeler que l’innovation dont se réclament ces derniers est très relative : les virements sont faits à une vitesse accélérée ? Tant mieux ! Mais comme le faisait remarquer un régulateur : encore faut-il que le donneur d’ordre soit lui-même à la hauteur de la technicité de l’opération. Lorsqu’il s’agit de 50 euros, l’erreur n’est pas trop grave…. On parle d’innovation, mais, à un moment, lorsque la néo-banque devra exécuter les ordres de son client, usant de la monnaie émise et garantie par la Banque centrale européenne dans le cas de la zone euro, il faudra bien qu’elle se plie aux exigences de cette dernière quant à l’emploi de cette monnaie. On parle d’innovation mais l’essentiel de l’innovation en matière de paiement revient aux mesures dites SEPA et IBAN mises en place par l’ensemble des banques européennes.
Quant à la protection des utilisateurs, elle n’est pas si assurée. La défaillance, très grave d’une néo-banque allemande Wirecard a montré tous les dangers attachés à ce type d’organisme. Fraude, malversation, trucage des comptes, système informatique défaillant et obsolète. La fintech allemande a rassemblé toutes les tares comptables et financières qui auraient parfaitement illustré les escroqueries de la « banquière » Emma Eckhert, en France, au lendemain de la 1ère guerre mondiale. Un peu après Wirecard, c’est une plateforme de microcrédit allemande, Monedo, qui faisait la une de la presse spécialisée. En Angleterre, c’est Ipango, qui a déposé son bilan. Parmi les causes : une insuffisance de fonds de roulement. En mots moins choisis, des fonds propres inexistants alors qu’à la base, la vraie garantie des clients repose sur l’importance de ces derniers.
La réponse à ces risques ? L’une est simple : leur rachat par les banques établies ?
Les Néo-banques, des poissons-pilotes ?
Ces opérations sont nombreuses, une des plus marquantes en France fut le rachat de « compte Nickel » par Paribas.
Combien de néo-banques ont été créées dans un pur contexte de pures start-ups de la Finance ? ou dit autrement, combien sont de « pure players » ? cette question ne présente pas beaucoup d’intérêt pour deux raisons : des néo-banques lancées comme de véritable start-ups quand elles réussissent deviennent la proie des « vieilles banques ». Leurs initiateurs les cèdent volontiers parce qu’ils se rendent compte qu’un développement à marche forcée dans un milieu hypercompétitif va vite excéder leurs moyens financiers mais aussi humains et organisationnels. Deuxième raison : certaines de ces start-ups sont portées en avant par les « vieux acteurs » et en tirent ressources humaines et technologiques. Parfois elles permettent à ces vieux acteurs d’aller tester des formules sur le marché. Leurs « parrains » auront alors deux options. La première sera d’internaliser les solutions trouvées par les start-ups et de leur offre on line, la seconde, si le succès est vraiment très fort sera de les laisser se développer pour attaquer un segment de marché qui ne leur était pas accessible pour des raisons psychologiques ou culturelles : les jeunes qui ne veulent plus entendre parler des banques traditionnelles et qui veulent du neuf, des services qui leurs ressemblent, des langages qu’ils comprennent.
On peut multiplier les exemples : on a donné en exergue de cette section l’exemple de BNP-Paribas qui s’est rapidement portée acquéreur du « compte nickel ». On peut prendre l’exemple de la Société Générale qui a multiplié les partenariats et les rachats.
Elle est même allée jusqu’à prendre le contrôle d’une plateforme de services aux neo-banques : Treezor, qui permet à ceux qui veulent créer leur banque de s’appuyer sur tous les services comptables, juridiques, règlementaires utiles. Elle a acquis un des vétérans de la banque en ligne : Boursorama bank. Elle a lancé plus récemment une neo-banque : « Shine » « Grâce à Shine, les indépendants peuvent par exemple créer leur activité, créer leur statut de micro-entrepreneur et gérer tout un tas de démarches administratives dont notamment la facturation ». Dans le même esprit on trouve Prismea, la néo-banque du Crédit du Nord , filiale aussi de la Société Générale, à destination des professionnels.
Les néo-banques sont-elles dans ces conditions pour les vieilles banques un moyen élégant de résoudre le problème : trop de cols blancs, remplaçons les par des robots ? où des avancées que les banques préfèrent voir venir de l’extérieur ou des initiatives qu’elles préfèrent externaliser avant de leur donner tout leur lustre en les réinternalisant ?
La compétition est ouverte. Le vrai juge de paix se trouvera dans la capacité à traiter du crédit aux entreprises et de gérer en masse les prêts aux particuliers.
Banques de groupe (paru dans la Revue Banque)
C’est vieux comme les entreprises : les trésoreries solides, abondantes voire pléthoriques, suscitent inévitablement de la part des trésoriers (ou des directeurs financiers selon les organigrammes), la question de leur affectation ; ici on entend par trésorerie les actifs mobilisables à très court terme, les créances à échéances très courtes, les dépôts à vue ou à terme très brefs ; c’est de l’argent cash résumera-t-on et il s’agit de faire en sorte qu’il participe à la formation de l’excédent brut d’exploitation de l’entreprise. Il s’agit aussi qu’il ne soit pas perdu dans des placements aventureux.
Dans une étude réalisée il y a quelques temps par l'agence de cotation Moody’s, les cinq premiers « rois de la trésorerie » étaient Apple, Microsoft, Cisco Systems, Google et Pfizer qui ensemble détiennent 276 milliards de dollars, soit 22% du bilan de trésorerie des entreprises américaines non financières sur un total de plus de 1200 milliards. Sommes considérables qui déclenchent chez les intéressés des stratégies variées de protection et de valorisation. Pour ce qui concerne les premières, c’est à une sorte d’inversion de la problématique du risque que l’on assiste : ce n’est plus le banquier qui s’intéresse de façon sourcilleuse aux risques que présente le client mais le client qui demande au banquier de justifier de la solidité de son bilan : après tout un dépôt en banque c’est une créance sur elle. Il ne faudrait pas en déduire que seule la question du risque que présente la banque se pose lorsque de pareilles masses de trésorerie sont en jeu. D’autres questions sont bien au centre du débat, dont les conditions de la meilleure rémunération de ces sommes considérables.
Il y a bien longtemps, on se contentera de remonter au XIXème siècle, la question de l’emploi des trésoreries n’était pas si simple, elles étaient constituées bien souvent de billets de banque centrale (quand il y avait une banque centrale, ce qui n’était pas le cas aux Etats-Unis) ou d’or. Une des formules pour tirer parti de ces ressources consistait à les prêter sous forme de crédits fournisseurs rallongés aux clients de l’entreprise. Les bons trésoriers se reconnaissaient au bon choix des débiteurs. Les bons débiteurs obtenaient de bons taux. Et pour les prêteurs, c’était toujours mieux que rien. Il existait un marché de la lettre de change ou du billet à ordre, qui revenait à faire des entreprises à trésoreries larges, de véritables financiers. Certaines d’entre elles décidèrent d’en faire leur métier. L’activité industrielle ou commerciale séparée de la partie financière, cette dernière pouvait mener sa vie de banque plaçant la trésorerie de l’entreprise, puis celles d’autres entreprises et enfin prenant totalement son indépendance.
Il n’est donc pas très nouveau qu’un groupe industriel ou commercial en vienne à créer une banque en son sein. La crise de 2008 a mis en lumière leur utilisation dans le contexte très particulier des menaces qui se mirent à planer au-dessus des banques et des systèmes bancaires. Les banques de groupe sont alors redevenues à la mode avec des objectifs souvent restreints de sécurité. En revanche, sont moins nouvelles ces banques qui, totalement intégrées à un groupe, ne sont pas nécessairement conçues pour gérer la trésorerie de l’ensemble d’entreprises auxquelles elles appartiennent. Leurs missions sont plus larges et leurs problématiques plus proches des banques traditionnelles que de pures banques de trésoreries.
1) Gérer et faire prospérer la trésorerie d’un groupe.
Lorsqu’un groupe est «liquide», c’est-à-dire qu’il dispose d’une trésorerie abondante à court et moyen terme, soit parce que son exploitation est bénéficiaire, soit parce que son cycle d’affaires crée de la trésorerie, la tentation est grande de rassembler les ressources de l’ensemble des membres du groupe dans une banque «sœur» ou «fille» et de les gérer comme une banque externe l’aurait fait… à son profit.
Au centre de la trésorerie des Groupes
Les très grandes entreprises peuvent détenir des encaisses liquides (trésorerie, placements monétaires) atteignant des niveaux très élevés. Il en résulte qu’elles sont confrontées très directement, et pour des montants parfois considérables, (voir plus haut la liquidité des entreprises américaines) au risque de défaillance des banques dans lesquelles elles entretiennent leurs comptes. Créer une banque de trésorerie à l’intérieur d’un groupe permet à ce dernier de réduire les dépôts et comptes financiers qu’il détient dans les banques extérieures et de cantonner ses risques.
Ces banques ont porté des noms divers : banque de trésorerie étant le plus banal. On trouve moins souvent le nom du groupe associé au mot banque : banque Siemens, banque Renault ou autres. Elles ont été constituées soit par scissiparité soit par le rachat d’une banque déjà existante.
Deux exemples illustreront les deux mécanismes : un exemple frappant est fourni par la Banque Thomson créée à partir du département de trésorerie du groupe Thomson alors important fournisseur de solutions militaires. Il faut remonter à 1984 quand Thomson remporta un énorme contrat pour la vente de missiles sol-air crotal pour un montant de 35 milliards de francs dont une bonne partie sous forme d’acomptes. Thomson Credit International fut lancé à cette occasion et dirigé par Thomson CSF Finance, sous la houlette du trésorier de Thomson.
Un autre exemple est « topique » : la création de la Banque du groupe EADS aussi nommée « Banque Airbus ». Airbus Group a annoncé début 2014 l’acquisition de la Salzburg München Bank. Cette petite banque installée à Munich, servira du pivot financier pour le groupe, tant au niveau trésorerie que pour le financement des activités du groupe.
D’autres exemples : Siemens, qui détient une banque de groupe a fait grand-bruit il y a peu (2012) en transférant des dépôts sur les comptes d’une grande banque française pour les placer dans sa banque de groupe, laquelle entendait placer ces liquidités à la BCE.
La crise et la nouvelle donne des banques de groupe
Cette manifestation de défiance de Siemens à l’égard d’une très grande banque avait été « diversement appréciée ». Caricatural effet collatéral de la crise de la dette souveraine, cette opération de trésorerie répondait aux menaces qu’elle a fait peser sur la réputation des banques européennes. N’allaient-elles pas subir des pertes considérables sur les dettes grecques, puis espagnoles, italiennes etc ? N’étaient-elles donc pas en risque ? Après tout, en 2012, l’histoire récente avait résonné du fracas des faillites bancaires et des nationalisations en catastrophe. Peu de pays en avaient réchappé. Siemens, revivifiant sa banque de Groupe, procédait en fait avec prudence tout en intégrant dans sa politique de gestion de trésorerie une donnée nouvelle : l’évolution de la politique de refinancement des banques menées par la Banque Centrale Européenne.
Protéger le « cash du Groupe » et accéder au nouveau « guichet » de financement des banques de la BCE font aussi partie des objectifs d’Airbus Group Bank. Cette volonté de protéger son cash a pris évidemment une tournure particulière avec la contraction de la liquidité interbancaire en Europe. L’asséchement des marchés de la liquidité a été la conséquence directe des risques que la crise de la dette souveraine a fait courir aux clients des banques !!! Ici, la particularité a tenu au fait que les banques se méfiaient des banques et préféraient déposer leurs excédents de liquidité à la BCE. Donc la boucle était bouclée : les grandes entreprises voyaient s’effondrer la considération qu’elles avaient pour la solidité de leurs banques et les banques entre elles laissaient planer des doutes sur l’idée qu’elles avaient de leur solidité !
La BCE est devenue le havre de paix des dépôts. Des banques de toute nature et les banques de groupe en général viennent y déposer leurs ressources en raison de la défiance entretenue vis-à-vis de leurs consœurs. La Banque Centrale Européenne, leur offre justement cette tranquillité. Au surplus, sa politique de refinancement des banques a permis aux grands groupes d’obtenir des ressources dans des conditions très avantageuses.
Les banques de groupe au service… de leurs groupes
Ce type de banques de groupe, se substitue totalement ou partiellement aux banques « classiques » et en vient à se positionner comme des fournisseurs bancaires « classique » pour certaines ou pour toutes les filiales. Leur mission est, tout en leur ouvrant un éventail de produits financiers et bancaires, de leur simplifier l’existence, de raccourcir les délais de décisions et de rabattre les conditions de vente des produits ou des taux d’intérêts des prêts qu’elles consentent. Les domaines les plus classiques sont la gestion des achats de devises, la compensation des achats et des ventes internes, la coordination des mouvements de trésorerie le tout en affichant une volonté claire d’abaissement des prix (taux d’intérêts et commissions).
Pour autant ce n’est pas parce que les trésoreries concernées sont importantes que les banques de groupe se plaisent à évincer leurs banques « classiques » des financements et des placements des sociétés du groupe ! Les banques de groupes jouent un rôle d’aiguillon vis-à-vis des banquiers partenaires. Elles ne recherchent pas, dans ces conditions, le monopole des opérations de groupe et n’en traitent qu’une partie. Les masses de financement requises, les ressources qu’elles mobilisent, les compétences tant humaines que techniques dont la mise en œuvre efficace leur imposent de recourir à des professionnels, à des banquiers justement !!! Mais il est vrai aussi, que participant aux phases essentielles de l’étude, de la négociation et de la mise en place des opérations bancaires et financières, elles sont à même d’en mieux cerner les coûts de production et les frais.
Pour finir sur cet aspect de la « Banque de Groupe », il faut considérer le cas des Groupes qui adossent leurs banques sur une association avec une ou plusieurs autres banques classiques, celles qui ne font que de la banque. C’est une stratégie qu’on voit décliner un peu partout. Elle a un énorme avantage, le Groupe industriel ou commercial s’appuie sur des professionnels pour monter une activité dont tout dans l’histoire financière et bancaire indique qu’il est dangereux de la confier à des amateurs. Gains de temps pour la formation des hommes et l’acquisition de compétences, gains d’argent en ne cherchant pas à réinventer la roue du côté des technologies bancaires et des moyens de paiement, gain aussi de crédibilité vis-à-vis des régulateurs et des banques centrales. Jusqu’où ce genre d’association peut-il aller ? En fait, la limite ultime est la pratique de la marque commerciale. Un groupe industriel ou commercial tenté par le fait d’intégrer des services bancaires mais désireux surtout de s’épargner tous les inconvénients qui accompagnent le fonctionnement des banques, la collecte de l’épargne et l’octroi de crédits, passe un accord avec une banque qui, sous sa marque, lui fournira les mêmes services qu’elle fournit à sa propre clientèle. Il ne restera au groupe en question qu’à commercialiser cette marque, à la vendre en interne et à l’égard de la clientèle du groupe.
On voit ainsi que les banques de groupe peuvent fournir des prestations de services financiers et jouer un rôle de conseil, coordinateur et filtre vis-à-vis des membres du groupe pour leurs programmes d’investissement et de financement et se comporter à l’instar des banques et établissements de crédits classiques: il arrive même que ce comportement les conduisent à créer de véritables banques classiques avec livret d’épargne, comptes de dépôts, assurances, et cartes de paiements ou de crédits….
2) Quand les Banques de Groupe sont des banques pures et simples !
On vient de décrire une modalité qu’on a qualifiée de « logique des banques » de groupe, celle qui s’appuie sur les grandes masses de la trésorerie. On vient aussi de montrer que les grands groupes ont des logiques de protection de leurs ressources qui peuvent les conduire à monter des banques gérées selon leurs propres principes de précaution.
Faire ce que les banques ne veulent pas faire
Les grands groupes peuvent aussi être tentés par la mise en place de banques qui « collent » avec le profil, voire les profils, de leur clientèle, ses besoins financiers, ses particularités économiques et sociales. L’idée est alors, soit de profiter de l’existence d’un très grand portefeuille de clientèle pour en faire un atout dans une offre de services financiers et bancaires, soit de fournir à cette clientèle ce qui lui manque pour être le consommateur dont rêve le Grand groupe.
Dans ce dernier cas, la tentation du Groupe est, constatant une sorte de carence bancaire, de se substituer à une offre bancaire insuffisante, tatillonne ou fragmentée et à faire le banquier à la place du banquier. Bien sûr ce ne sera pas dit de cette façon mais, dans la réalité des faits, c’est bien ce qui s’est souvent passé. Rappelons qu’en France le crédit à la consommation tel qu’il est maintenant pratiqué était quasiment absent de l’offre bancaire aux particuliers jusque dans les années 1960-1970… les fabricants de voiture, d’équipements ménagers, les circuits de distribution des biens de consommation avaient donc le choix : ou bien ils attendaient que les banques veuillent bien s’intéresser à la question ou bien ils se substituaient à elles, proposant leur propre offre avec leurs propres structures juridiques.
L’histoire maintenant un peu lointaine en montre des exemples : la société française Thomson-Houston, créée en 1893 par le groupe américain du même nom (devenu depuis General Electric), lance en 1925 la société de crédit à la consommation, le Credit Electrique (depuis Crédit électrique et gazier, CREG) dont l’objet est de fournir des services financiers pour l’achat, vente, location, financement d'appareils utilisant, transportant, produisant le courant électrique, les gaz d'éclairage et de chauffage. Il sera racheté en 1983 par Valorind (Groupe Société Générale).
La Régie Renault aurait été à l’origine de la technique du crédit différé pour permettre la diffusion à grande échelle de son modèle populaire « la 4 chevaux » : à une époque où l’argent, le crédit …et les automobiles étaient rares, la « Régie » avait créé un établissement qui proposait des plans d’épargne aux acquéreurs d’automobiles Renault, lesquels à leur échéance donnaient droit à la mise en place d’un prêt pour acquérir une… Renault.
Ces organismes de crédit qu’on trouve partout où il y a de la consommation, partout où œuvrent de grands groupes de distribution, par correspondance ou non, se sont longtemps substitué aux banques pour qui ces activités n’étaient pas attrayantes ou suffisamment rentables. Ce type de banque demeure très actif tant en France que dans les autres pays occidentaux. Non seulement, elles offrent une palette de prêts à la consommation mais elles ont aussi lancé des plans d’épargne, des cartes de crédit avec succès. Renault a récemment relancé cette activité. Volkswagen et General Motors manient des montants considérables.
Les banques de groupe, des banques comme les autres ?
« Diac, filiale française du groupe RCI Banque… Des formules de financements classiques à de nouvelles solutions pour suivre l’évolution des besoins des automobilistes, Diac est à l'origine de nombreux produits et services dans un objectif simple : la satisfaction de ses clients. Découvrez notre gamme de produits : Financement, Assurances, Services »….
Cet extrait d’un petit texte publicitaire de l’organisme de crédit à la consommation du groupe Renault donne le « la » en matière de financements organisés et déployés par un industriel en faveur de sa clientèle. S’ensuivent les informations suivantes :
« Filiale créée et détenue à 100% par le Groupe Renault, RCI BANQUE est une Banque Française spécialisée dans les financements et services automobiles pour les Clients et Réseaux du Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) dans le monde et du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti) principalement en Europe et en Amérique du Sud ».
« RCI Banque en quelques chiffres (au 31/12/2013): plus de 2,5 millions de clients en portefeuille, 1 160 612 nouveaux dossiers financés, 24,2 milliards d'encours productifs moyens ».
Mais on doit aller un peu plus loin : les banques des groupes industriels sont aussi des collecteurs de ressources et se comportent à l’égard de leur future et actuelle clientèle, comme des banques classiques, qu’elles soient mutualistes ou non, en proposant des produits et des services identiques.
Evoquant un livret d’épargne, dans l’esprit du « Zesto » du groupe Renault mis à disposition des particuliers qu’ils soient ou non clients, un dirigeant de la Banque PSA indiquait qu’elle «emboîte ainsi le pas à d'autres constructeurs ». Bien sûr ajoutait-il "Ce n'est pas absolument essentiel, en termes de montant, au financement de Banque PSA Finance, mais c'est un appoint important qui conforte aussi le statut bancaire de Banque PSA Finance, qui a son tour lui permet de se refinancer par exemple à la Banque centrale européenne (BCE)".
Il se montrait modeste, voire « low profile » par rapport à Renault qui indiquait : « D’ici fin 2015, le montant des dépôts devraient représenter entre 20 et 25% des encours de RCI Banque ». Et de chanter les mérites du livret ZESTO, un produit d’épargne sécurisé et rémunéré à des taux parmi les plus compétitifs du marché ainsi que du compte Pépito.
Ces publicités ou informations publicitaires ne paraissent pas venir d’un industriel de l’automobile mais d’une vraie banque. On dira qu’il manque pour que l’illusion soit complète une proposition sur des placements en valeurs mobilières… en achats d’actions Renault, Peugeot, ou Casino, ou Gdf-Suez !!! Cette idée paraîtrait surement un peu décalée : les risques de conflits d’intérêts seraient considérables.
Les constructeurs français sont-ils originaux ? Que nenni ! Les Allemands font très forts dans ce domaine. Voici ce qu’on peut lire sur la plaquette de présentation de Volkswagen Financial Services AG « … a été fondée en 1994. Filiale de Volkswagen AG, elle est également la holding pour le commerce international des services financiers du Groupe Volkswagen. Présente dans 49 pays, la société Volkswagen Financial Services AG est le plus grand fournisseur de services financiers automobiles en Europe et le 2ème dans le monde ». Volkswagen Bank est la première banque de l'automobile en Europe, en 2012 avait recueilli 22,8 milliards d'euros de dépôts ! (le total de l’actif du groupe mondial est de 309 milliards d’euro).
Il n’y aurait que les fabricants d’automobiles ? Bien sûr que non ! On avait cité plus haut Thomson, on citera Gdf-Suez et Siemens mais aussi les grands distributeurs français que sont Casino et Auchan, et Carrefour etc.
Ces derniers ajoutent à la panoplie classique des services des groupes automobiles, une large palette de services de paiement. Logique ! Ils voient passer des consommateurs journaliers ou hebdomadaires dont les habitudes de consommation et les modes de paiement sont essentiels à connaitre et à faciliter.
3) Faire de la Banque ne serait donc pas si particulier que ça ?
Si on voit bien l’intérêt que de grands groupes peuvent avoir à lancer « leur Banque », voire « leur groupe bancaire », on voit bien aussi sans être grand clerc que ce n’est pas à la portée de n’importe quelle entreprise que de se lancer dans pareille aventure. Faire le banquier peut présenter des avantages mais il se trouve que cela comporte des inconvénients.
Les risques des banques de groupe
Tel qu’on vient de présenter les différents types de banque de groupe, on pourrait conclure, qu’il n’y a là qu’une très grande logique et que l’intégration d’une fonction bancaire au sein d’un groupe n’est que l’effet de sa taille. Plus le groupe est important, plus nombreuses sont ses filiales, plus les opérations commerciales et industrielles intragroupes sont multiples et complexes, plus il parait utile et même nécessaire de créer une banque interne qui sera capable de coordonner, combiner et exploiter les masses d’argent, les échéances et les opérations.
On ne s’étendra pas sur le fait que la participation d’une banque de groupe aux opérations financières et bancaires de ce groupe ne peut pas avoir ni pour effet, ni surtout pour motivation, de faire « passer » des profits d’une société à une autre ! Par exemple : facturer des intérêts très élevés à une société dont on veut faire diminuer les résultats ou, au contraire, minorer le coût d’opérations bancaires pour redonner de bonnes couleurs au compte d’exploitation d’une filiale un peu fragile. Les risques de type conflits d’intérêts, abus de biens sociaux, prix de transferts dérogatoires et manipulation de résultats pèsent sur une banque de groupe comme sur n’importe quel société, filiale, sœur ou maison-mère d’un groupe où les opérations inter-compagnies sont nombreuses. Ignorer ces contraintes serait soit de l’amateurisme soit de l’inconscience pure et simple. On le dit ici sur le ton de l’évidence. Pourtant, il peut être bien malcommode pour un groupe industriel multi-filiale de centraliser de purs flux monétaires intra-groupes ou d’assurer la centralisation des paiements faits par les donneurs d’ordre du groupe et ses clients ou enfin d’assurer les paiements des fournisseurs de l’ensemble des membres du groupe sans prendre le risque qu’on a mentionné plus haut. Faire le banquier même sur la base des choses les plus élémentaires de la vie de banquier : encaisser des créances et en suivre la compensation, décaisser des dettes et s’assurer que les fonds arrivent bien vers le bon destinataire, ne sont pas si simples et mobilisent beaucoup de gens et de technologies dans les banques sans parler des procédures et de la gestion des risques opérationnels ou de contrepartie.
Les banques de groupe présentent des risques bancaires ! Cela paraît être une évidence mais cette évidence a pris ces dernières années pris une dimension particulière : une banque de groupe destinée à financer la clientèle en consentant des prêts à la consommation ou à l’équipement ne dispose pas nécessairement de la part du groupe de ressources suffisantes pour le refinancement de ses activités. Elle s’adresse donc aux marchés, interbancaires, financiers pour trouver les ressources dont elle a besoin. Ses risques sont alors très exactement les risques de toutes les banques : en période de crise, les ressources peuvent se raréfier et, si sa structure de financement n’est pas équilibrée, que sa qualité de risque soit bonne ou non, elle peut se trouver en difficulté et placer le groupe dans une position difficile. C’est arrivé à quelques constructeurs automobiles, il n’y a pas si longtemps.
Enfin, s’il est tentant pour un groupe très créditeur de gérer lui-même sa trésorerie en passant par la création d’une banque, il n’en demeure pas moins, que c’est un nouveau métier qu’il va assumer. La gestion d’une banque a ses particularités, ses contraintes réglementaires, juridiques et informatiques qui n’ont rien à voir avec le fonctionnement d’un groupe industriel ou de services. Les risques pris par les départements d’investment bank ont montré que des opérations ou opérateurs mal supervisés pouvaient provoquer des catastrophes.
Pour compléter ces propos, on se souviendra aussi que créer une banque pour faire ce que les banques traditionnelles ne s’avèrent pas capables de traiter (pendant longtemps, le crédit à la consommation a été un bon exemple) c’est devenir un acteur de l’univers bancaire et jouer le jeu de la concurrence qui y prévaut avec ses contraintes humaines, technologiques et professionnelles (contrôles, risques)… C’est la raison pour laquelle à certains moments critiques de leur existence les groupes n’hésitent pas à revendre ces activités !
Enfin, et non le moindre, certaines entreprises de taille multinationale qui disposaient de banques de trésorerie intra-groupes se sont aperçues que leurs dépôts souvent considérables dans ces banques atterrissaient finalement … dans les banques traditionnelles. Ce n’est pas parce qu’un groupe dispose d’une banque pour y déposer sa trésorerie qu’il s’affranchit des risques de l’univers bancaire! C’est alors qu’eurent lieu des mouvements de trésorerie considérables : les banques de trésorerie européennes de certains grands groupes s’en furent déposer leurs fonds … à la BCE, comme toute banque affiliée à cette dernière en a le droit. Ce faisant, elles contribuèrent dans des proportions significatives à la détérioration de la liquidité bancaire de la zone Euro !
Assumer les contraintes bancaires
Les grands groupes industriels et commerciaux sont confrontés à des réglementations qui leurs sont propres et qui n’ont rien à voir avec la Banque. L’activité bancaire est non seulement soumise à régulation mais aussi à réglementation, entre façon de faire et garde-fous, il s’agit de prescriptions très spécifiques. Ce sont les fameuses obligations du type Bâle I, II, III. Ce sont les contraintes en fonds propres qui viennent immobiliser des masses de capitaux fort importants. Ce sont les normes prudentielles et les obligations de reporting, la gestion des risques transactionnels.
Gérer un portefeuille de crédit à la consommation, en suivre l’évolution, régler les curseurs de gestion des risques et des conditions d’octroi ne sont pas moins lourds et riches de professionnalisme que la décision d’implanter un centre commercial et d’en assurer une gestion profitable. Recruter des fonds en provenance du public sous la forme de livrets d’épargne, de comptes de dépôts est une bonne chose et peut, l’exemple de Renault et de Volkswagen le montre, représenter des sommes très importantes et une source de refinancement non négligeable : tout autant que les banques classiques, les banques de groupe qui assument ces fonctions sont astreintes aux mêmes règles prudentielles et aux mêmes obligation pour ce qui touche à la protection de l’épargne et à l’assurance des dépôts.
Evidemment, parce que la banque est une activité économique soumise elle aussi à des effets de taille, quelle que soit la taille du groupe industriel, la fonction bancaire qui est développée en interne sera soumise à la concurrence des banques classiques et devra s’aligner sur leurs conditions économiques de travail.
Tout ceci est du ressort de la banalité : quand on veut exercer le métier du voisin, il ne suffit pas de chanter que c’est facile et qu’il ne tient qu’à l’imiter ! A la fin des années 80, quelques banquiers avaient oublié que l’immobilier est un métier de professionnel et s’étaient lancé dans des aventures cuisantes. Si elle est mal conçue, « l’aventure de la Banque » qui saisirait un groupe non bancaire, peut s’avérer fort coûteuse.
Un dernier point, qui n’a pas grand-chose à voir avec la banque doit être aussi souligné : les groupes spécialisés dans des activités industrielles spécialisées ou ne couvrant qu’un champ étroit de l’activité économique peuvent induire des risques directs et indirects via leur activité bancaire. De fait, lorsque Volkswagen draîne l’épargne allemande ou européenne, il s’agit bien de financer ses activités de fabricant et de vendeur d’automobiles. On ne peut pas ne pas soulever la question de la pertinence de ce « drainage » de capitaux sur un plan macro-économique. Est-il opportun de laisser une industrie actuellement puissante et au faîte de sa réussite, orienter une partie de l’épargne vers elle ? Ne serait-il pas plus judicieux d’orienter l’épargne vers les nouveaux secteurs, ceux qui représentent l’avenir économique ? Vieux débat. De la même façon que la collecte des capitaux sur une base locale conduit à des distorsions au détriment même des zones de collectes, de la même façon, une collecte de capitaux sur une base professionnelle, industrielle ou commerciale aboutit à une segmentation de l’épargne dont l’efficacité n’est absolument pas assurée.
La création de banques de groupe on l’a vu dépend d’une très large variété de facteurs, selon que les circonstances mettent le système bancaire classique en cause et poussent les entreprises riches en liquidité à chercher des parades, selon que le système bancaire classique ne répond pas aux besoins de la clientèle ou des fournisseurs des groupes concernés. Il demeure qu’une fois, ces opérations lancées, le poids des risques, des réglementations et des investissements technologiques contribuent à déplacer le curseur de l’intérêt à créer ces banques et que les circonstances qui les ont fait apparaître disparaissant la légitimité de ces banques en vient à être discutée : les établissements sont alors soit revendus aux banques classiques, soit ancrés dans des partenariats avec ces banques.
Toutefois il ne faut pas manquer de relever une évolution rare, mais pleinement illustrée par le groupe General Electric : la banque de groupe évolue progressivement vers une activité à part entière dans le groupe. En somme, elle est un centre de profit parmi d’autres et mène ses activités selon ses propres règles et ses propres plans d’activité. La banque de groupe devient alors une banque classique dont la stratégie est propre et se cale sur les objectifs qui avait prévalus à sa naissance : servir un groupe dans l’ensemble de ses problématiques financières et commerciales.
Bad Banks
C’est amusant de commencer la lettre B avec l’expression « bad bank ». C’est peut-être un signe des temps. Dans un manuel, même désenchanté de la Finance et de la Banque, qui ne cherche pas à jouer avec l’ordre des lettres et, au sein de l’ordre des lettres, l’ordre des mots, il est symbolique que le premier adjectif associé au mot « bank », ou « Banque », soit le mot « Bad ».
Allons ! C’est de l’humour un peu outré. Dire d’une Banque qu’elle est « bad », ce n’est pas caractériser les Banques. Quand on veut parler des Banques, on dit « les Banques », et si on parle de « bad bank » c’est qu’on veut évoquer une catégorie à part dans l’ensemble « les Banques
Les « bad banks » sont apparues lors de la déroute des caisses d’épargne Américaines, dans les années 80. Elles s’étaient lancées dans des placements aventureux qui leur procuraient des intérêts sans commune mesure avec ce qu’elles pouvaient obtenir en plaçant dans les bons du trésor américain ou en souscrivant les obligations émises par les grandes entreprises cotées au Dow Jones. C’est la fameuse époque de la Finance triomphante (aux USA, il faut se méfier des triomphes de la finance car les catastrophes ne sont pas loin) et des junk bonds.
Les caisses d’épargne se mirent à prêter à guichet ouvert à des entreprises de plus en plus risquées. Un retournement de conjoncture après, elles se retrouvèrent dans leur grande majorité en faillite, obligeant le gouvernement américain à intervenir massivement pour les remettre d’aplomb. Ce faisant, il leur fut imposé de céder leurs « actifs pourris » à une structure juridique « ad hoc » (special vehicle) dont la mission fut de recouvrer tout l’argent possible de ces actifs. Cette structure fut nommée « structure de defeasance » au sens où elle permettait aux caisses d’épargne de se défaire d’actifs qui les conduisaient vers la faillite. Pour que tout le monde comprenne, l’expression structure de defeasance fleurant bon le langage d’initié, c'est-à-dire l’obscurité, on inventa l’expression « bad banks ». Les journalistes pouvaient comprendre de quoi on parlait et les commentaires pouvaient fleurir avec toutes les nuances morales dont on aime les assortir quand il s’agit de la Banque et des banquiers.
Donc une « bad bank » n’est pas une mauvaise Banque et ce serait un grave contre-sens de le penser, c’est une entité juridique qui est constituée par transferts d’actifs décotés ou pourris dans le but 1) de décharger, (dépolluer ) les bilans des Banques, établissements financiers etc. 2) d’en tirer le meilleur parti possible dans les meilleurs délais possibles sans pour autant opérer dans une précipitation qui n’aurait pour résultat que d’en aggraver les décotes ou le pourrissement.3) on pourrait terminer par : « et de disparaître le plus vite possible » !
Le terme a pris un relief particulier en France, au début des années 90, quand la crise économique frappa l’ensemble de l’économie. De nombreuses Banques qui s’étaient engagées dans des Financements immobiliers aventureux ou étaient intervenues massivement dans des opérations industrielles et commerciales à fort effets de levier, furent emportées dans la tempête. La plus célèbre, le Crédit Lyonnais, dut sa survie à la création d’une structure « de defeasance » , « une bad bank » nommée CDR (Consortium De Réalisation). Cette dernière recueillit en quantité des actifs pourris du Crédit Lyonnais et de bons nombre de ses filiales.
La crise de 2008, a conduit de nombreux systèmes financiers à se lancer dans ces opérations de création de bad banks. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Pourtant ce mouvement a été inégalement approuvé et fait l’objet de nombreuses réticences et de longs débats.
Des pays comme l’Allemagne dont de très nombreuses Banques à vocation immobilière se sont retrouvées à deux doigts de la faillite, n’ont pas voulu, recourir systématiquement à cette méthode.Les caisses d’épargne allemandes ont fait de l’obstruction au processus de sauvetage des Landesbanken, dont elles étaient coactionnaires aux côtés des États régionaux. En définitive, les opérations ont été menées avec des sociétés créées pour la circonstance sous la garantie de l’Etat Fédéral, avec ventes d’actifs immobiliers américains à la clef. Il n’y avait pourtant pas que des créances immobilières ! Un des aspects les plus savoureux de la création de « bad banks » en Allemagne réside aujourd’hui dans la « question grecque ». La FMS Wertmanagement en charge des créances « toxiques » d'Hypo Real Estate (HRE) lorsque cette dernière, totalement effondrée, fut nationalisée, a trouvé dans la « corbeille » non seulement des créances de nature immobilière, structurée ou non, mais aussi avec des créances grecques ! Pour le seul portefeuille tiré de HRE, l’encours atteignait 8,76 milliards d'euros. Ces créances sont-elles pires que ce qu’on qualifiait de « toxique » en pensant à l’immobilier ? En tout état de cause, il semblerait qu’environ 50% des « encours grecse entre les mains allemandes soient détenues par des structures de defeasance de type bad banks.
En Irlande, après de nombreux débats et des discussions houleuses avec les membres de la Zone Euro, les pouvoirs publics ont finalement monté une structure « bad bank ». L’Ireland’s National Asset Management Agency. Objectif: débarrasser les banques irlandaises de leurs prêts immobiliers et “promoteurs” et restaurer la confiance du public. La bagatelle de 81 milliards d’euros d’encours de crédit est concernée et transférés pour une valeur de 40.5 milliards, soit une décote de 50% !
En France, le problème ne s’est pas posé, de même qu’en Italie. Pourtant, le cas de la Banque franco-belge Dexia est souvent revenu sur le devant de la scène. Largement prêteuse de crédits aux collectivités locales (dont les méchantes langues disent qu’ils sont souvent toxiques), Dexia a souvent été « candidate » à la scission de son portefeuille de créances entre une bonne banque et une « Bad Bank ». La question n’est pas simple : la banque étant « franco-belge » la question est de répartir les risques et les pertes entre les deux pays !
C’est aux Etats Unis et en Angleterre que le sujet a été le plus amplement débattu. Les Anglais, l’ont résolu en nationalisant leurs principales Banques et en les contraignant à céder leur actifs décotés ou douteux. Dans ces conditions, il n’était plus nécessaire de créer des « bad banks ». Quant aux USA, la question est devenue complexe, un mélange de création de Bad banks et de prise de participation par l’Etat dans les plus grosses banques a été mis en place sous le nom de TARP. La Federal Reserve s’est aussi lancée dans un lourd programme d’acquisition d’obligations privées…les mesures non conventionnelles ce qui lui a valu le surnom de plus grande bad bank du monde !!!
En Europe, une dimension nouvelle est apparue avec la question des dettes souveraines. La démission de l’économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, Jürgen Stark, après celle d’un représentant de la Bundesbank, soulignait l’hostilité de certains pays européens face à la politique de la BCE. Ceux-ci accusent les programmes d’achats d’obligations publiques Grecques, Espagnoles, Portugaises et Italiennes de transformer la BCE en …bad bank. Et de lui faire prendre le chemin de la FED.
Banque Centrale Européenne
Au centre de la plus grave crise monétaire depuis la crise de 1929, la Banque Centrale Européenne a su « outrepasser » les missions définies de façon très restrictive par ses statuts et contribuer à éviter une propagation de la crise bancaire américaine en 2008 et d’éviter qu’elle dégénère en crise bancaire systémique.
La Banque centrale Européenne (BCE) est entrée en force le 1er janvier 1999 lorsqu’à cette date les banques centrales de la Zone Euro lui ont transféré leurs compétences monétaires. Elle a, par le traité qui la fonde la personnalité morale. Dotée d’un capital social s’élevant à 10 760 652 402,58 euros, depuis qu’en décembre 2010, une augmentation de capital de 5 milliards d’Euro a été approuvée. Son capital est détenu par les banques centrales de l’Union Européenne y compris, par conséquent, les banques centrales dites « hors Eurozone ». Ces dernières ne peuvent prétendre aux bénéfices de la BCE, ni en assumer les pertes. Les membres « Eurozone », onze au départ, sont devenus 17 au fur et à mesure de l’entrée de nouveaux pays, et de l’Estonie en dernier lieu (janvier 2011). Les trois principaux pays de l’Eurozone, l’Allemagne, la France et l’Italie sont les actionnaires les plus lourds et représentent prés de 45% du capital. La dernière augmentation de capital avait pour objectif de mettre le capital de l’institution en harmonie avec les opérations de prêts et d’achats de dettes souveraines lancées dans les mois qui précédaient.
Les pays de l’Union Européenne qui ne font pas partie de la Zone euro définissent indépendamment de la BCE le taux de conversion de leur monnaie par rapport à l’Euro et le niveau des taux d’intérêts dans leur zone de compétence. Ils participent néanmoins à l’Eurosystéme et sont membres d’un organe de coordination qui a pour but d’assurer que l’ensemble des banques centrales européennes dispose d’un moyen institutionnalisé d’échange d’informations, le SEBC (système européen des banques centrales).
Dirigée par un Directoire de 6 membres, tous dirigeants de banques centrales, dont le président de la BCE, le maître-mot de sa gouvernance est « indépendance ». Les décisions prises par la BCE, ne peuvent en aucune façon refléter la politique ou les volontés d’un quelconque membre de l’Eurozone, quand bien même la BCE, par son Président ou es-qualité, serait membre de droit de nombreux comités et commissions fonctionnant dans l’univers de l’Union Européenne. Cette indépendance s’exprime par l’ensemble des moyens dont elle dispose pour exercer ses missions, en particulier sa capacité d’intervention sur les marchés interbancaires et sur les marchés des changes pour réguler l’émission de monnaie dont elle a la totale responsabilité et les taux d’intérêts directeurs des marchés monétaires et financiers. Elle détient les réserves de changes de l’eurozone et les gère. Enfin, comme toute banque centrale, elle s’assure du bon fonctionnement des moyens de paiement et a, seule, la responsabilité de l’émission de monnaie fiduciaire en Euro…. dont elle a délégué la gestion matérielle, qu’il s’agisse de l’émission des nouvelles coupures ou du retrait des coupures usagées aux banques centrales.
En mars 2011, la BCE a lancé un avertissement aux marchés, annonçant le prochain rehaussement de ses taux d’intervention, motivant cette déclaration par les risques de plus en plus marqués d’un retour de l’inflation. C’est en effet la première de ses missions que de veiller sur la valeur de l’Euro et de se faire un rempart contre les risques d’érosion résultant de processus inflationnistes.
Pour autant, la BCE ne s’est pas cantonnée, ces dernières années, dans un rôle d’observateur passif des évènements économiques, bien au contraire. Dés décembre 2007, elle décidait d’apporter près de 350 milliards d’euro aux banques de l’Eurozone pour faire face aux premiers signes d’une crise de liquidité que l’effondrement du marché des subprimes avait déclenchée. La durée de cette opération « coup de poing » devait n’être que de deux semaines. Quelques mois plus tard, la faillite de Lehman Brothers désorganisait totalement les circuits et les marchés interbancaires. La BCE se trouvait dans cette situation où les banques européennes créditrices venaient déposer leurs fonds chez elle, se refusant à prêter à leurs consœurs débitrices. C’est ce qui la conduisit à lancer, pour des volumes illimités, des opérations de refinancement à trois mois, appuyées sur des titres et des créances remises en garantie. Ces dernières qui ont atteint jusqu’à 2000 milliards d’euros étaient très largement supérieures aux besoins et à l’utilisation des facilités de la BCE, mais donnaient une indication forte de la situation d’illiquidité du marché interbancaire. Ouvrant ses guichets aux banques débitrices elle leur permit d’avoir recours à la monnaie banque centrale de façon illimitée. Ces opérations, qui étaient censées revenir, dans le courant du premier trimestre 2011, à un niveau plus normal tant en termes de modalités financières qu’en termes de volume, furent maintenues en raison de la crise de la dette souveraine et, en particulier, celle de l’Irlande.
La crise de la « dette souveraine », qui dure encore, a donné lieu à un deuxième type d’intervention, cette fois-ci moins « orthodoxe » de la BCE. Face à l’incapacité de la Grèce à faire face aux problèmes nés de son endettement et de la dégradation par les agences de notation de sa cote de crédit, la BCE, dans l’attente des solutions dont l’Eurozone débattait, lança un programme de rachat de dettes souveraines. En mai 2010, c’était un volume d’achat de 67 milliards d’Euro en obligations « Grecques ». Plus tard, la crise Irlandaise éclatant, la BCE fut à nouveau au cœur du débat et toujours dans l’attente de solutions de solidarité européenne achetait sur le marché secondaire de la dette portugaise et irlandaise. Annonçant qu’elle procéderait par « paquets » de 100 millions d’euros. En début 2011, les accords entre pays européens pour doter le fonds européen de stabilisation financière devrait contribuer à faire revenir ces diverses interventions dans des conditions et des limites plus classiques.
Banques de second rang
Les systèmes bancaires c’est comme les armées, il y a des hiérarchies strictes. Dans le cas des systèmes bancaires cette hiérarchie est commandée par la plus ou moins grande proximité de chaque Banque avec la monnaie et son pouvoir libératoire.
Cette remarque vaut aussi pour faire revenir les assureurs et les établissements financiers en tous genres à leur juste mesure : ils n’ont aucune proximité avec la monnaie. Ils ne peuvent et n’ont pas le droit, d’aucune façon, de produire de la monnaie.
Avant de parler des Banques de second rang, on pourrait parler des Banques de premier rang….
La Banque de premier rang….c’est la Banque Centrale. Dans un pays donné, elle a reçu le monopole de l’émission monétaire. Donc, c’est d’elle que vient la seule monnaie qui a cours légal. C’est par elle que se soldent les échanges entre Banques et l’apurement des dettes et des créances nationales et internationales. On qualifie ces opérations d’« opérations de compensation ».
La Banque de second rang est une Banque comme on en trouve à tous les coins de rue. La Société Générale, BNPparibas, etc. sont des Banques de second rang. Elles jouent un rôle déterminant puisqu’elles assurent la gestion des dépôts publics, la création de monnaie scripturale, La gestion des moyens de paiement et l’octroi de crédit.
Les Banques de second rang soldent leurs opérations entre elles par le moyen de leurs comptes ouverts sur les livres de la Banque centrale (de premier rang). Cette opération est qualifiée de compensation.
Quand une Banque de second rang ne peut pas assumer le règlement de son solde de compensation, elle peut demander des facilités à la Banque de premier rang, si c’est dans les attributions de cette dernière. Dans tous les cas de figure, si elle ne peut pas payer et ne peut pas recourir aux prêts de la Banque centrale, elle est en faillite car, les Banques peuvent faire faillite.
Pour terminer : y a-t-il des Banques de troisième rang ? La réponse est, oui, mais dans le domaine national, il y en a de moins en moins. Une Banque de troisième rang est une Banque qui confie ses opérations de compensation à une Banque de second rang. Elle est donc quasiment dans la situation d’un client ordinaire….comme une entreprise qui remet ses chèques et encaisse ses virements, si ce n’est qu’elle est une Banque !!!! En France, la rationalisation du système bancaire, la disparition des petites banques locales et des petits établissements financiers a réduit à peu de choses l’essentiel des banques de troisième rang.
En revanche, de petits établissements d’origine étrangère peuvent éprouver le besoin de faire réaliser leur compensation par une banque de second rang le paiement des chèques émis sur leurs caisses et l’encaissement des valeurs qui leurs sont remis par leurs clients. Il est moins coûteux pour eux de procéder ainsi que de passer de monter un service de caisse, avec le personnel, les systèmes informatiques et comptables indispensables à son fonctionnement. Leur position ne sera pas très différente de celle d’une entreprise comme on l’a vu plus haut.
Banques de l'ombre, shadow banking
Le Président sortant de la Bundesbank, Axel Weber, n’y est pas allé par quatre chemins. Pas de régulation bancaire efficace si on n’inclut pas les banques parallèles dans les projets de régulation relative aux fonds propres des banques, en général, et aux fonds propres des banques à caractère systémique, en particulier.
« Banques Parallèles » ? L’univers bancaire aurait-il cédé aux plaisirs troubles et fantasques de la Science-fiction ? Y-a-t-il, dans le monde financier, des banques qui situées sur des parallèles ne rencontreront jamais leurs consœurs ? Qu’est-ce donc que ce monde parallèle qui serait si intimement présent que le réguler au même titre que l’autre monde est une contrainte incontournable ? La question est d’autant plus aigüe que les banques œuvrant dans ce monde « parallèle » sont aussi qualifiées de « banques de l’ombre ». Ou si on veut s’adonner aux plaisirs de l’anglosaxonnerie « shadow-banking ». N’est-il pas à la fin très inquiétant ce monde de la finance quand on sait qu’aux joies un peu glauques et opaques du Shadow-market et du shadow-trading sur les marchés financiers, on voit se profiler le Shadow-banking…
Cela n’est pas si nouveau. Quelques observateurs de la vie financière et bancaire avaient déjà noté que sous la pression de la financiarisation des économies et de la désintermédiation bancaire, des organismes, d’un genre nouveau étaient apparus. Se cachaient-ils auparavant dans l’ombre marécageuse de quelques mangroves financières ? Il semble bien que non ! Ils seraient nés, et des nouvelles tendances des économies, et de la montée des régulations via la définition de ratios, ceux de Bâle, ceux de Cooke et de Mac Donough et de l’obligation de plus en plus dure de couverture des engagements des banques par les fonds propres.
Le Président de la Bundesbank, étrangement, leur donnait dans une allocution les mêmes fonctions que les banques classiques. Tout au plus les différences résulteraient-elles de l’utilisation de « certaines formes juridiques pour échapper à la réglementation ». En fait, ce ne sont pas du tout des « banques classiques » si on comprend qu’une banque classique a affaire principalement avec les fonctions de circulation, de conservation des encaisses c'est-à-dire des dépôts. elles se rapprocheraient plus de banques d’affaires, si le mot banque demeurait approprié.
Les banques de l’ombre (le shadow banking system) se présentent sous la forme de structures « ad hoc » qui ont été créées par les banques pour porter les actifs qu’elles produisaient et les refinancer sur les marchés financiers. Parmi les « structures » représentatives des Banques parallèles, on trouve les « Hedge funds », investissant dans les actifs produits par les banques et vendus sous la forme ou non des produits financiers, tout en les refinançant par des prêts bancaires ou des émissions d’obligations et titres divers sur les marchés financiers.
Dit de façon un peu simpliste : les banques, produisant des crédits, mais limitées dans leurs activités en raison de contraintes réglementaire (dont ceux venant des accords de Bâle), se sont efforcées, pour maintenir leurs activités, de revendre les actifs ainsi créés, soit en mettant en place des structures ad hoc, soit en les revendant directement à des investisseurs non bancaires. Mis en concurrence, il s’agissait pour elles de satisfaire leur base de clientèle quitte à mettre en place des mécanismes de contournement des régulations et des réglementations sous forme de « banques parallèles » et de produits financiers très complexes. Or, ces non-banques, sans dépôts, sans fonds propres solides, sans contraintes à supporter de la part des régulateurs ont fini par présenter des risques considérables pour les systèmes bancaires et financiers. S’agissait-il de banques au sens formel du terme ? Non, donc elles échappaient à toutes règles comme on vient de l’indiquer. Sur le plan matériel, pourtant… quand une institution, quelle qu’elle soit, décharge une banque des prêts qu’elle a consentis et se trouve à la tête d’un portefeuille de crédit et des risques qu’il comporte, on peut légitimement affirmer qu’elle fait….. le métier de banquier.
Le paradoxe, ici, est que la partie, « véhicules ad hoc », titrisation de portefeuilles de crédits s’est développée à l’initiative même des Banques. Ces véhicules étaient (et sont toujours, quoiqu’en moins grand nombre et avec une moins grand envergure), conçus pour revendre les actifs à des investisseurs ou pour les porter, les parts des véhicules étant placées auprès des investisseurs.
C’est le volet financement de ces opérations qui était le plus fragile et le plus discutable, incluant toutes les garanties offertes ou coordonnées par les banques. Pour rendre les opérations de titrisation séduisantes, les banques s’engageaient à fournir des crédits et des financements aux investisseurs soit sous forme de prêts soit sous forme d’obligations dont elles sponsorisaient l’ émission et qu’elles préfinançaient plus ou moins largement, plus ou moins longtemps. Elles s’engageaient aussi sur la liquidité des investissements, s’engageant, en cas de besoin, soit à reprendre elles-mêmes les portefeuilles, soit à les faire reprendre par des tiers. Souvent, ces banques fournissaient la liquidité à court terme et un engagement de fournir des capitaux longs, quitte à passer des accords avec d’autres banques, ces dernières se substituant aux banques initiatrices.
Or la crise qui éclata en 2008 a été largement une crise de liquidité. Les engagements pris par les banques vis-à-vis des véhicules de titrisation, en matière de liquidité des actifs, ou de refinancement des investisseurs, ou de reprises des portefeuilles ont créé des appels de fonds considérables sur le marché interbancaire qui n’ont pas pu être tenus. Les actifs ne pouvaient être liquidés soit parce qu’ils avaient perdu de la valeur (cas des subprimes), soit parce que le système de financement des banques de l’ombre était parti en fumée…
C’est ainsi que ce secteur extraordinairement dynamique de la « banque parallèle » et du « shadow banking » a volé en éclat et a fait courir le risque que l’ensemble du système bancaire mondial suive le même sort.
C’est ainsi que les gouvernements du G20 et les différentes autorités de tutelle et de régulation se sont préoccupés dans le courant des années 2010 et 2011 d’une régulation des circuits de financements parallèles, instruits des risques de détournements des réglementations et de ce qu’on a appelé « l’arbitrage de réglementation ».
Banque Universelle
C’est une jolie expression. On dira que cela va bien avec l’amour universel, les idées universelles. Les religions aiment aussi être dites universelles. Les idées que la France a apportées au monde étaient des idées universelles…donc, on devrait en conclure qu’une Banque Universelle, est une Banque encore plus belle, plus noble, plus humaine que les autres.
Ce serait une pensée agréable pour les Banques, mais ce serait une erreur de compréhension. ». Le bel adjectif d’ « universel » n’est pas bien employé. Pour la bonne compréhension de leur activité on devrait dire des Banques universelles qu’elles sont des Banques « à tout faire ». Cela ramène les choses à leur juste dimension !!!
Leurs activités comprennent : les activités bancaires traditionnelles dépôts et crédits, les activités dans le domaine de l'investment banking (corporate Finance, opérations sur titres), de la gestion de patrimoines et éventuellement des assurances.
A la question, y-a-t-il des Banques qui ne sont pas universelles ? La réponse est oui. Ce sont des Banques spécialisées dans certains types d’opérations et tout particulièrement les Banques dites d’investissements ou investment bank. Celles-là se financent sur leurs fonds propres et sur les fonds qu’elles vont chercher sur les marchés financiers ou les marchés interbancaires. En effet, les Banques se prêtent mutuellement des sommes considérables. Les Banques d’investissement étant structurellement emprunteuses avec les Banques spécialisées dans le Financement de l’immobilier et du crédit à la consommation. Les établissements qui leur prêtent de l’argent sont souvent….les Banques universelles, qui sont à la tête de masses de capitaux considérables grâce aux dépôts de leurs clients.
C’est un des traits essentiels de l’activité de Banque universelle que de rechercher et de recevoir des dépôts du public. Or les dépôts du public constituent une ressource plus stable que les refinancements des confrères ou des concurrents.
En avril 2009 le patron de la deuxième Banque de Wall Street, après Goldman Sachs, entendait donner à Morgan Stanley une dimension de Banque universelle. Auparavant le statut de Banque d’investissement de Morgan Stanley, ne lui permettait pas de recevoir de dépôts du public. En contrepartie, les obligations pesant sur cette Banque comme sur toutes les Banques du même genre, étaient plus légères et les contrôles des l’administration moins astreignants. La crise de liquidité, au centre de l’effondrement du système bancaire américain, a été à l’origine d’une illumination, pour le patron de Morgan. Il lui fallait absolument des dépôts. C’est la meilleure protection contre les risques de rétrécissement de la liquidité.
Certains esprits chagrins font remarquer que le statut de Banque Universelle présente des risques considérables, malgré l’abondance des contrôles que justifie l’apport des dépôts du public. La Banque universelle qui est un modèle bien connu des français n’a pas fait que de bonnes choses. L’opinion des spécialistes du monde bancaire est même divisée.
Oui, tout le monde le reconnait, les dépôts du public permettent d’éviter à une Banque les effets d’une crise de liquidité interbancaire. Oui, en multipliant les activités, une Banque divise nécessairement ses risques et s’appuyant sur un large portefeuille d’activité réduit la fragilité de la génération des revenus.
Mais il n’en demeure pas moins que le risque existe que la Banque engrange de mauvaises créances ou porte dans son bilan de mauvais placements. L’abondance de liquidités provenant des dépôts de la clientèle, évitera, en cas de difficulté que cela se traduise par des effets de panique et de course aux refinancements.
Dis d’une autre façon : pour les critiques de la Banque universelle, les déposants sont piégés dans le financement de la Banque. Le jour où des difficultés graves surviennent, il est déjà trop tard. Les dépôts de la clientèle fournissant un accès généreux à la liquidité ont peut-être permis à la Banque de dissimuler une situation peu flatteuse, et lui ont donné le loisir de continuer les errements, et de ne pas réviser les choix stratégiques erronés.
Banque commerciale
L’expression « banque Commerciale » est relativement récente en France et, dans le droit ou dans les faits, n’avait pas vraiment de sens. La réglementation bancaire telle qu’elle était sortie des ordonnances de 1945 distinguait parmi les banques dites inscrites, c'est-à-dire les banques ressortant de l’univers de l’Association Française des Banques, les banques de dépôts, les banques d’affaires et les banques de crédit à moyen et long terme. C’est de l’histoire ancienne, il est vrai, mais il n’est pas mauvais de se souvenir qu’à cette époque les banques se définissaient largement par le droit qu’elles avaient à recevoir des dépôts de la part de certaines catégories d’agents économiques et conséquemment avaient le droit de se livrer à certaines opérations de crédit ou d’investissement. Un exemple simple illustrera ce propos : les banques de crédit à moyen et long terme ne pouvaient recevoir de dépôts à moins de deux ans. Elles ne pouvaient faire que des crédits (donc pas d’activité « investissements ») à plus de deux ans. Elles ne pouvaient donc pas « transformer » les échéances, c’est à dire appuyer sur des dépôts courts des emplois longs. Les banques de dépôts subissaient la contrainte inverse. Les banques d’affaires quant à elles étaient plus libres…sauf qu’elles ne pouvaient s’engager que vis-à-vis de « commerçants » au sens juridique du terme, c'est-à-dire d’entreprises. En ce sens, les banques d’affaires plus que les autres auraient pu légitimement être qualifiées de banques « commerciales ».
Curieusement, on trouve dans certains « lexiques » bancaires des définitions inverses : ce sont les banques commerciales qui mutent en banques d’affaires. Ainsi peut-on lire dans un dictionnaire que sont une catégorie obsolète « les banques commerciales (car elles) ont développé des activités de banques d'investissement ».
La notion de Banque Commerciale n’existait donc pas à proprement parler en France. Tout au plus, entendait-on dire par les services marketing de certains établissements que l’activité de banque commerciale prédominait. Le sous-entendu était que l’activité déployée à l’égard des entreprises l’emportait sur l’activité concernant les particuliers.
La réforme de 1984, dite aussi « réforme Bérégovoy », a radicalement changé l’organisation du système bancaire français, supprimant la fameuse distinction mentionnée plus haut. Les banques sont devenues universelles, c'est-à-dire autorisées (sinon capables) à opérer dans des activités de banques d’investissement, de banques commerciales et de banques de particuliers.
C’est alors que la notion de banque commerciale a commencé sa carrière française. Initialement, c’était une notion anglo-saxonne. Aux Etats-Unis, le fameux Glass-Steagal Act avait strictement séparé les activités dites d’Investment Banking et les activités de Retail Banking, lesquelles se subdivisaient en Wholesale Banking pour les grandes entreprises, Commercial Banking pour les Petites et moyennes entreprises et le Personal banking ou banque de particulier. La distinction américaine n’était pas loin de ce qui fut adopté par les autorités françaises en 1945: seules les Retail banks avaient le droit de recevoir des dépôts. La distinction en termes d’activité et de dépôts s’est affaiblie progressivement, pour aboutir en 1999 à une loi l’abrogeant ( Gramm-Leach-Bliley Act Financial Services Modernization Act).
Au terme de cette évolution, Banque Commerciale n’est toujours pas une notion « juridique » mais une appellation qui ne recouvre pas toujours les mêmes choses selon les pays ou les banques.
Pour les uns, les banques commerciales « Commercial banking » sont des établissements dédiés au service des entreprises Moyennes. Elles correspondent donc à un segment de marché. Le Small business banking traitant des petites entreprises, le Corporate Banking ou wholebanking des très grandes.
Pour les autres, c’est une activité qui ressort du retail banking, cette dernière catégorie touchant les établissements dont le rôle principal vis-à-vis de leur clientèle est la tenue de compte et les opérations relatives aux moyens de paiement, d’une part et de crédits à court terme, d’autre part.
Ces distinctions laissent une impression d’arguties sans intérêts et de subtilités conduisant à couper les cheveux en quatre ! Il faut prendre garde à ne pas s’en désintéresser pourtant. Les déboires des banques. L’effondrement d’un certain nombre de banques d’affaires, la mise en cause des opérations « affairistes » ou « opportunistes » de certaines banques de dépôts, conduisent les autorités bancaires et financières en Europe comme en Amérique du Nord à revoir radicalement les règles et contraintes pesant sur l’activité des banques. La distinction Banque de Détail / banques d’investissement revient au grand galop. Elle se manifeste dans des propositions tendant soit à séparer strictement les banques d’affaires des banques « retail », sur le plan juridique, capitalistique et sur le plan des fonds propres exigés, soit à exiger à l’intérieur d’un même établissement que les deux types d’activité soient complètement scindées.
Le terme « banque commerciale » a donc quelques beaux jours devant lui.
Banques de Groupe
Elles sont aussi nommées banques intragroupes. Ce sont des banques créées par des groupes non bancaires, industriels, services ou distribution etc. Les groupes Peugeot, Renault et Volkswagen comportent un établissement bancaire.
Elles sont aussi nommées banques intragroupes. Ce sont des banques créées par des groupes non bancaires, industriels, services ou distribution etc. Les groupes Peugeot, Renault et Volkswagen comportent un établissement bancaire. La banque de groupe du constructeur allemand a eu les honneurs de la presse : elle aurait été bénéficiaire de la campagne de prêts sur trois ans à taux réduits de la BCE. Quant à EADS dont la trésorerie est particulièrement abondante, elle aimerait, selon les Echos, disposer d’une licence de banque pour « y faire fructifier lui-même ses réserves de cash, mais, surtout… un accès direct aux banques centrales européennes avec la possibilité d'y mettre ses liquidités à l'abri en cas de grabuge ».
On voit d’emblée que les banques de Groupes sont de plusieurs types et présentent des profils très différents les unes des autres.
Les trois principaux types de banques «de groupe»
La catégorie la plus simple : les banques ou établissements financiers qui ont été mis en place dans le cadre des activités du Groupe. Les plus classiques sont les Etablissements financiers dont la mission est de financer les clients du groupe par des prêts à la consommation, à l’équipement ou à l’accession. L’exemple le plus topique est celui des banques qui, dans les groupes automobiles, ont pour mission de financer les acquéreurs d’automobiles. Pour ceux qui aiment l’histoire bancaire et financière, on rappellera que l’ancêtre de l’épargne-logement vient de la Régie Renault : celle-ci peu après la Guerre, à une époque où l’argent, le crédit …et les automobiles étaient rares avait créé un établissement qui proposait des plans d’épargne aux acquéreurs d’automobiles Renault, lesquels à leur échéance donnaient droit à la mise en place d’un prêt pour acquérir une… Renault. Ces organismes de crédit qu’on trouve partout où il y a de la consommation, partout où œuvrent de grands groupes de distribution, par correspondance ou non, se sont longtemps substitué aux banques pour qui ces activités n’étaient pas attrayantes ou suffisamment rentables. Ce type de banque demeure très actif tant en France que dans les autres pays occidentaux. Non seulement, elles offrent une palette de prêts à la consommation mais elles ont aussi lancé des plans d’épargne, des cartes de crédit avec succès. Renault a récemment relancé cette activité. Volkswagen et General Motors manient des montants considérables.
La catégorie la plus classique : les banques de trésorerie de groupe. Les grands groupes industriels ou de services sont à l’origine de flux de trésoreries permanents fonction de leur taille, de leurs implantations dans le monde et de leur organisation. La position de fournisseurs du groupe pour certaines filiales, l’existence de réseaux de commercialisation internes conduisent assez naturellement ces groupes à trouver plus simple de traiter leurs opérations par eux-mêmes plutôt que par le canal des réseaux bancaires. La gestion des achats de devises, la compensation des achats et des ventes internes, la coordination des mouvements de trésorerie autorisent en principe des frais moins élevés. Parfois ces banques de groupes sont conçues pour aiguillonner les banquiers partenaires : loin de rechercher le monopole des opérations de groupe, elles n’en traitent qu’une partie, mais par ce fait même sont en mesure d’en mieux cerner les coûts de production et les frais qui en sont les contreparties. Dans le même esprit de prestations de services financiers, ces banques jouent un rôle de conseil, coordinateur et filtre vis-à-vis des membres du groupe pour leurs programmes d’investissement et de financement.
Une dernière catégorie parait «logique» dans sa conception, bien que l’ampleur des opérations qui y sont traitées varie considérablement selon l’époque, l’état d’incertitude ou de défiance qui prévaut à l’égard des banques ou des systèmes bancaires. Lorsqu’un groupe est «liquide», c’est-à-dire qu’il dispose d’une trésorerie abondante à court et moyen terme, soit parce que son exploitation est bénéficiaire, soit parce que son cycle d’affaires crée de la trésorerie, la tentation est grande de rassembler les ressources de l’ensemble des membres du groupe dans une banque «sœur» ou «fille» et de les gérer comme une banque externe l’aurait fait, à son profit. Les très grandes entreprises peuvent détenir des encaisses liquides (trésorerie, placements monétaires) atteignant des niveaux très élevés. Il en résulte qu’elles assument très directement et pour des montants parfois considérables le risque de défaillance des banques dans lesquelles elles entretiennent leurs comptes. Créer une banque de trésorerie à l’intérieur d’un groupe permet à ce dernier de réduire les dépôts et comptes financiers qu’il détient dans les banques extérieures et de cantonner ses risques.
Les risques des banques de groupe
Tel qu’on vient de présenter les différents types de banque de groupe, on pourrait conclure, qu’il n’y a là qu’une très grande logique et que l’intégration d’une fonction bancaire au sein d’un groupe n’est que l’effet de sa taille. Plus le groupe est important, plus nombreuses sont ses filiales, plus les opérations commerciales et industrielles intragroupes sont multiples et complexes, plus il parait utile et même nécessaire de créer une banque interne qui sera capable de coordonner, combiner et exploiter les masses d’argent, les échéances et les opérations.
On ne s’étendra pas sur le fait que la participation d’une banque de groupe aux opérations financières et bancaires de ce groupe ne peut pas avoir ni pour effet, ni surtout pour motivation de faire « passer » des profits d’une société à une autre ! Par exemple : facturer des intérêts très élevés à une société dont on veut faire diminuer les résultats ou, au contraire, minorer le coût d’opérations bancaires pour redonner de bonnes couleurs au compte d’exploitation d’une filiale un peu fragile. Les risques de type conflits d’intérêts, abus de biens sociaux, prix de transferts dérogatoires et manipulation de résultats pèsent sur une banque de groupe comme sur n’importe quel société, filiale, sœur ou maison-mère d’un groupe où les opérations inter-compagnies sont nombreuses.
Les banques de groupe présentent des risques bancaires ! Cela paraît être une évidence mais cette évidence a pris ces dernières années pris une dimension particulière : une banque de groupe destinée à financer la clientèle en consentant des prêts à la consommation ou à l’équipement ne dispose pas nécessairement de la part du groupe de ressources suffisantes pour le refinancement de ses activités. Elle s’adresse donc aux marchés, interbancaires, financiers pour trouver les ressources dont elle a besoin. Ses risques sont alors très exactement les risques de toutes les banques : en période de crise, les ressources peuvent se raréfier et, si sa structure de financement n’est pas équilibrée… que sa qualité de risque soit bonne ou non, elle peut se trouver en difficulté et placer le groupe dans une position difficile.
Enfin, s’il est tentant pour un groupe très créditeur de gérer lui-même sa trésorerie en passant par la création d’une banque, il n’en demeure pas moins, que c’est un nouveau métier qu’il va assumer. La gestion d’une banque a ses particularités, ses contraintes réglementaires, juridiques et informatiques qui n’ont rien à voir avec le fonctionnement d’un groupe industriel ou de services. Les risques pris par les départements d’investment bank ont montré que des opérations ou opérateurs mal supervisés pouvaient provoquer des catastrophes.
Pour compléter ces propos, on se souviendra aussi que créer une banque pour faire ce que les banques traditionnelles ne s’avèrent pas capables de traiter (pendant longtemps, le crédit à la consommation a été un bon exemple) c’est devenir un acteur de l’univers bancaire et jouer le jeu de la concurrence qui y prévaut avec ses contraintes humaines, technologiques et professionnelles (contrôles, risques)… C’est la raison pour laquelle à certains moments critiques de leur existence les groupes n’hésitent pas à revendre ces activités !
Enfin, et non le moindre, certaines entreprises de taille multinationale qui disposaient de banques de trésorerie intra-groupes se sont aperçues que leurs dépôts souvent considérables dans ces banques atterrissaient finalement … dans les banques traditionnelles. Ce n’est pas parce qu’un groupe dispose d’une banque pour y déposer sa trésorerie qu’il s’affranchit des risques de l’univers bancaire ! Les dépôts sont au passif, il faut qu’il y ait quelque chose à l’actif… et il s’agissait évidemment de dépôts ou de titres de créances bancaires « extérieures » ! C’est alors qu’eurent lieu des mouvements de trésorerie considérables : les banques de trésorerie européennes de certains grands groupes s’en furent déposer leurs fonds … à la BCE, comme toute banque affiliée à cette dernière en a le droit. Ce faisant, elles contribuèrent dans des proportions significatives à la détérioration de la liquidité bancaire de la zone Euro !
Banksters
Les banquiers sont-ils devenus des Banksters ? L’opinion publique n’est pas loin de le penser. Trop de bonus mêlés à trop de pertes n’ont pas arrangé l’image déjà floue des banques.
En compactant en un seul, les deux mots « Bank » et « gangster » on obtient : bankster ! dans le nouveau jargon journalistique et populaire, c’est un banquier gangster.
Il est rassurant qu’il ait fallu créer un mot nouveau pour désigner un banquier douteux et avide. Le pire aurait été de garder le mot « banquier » et de le laisser dériver négativement. L’exemple donné par certains mots n’était pas de bon augure. « Promoteur immobilier », « Spéculateur », « arracheur de dents » et maintenant « trader » se sont figés dans une connotation sinistre et irrécupérable.
Il y aurait d’un coté les banquiers, qui sont des professionnels responsables et honnêtes et il y a les « banksters » qui représentent « le coté obscur de la force ». Les différencier est néanmoins peu aisé. À l’inverse de Dark Vador qui a le costume de l’emploi, les banquiers et les banksters sont habillés pratiquement de la même façon (peut-être les rayures tennis des costumes de banksters sont-elles un peu plus marquées) et ont des cravates identiques (celles des banksters peuvent être un peu plus voyantes). Seules les chaussures et les montres différeraient : on peut aussi relever que les banksters sont souvent équipés de larges bretelles de couleurs vives destinées à maintenir leur pantalon en place même lorsqu’ils perdent leur culotte.
Donc, si vous êtes appelé à rencontrer un banquier et si vous voulez vous assurer que ce n’est pas un bankster, regardez ses pompes, sa montre et ses bretelles, non cumulativement.
Pour revenir aux origines, Banquiers et Banque n’ont jamais été associés à des qualificatifs positifs. « Une banque c’est un commerçant, qui gagne sa vie avec l’argent comme matière première…sauf que la matière première ne lui appartient pas, c’est l’argent des autres ». De là à considérer que Banquier et voleur sont la même chose ou les deux faces d’un même problème, l’argent, il n’y a pas loin. La plupart des programmes de nationalisations, de dépossessions, ou d’expropriations bancaires, qui sont la version moderne de l’élimination des templiers par Philippe le Bel, même (surtout) lorsqu’ils étaient peu désintéressés se sont appuyés sur des considérations morales. Utiliser ce qui appartient aux autres pour gagner de l’argent et donc pour s’en mettre plein les poches n’est pas « juste ». Quand on s’aperçoit que, si des pertes apparaissent, ce sont les « autres » (vous et moi) qui vont faire les frais de l’opération, c’est même franchement injuste !!!! Donc, de prime abord, un banquier est un individu difficilement aimable.
Cette vision négative, fondée sur une sorte de défaut génétique, s’amplifiait traditionnellement à l’occasion de la distribution du crédit et de la prise de risque : « le banquier est un individu qui ne sort jamais son parapluie », « on ne prête pas aux hommes et aux projets, donc à l’avenir, mais aux bilans et aux garanties, donc au passé » est un grand classique dans la réprobation générale à l’égard des banquiers. « Quand on n’en a pas besoin, ils nous pourchassent et veulent nos économies, quand on en a besoin, ils nous fuient et nous refusent leurs crédits ».
Ce sont de grands classiques, ces thèmes-là, ça ne suffit pas pour faire de nos jours un « Bankster ». C’est désagréable de ne pas avoir le « feu vert » de son banquier pour un crédit mais ce n’est pas ça qui conduit à le traiter de « voleur », « gangster » etc….
Curieusement, c’est avec la financiarisation des économies et la mondialisation du marché des capitaux (une sorte de débancarisation) que les banquiers ont récemment conquis leurs galons de Banksters. La crise de 2008, sur fond d’effondrement du système bancaire américain (faillite de Lehman Brothers), suivi de craquements sinistres dans le système anglais et la mise en danger des banques investies dans les subprime (allemandes, anglaises, espagnoles), avec pour apothéose, la faillite de la quasi-intégralité des banques irlandaises et islandaises a provoqué un séisme économique considérable avec son cortège de chômage, de diminution du PNB, de pertes des régimes de retraite et des fonds de pension….
Les affaires Madoff, (qui n’ont rien de bancaire), Lehman Brothers, AIG (qui est une compagnie d’assurance), le Bank run sur la Northern Rock en Angleterre et les Banques grecques, ont mis l’accent sur ce qu’on a qualifié d’arrogance, de folie des grandeurs et d’avidité des banquiers.
Les bonus largement distribués, même au plus fort de la crise, à des dirigeants de banques qui n’avaient pas fait montre ni de prévoyance ni de capacité à anticiper les évènements, mais aussi à des traders dont quelques éléments provoquaient des pertes comptées en milliards de dollars, ont contribué à rendre la cause des banquiers difficiles à défendre. En 2009 un sondage de la Sofres comportait la question "d'après vous, parmi les catégories suivantes, quelles sont les deux qui portent la plus grande responsabilité dans l'origine de la crise économique et financière mondiale actuelle", 58 % des Français répondent d'abord les banques.
Les banquiers dont la réputation a toujours souffert de la nature particulière de leur métier et de sa position dans les rouages des économies, qui créent de l’argent ex-nihilo et ont même su se passer de l’or pour bâtir des fortunes, se voient mis en accusation avec de plus en plus de véhémence. La Commission Européenne, pourtant d’habitude nuancées dans ses condamnations en est venue à proposer qu’ "une responsabilité pénale individuelle des acteurs financiers soit enfin reconnue dans le droit européen", pour reprendre les termes du José Emmanue Barroso son Président. Ce dernier enfonçait le clou : "Nous avons vu des comportements abusifs sur les marchés, certains ont provoqué la crise actuelle. Nous allons réguler ces pratiques ! Ceux qui les violeront encourront des sanctions pénales. Ce sera une première dans la législation européenne et un signal fort". L’apparition d’une nouvelle catégorie de crédits : les crédits toxiques montés au profit de collectivités locales innocentes victimes de l’imagination et de la créativité (nécessairement) diaboliques des banquiers… ou bien, insuffisamment compétentes pour comprendre tout ce qui était écrit en petites lettres dans les contrats... ou bien…
C’est ce même mouvement d’humeur qui conduit à redonner vigueur à une vieille idée : « la nationalisation totale ou partielle », comme si la présence des Etats et de leurs fonctionnaires à la tête des banques donnait en toute certitude des garanties de sérieux et d’éthique dans leur gestion.
Les Banquiers sont-ils des banksters ? En tout cas, il leur faudra beaucoup de temps pour un retour au niveau d’hostilité « classique » qui est immanquablement attaché aux métiers de l’argent.
Bancarisation
Jargoniser est le fait de tous les métiers. Les métiers de la Banque et de la Finance n’y échappent pas et multiplient les néologismes, les mots composés « ad-hoc ».
Bancariser, bancarisation font précisément partie de cette deuxième catégorie. Ils ont été créés voici prés de quarante ans à une époque où on se préoccupait du développement des Banques comme d’un enjeu national et d’une grande ambition. A cette époque, être banquier était une situation enviée et respectée et on pouvait dire à sa mère qu’enfin on travaillait dans la Banque et qu’on n’aurait plus à faire le pianiste dans un bordel !
La bancarisation est une mesure et s’exprime en taux.
On dira qu’un taux de bancarisation a atteint cent pour cent quand toutes les personnes en droit d’ouvrir un compte en Banque l’ont fait. S’il faut en croire les spécialistes, un taux de bancarisation élevé donnerait une indication sur le niveau de développement d’une population. L’usage du chèque et de la carte étant considéré (par les banquiers, (mais pas seulement !) comme la preuve très solide d’une ouverture d’esprit et de modernité quand l’usage du cash, c'est-à-dire des billets de Banque, serait l’apanage des Iroquois ou des fraudeurs.
La réussite de la bancarisation des particuliers et des entreprises par les Banques a été telle qu’on s’est mis à parler de multibancarisation pour indiquer que des personnes ou des entreprises étaient clientes de plusieurs Banques. La multibancarisation serait en fait une habitude française, par opposition aux us et coutumes des anglo-saxons et à la conception des Allemands attentifs à l’établissement de relations marquées par la fidélité à une Banque (Hausbank)
Cependant « bancarisation » ne se résume pas au seul décompte des titulaires de compte-chèques. Le terme désigne aussi une forme de fonctionnement l’économie.
La bancarisation symbole de l’accès des banques à un statut privilégié dans l’économie et la société.
Le mouvement qui a conduit à la « bancarisation » de l’économie française et de nombreuses autres économies s’inscrit dans celui qui voit un progressif désengagement de la puissance publique dans le financement de l’économie. Ce mouvement démarre en France avec la prise de conscience que l’intervention de l’Etat dans tous les domaines de l’économie, y compris dans son financement ne peut plus être systématique et ne peut plus couvrir tous les champs d’activité ni tous les agents.
Les banques françaises avaient été nationalisées, pour les plus grandes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’ensemble du monde bancaire était soit sous le contrôle de l’Etat, soit mutualisé ou coopératif. Le point commun de tous ces établissements était leur totale dépendance vis-à-vis de la Banque de France : les banques étaient dites « dans la Banque » en raison de l’insuffisance de leurs ressources. « Les crédits font les dépôts » est un des principes fondamentaux de l’économie bancaire sauf quand le système bancaire est affecté de « fuites », c'est-à-dire lorsque les crédits consentis se transforment en monnaie fiduciaire, en billets de banque, et échappent au circuit bancaire le privant de sources automatiques de refinancement.
Le processus de bancarisation de l’économie française pour prendre cet exemple a consisté à réorienter la détention d’actifs liquides des agents économiques vers les banques en réduisant les fameuses « fuites ». C’est une véritable révolution qui fut lancée par les pouvoirs publics, à la fin des années soixante, sachant que le statut des banques demeurait inchangé : celles qui étaient nationalisées le restaient. La stratégie suivie consista essentiellement à pousser les particuliers vers l’ouverture de comptes en banques, en interdisant le paiement en billet de banque des salaires dépassant un certain montant et en imposant un paiement par chèque. Dans un deuxième temps, les salaires furent mensualisés, aboutissant à ce que le « certain montant » soit presque systématiquement dépassé !
Le résultat fut à la hauteur des espérances : l’économie française fut totalement bancarisée en l’espace de 15 ans. Les guichets de banque se multiplièrent, le recrutement de personnel fut massif et les publicités prirent des aspects si surprenant que le slogan « votre argent m’intéresse » fait encore partie de l’imagerie populaire en matière bancaire. La part prise par les banques dans le financement de l’économie devint central. Non seulement les entreprises se trouvèrent en face de banques disposant de ressources pour les financer, mais le crédit à la consommation qui végétait explosa, le crédit à l’accession à la propriété fit de même. L’économie subit une transformation accélérée, qui s’étendit aux formes coopératives et mutualistes dont les règles strictes d’exercice de leurs activités furent allégées.
Financiarisation contre Bancarisation
L’étape qui suivit était inscrite, les banques devenant autonomes pour leurs financements (on disait toujours dans le courant des années 80 du siècle dernier : refinancement) furent progressivement lancées dans un processus de privatisation sans que cela soit un processus général en Europe. En France, le processus de dénationalisation suivit très vite une période assez étrange de nationalisation massive. La loi bancaire de 1984 fit sauter à peu prés toutes les contraintes au fonctionnement libres des banques. En Allemagne, le secteur bancaire demeurât et demeure toujours massivement dominé par des établissements à publique : les banques de Länder. L’Espagne connut un développement considérable des banques privées.
Les critiques à l’encontre des systèmes bancaires se multiplièrent à la suite de crises graves, en France au début des années 1990, à la suite aussi de l’effondrement des régimes d’inspiration soviétique, montrant que le dirigisme économique qu’il soit public (domination de l’Etat) ou privé (domination des banques) était inefficient à l’inverse des marchés financiers qui pouvaient assurer une meilleure allocation des capitaux disponibles et une meilleure rétribution de l’épargne.
La bancarisation formelle (nombre de comptes en banque) des économies n’en souffrît pas et la multibancarisation ne se ralentit pas non plus. Elle trouva même à s’exprimer dans les pays d’unicité bancaire par agent économique. Il n’y a pas eu « débancarisation». En revanche, les Banques ont perdu, au profit des marchés (financiarisation) des pans entiers de leurs activités de financement et de gestion de l’Epargne.
Bank Run
En français, cette expression, « course à la Banque… » ne donne rien : la bonne formulation serait « course au guichet ». Et même sous cette forme, l’expression n’est pas claire puisqu’aussi bien la « course aux guichets » pour les banquiers qualifie une concurrence débridée dans l’acquisition de parts de marché qui consiste à multiplier les créations, acquisitions et implantations de nouveaux guichets.
Le Bank run à l’Anglo-saxonne qualifie la course à laquelle se livrent les déposants d’une Banque qui, craignant qu’elle dépose son bilan et ferme, veulent récupérer leurs dépôts, sous toutes formes. L’histoire de la Grande Crise (celle de 1929) est souvent illustrée par ces photos de queues interminables dans les rues des villes américaines, anglaises mais aussi françaises, allemandes etc. Les clients des Banques y donnent l’impression d’attendre patiemment leur tour. Ils furent parfois excédés d’attendre et excédés de découvrir qu’attendre n’avait servi à rien, il n’y avait plus d’argent dans les coffres. Alors, ils devinrent moins patients et tout ceci dégénéra en véritables émeutes.
Mais tout çà, c’était le passé ! L’époque de l’obscurantisme financier et bancaire. Tout çà c’était fini et ne pouvait plus exister. En tout cas, c’était la conviction de nombre de spécialistes de la Banque. Jusqu’au jour, où….
Tout à coup ! En Grande Bretagne, pays de la Banque et de la Finance en gloire, d’une City conquérante et attirante où se déversait la fine fleur de la jeunesse la mieux formée du continent ! Tout à coup donc ! Sans prévenir, les queues se sont reformées, le « Bank Run » est revenu. Des queues se formèrent dans les rues et s’étirèrent et la police fut appelée pour éviter des débordements. Un vrai « Bank run » s’enclenchait.
Le 15 septembre 2007, les clients de British Bank Northern Rock, la cinquième institution britannique pour les prêts immobiliers, commencèrent à retirer leur monnaie en masse à travers tout le pays. En moins de deux jours, un milliard trois cents millions de livres sterling avaient été retirés. Malgré les appels au calme lancés par la Banque d’Angleterre, malgré l’annonce de prêts d’urgence consentis à Northern Rock, le « Bank run » continua créant une confusion totale dans le monde bancaire bien astiqué et triomphant de la City. Le spectacle dura encore quelques jours sous les regards consternés des banquiers centraux européens.
La théorie économique range les « bank runs » dans le rang des prophéties auto-réalisatrices (voir ce terme) : il est clair que si tous les déposants, pensant que leur Banque est en mauvaise position, viennent retirer leur argent, alors, la Banque est vraiment en mauvaise position.
Certains théoriciens disent : l’argent retiré par les clients d’une Banque va être déposé dans d’autres Banques. Celles-ci, si la Banque victime du Run, est de bonne qualité vont lui prêter les sommes qui viennent d’être déposées, évitant ainsi à cette dernière de sombrer. Le Run s’arrêtera de lui-même quand les déposants s’apercevront finalement qu’il n’y avait pas de risque.
Certes ! Et tout ceci est bel et bon…sauf que lors de l’affaire Northern Rock, tout le système bancaire britannique était sous pression ; sauf que Northern n’avait pas la réputation d’être un préteur très soucieux de la qualité de ses opérations ; sauf que les déposants qui avaient récupérés des billets de Banque, les gardèrent plus longtemps qu’on pouvait le penser. Sauf que ces déposants avaient perdu confiance dans le système bancaire anglais et retrouvé le chemin des matelas et des planques à billets au milieu des draps et du linge de maison. Résultat, la Northern Rock fut nationalisée « temporairement » le 18 février 2008 après 6 mois d’hésitation et de généralisation de la panique.
Les Etats Unis ne furent pas en reste et les queues se formèrent dés le début 2008 devant les guichets de Banques régionales de tailles diverses conduisant la Federal Reserve à agir rapidement, à annoncer une réduction drastique des taux de refinancement des Banques et la mise en place de lignes de crédit en faveur d’une liste de sociétés agréées plus longue que jamais!
Quelques pays annoncèrent une sorte de garantie intégrale des dépôts, l’Irlande en tête. Et le mouvement de Bank Run s’interrompit.
Bank run 2
Suite
En principe, un «Bank Run», ne se planifie pas même s’il est un cas où un «Bank Run», a pu être intentionnel, voulu, organisé. Ce cas est maintenant célèbre dans l’histoire monétaire française : le cas Cantona. Pour saper l’arrogance et la puissance des organismes bancaires, pour les mater en quelque sorte, Eric Cantona avait lancé un appel à la « désobéissance bancaire ». Il avait lancé à la foule de ses admirateurs « foncez retirer votre argent des banques. Sans dépôts, elles seront obligées de venir supplier qu’on leur laisse la vie, comme les Bourgeois à Calais, comme l’Empereur d’Allemagne à Canossa. Cette histoire en resta là, au stade des idées et des imprécations. Les plus malins, qui voulaient montrer à Cantona qu’il avait de belles et bonnes idées très en avance sur son temps, retirèrent leurs dépôts en France et s’en furent créditer des comptes en Suisse. Les moins futés, prirent les propos de Cantona pour Argent comptant, retirèrent des valises de billets et se firent détrousser au retour dans leurs foyers.
Il faut revenir sur l’entrée « Bank Run »
Peut-on prédire et dire qu’il y de forts risques de «Bank Run» si tel ou tel évènement survient ? Les «Bank Run» font partie des évènements catastrophiques au sens conceptuel que prend ce terme. Ils n’arrivent pas par hasard et pourtant, ils surviennent comme on peut s’attendre à ce qu’un éboulement se produise, parce qu’un grain de sable, un jour, lâche. En général, un « Bank Run » surprend les « autorités ». Ces dernières, dépassées, (« elle n’avait pas prévu », « elle n’imaginait pas », « c’était au-delà de toute raison »), lancent des appels au calme, disent qu’il faut raison garder et ne font qu’attiser l’incendie par leur allure déboussolée. Le tout se déroulerait de façon dramatique : queues aux guichets des banques, bagarres, crises de nerf, massacres de banquiers. Depuis la faillite de Law, la course au guichet a été décrite sous toutes les formes.
Pourquoi revenir sur cette entrée ? Il y a un an, on avait présenté le mécanisme économique dans son acceptation courante. Il y a un an, on aurait pu penser que le dernier «Bank Run» avait été anglais. (Affaire de Northern Rock). C’était faire preuve d’optimisme. Il y en eu a d’autres depuis et on en prédit quelques autres dans de brefs délais en Grèce, en Espagne…et puisqu’on y est en Italie…allons, on pourrait même pousser vers la France ?
Il y a plusieurs catégories de « Bank run ».
L’expression «Bank Run» qui donne traditionnellement en français « course aux guichets » devrait être traduite par « fuite devant la (les) banque(s) ». C’est une forme limitée de fuite devant la monnaie : au lieu de placer ses liquidités en actifs non monétaires (des œuvres d’art, de l’immobilier, des couverts en Argent), on chercherait à substituer des actifs monétaires d’une catégorie, la monnaie de banque (c'est-à-dire la monnaie scripturale) au profit d’une autre, la monnaie fiduciaire (c'est-à-dire les billets de banque) qui paraissent une créance contre un débiteur sûr : la Banque centrale.
En fait, si on observe scrupuleusement les choses, il y a d’un côté l’écume des évènements, le «Bank Run» traditionnel avec ses foules qui serpentent en queues kilométriques, avec ses déposants qui couchent aux portes des banques, avec aussi les émeutes. Et il y a le «Bank Run» feutré. Il n’est pas caché. Il est répertorié dans les statistiques. Les journaux s’en saisissent…mais, il est d’un genre différent.
La course au guichet et la queue devant les banques
Quant au premier : il y aurait donc eu «Bank Run» ? Non ! Il n’y a pas eu de «Bank Run» en Espagne ! C’est une information erronée qui a conduit des journalistes peut-être mal intentionnés à publier des commentaires au ton dramatique sur le retrait massif effectués par les déposants espagnols de la Banque Bankia. Il est vrai que les clients de la quatrième banque espagnole, Bankia, avaient du souci à se faire : très exposée au risque immobilier, elle a du être nationalisée. Les journaux espagnols ont alors décrit une fuite des dépôts de plus de 1 milliard d'euros en une semaine et ont provoqué une véritable panique. Les autorités espagnoles et la Direction de la Banque se sont insurgées et Bankia « Les déposants peuvent être absolument tranquilles quant à la sécurité de l'épargne qu'ils ont confiée à l'entité », a assuré la banque, rappelant que le « gouvernement apportera les capitaux nécessaires à[son] assainissement ». Bon…ce sont les mots qu’on utilise dans ce genre de circonstances, il n’empêche que c’est exactement ce qui s’était passé en Irlande, lors d’un «Bank Run» stoppé juste à temps par les promesses des autorités irlandaises de prendre en charge la garantie des dépôts.
En Grèce, ces derniers temps, les raisons des déposants de courir pour récupérer des billets de banque s’accroissent: la suspension des négociations avec le FMI et le blocage des versements sur les prêts de la BCE aux banques ne peuvent pas être rassurants. De fait, s’il n’y a pas eu de «Bank Run» au sens catastrophique décrit plus haut, il est rampant. Les déposants ne se précipitent pas (encore), ils retirent leur argent progressivement.
Il faut rappeler qu’un précédent, le «Bank Run» russe de 1998, avait mis par terre le système économique initié par Boris Eltsine !
Les transferts de capitaux vers des Havres bancaires sûrs
Courir pour aller récupérer ses économies à la Banque est quand même un peu rustique dans un monde interconnecté et électronique ! Si le «Bank Run» consiste en substitution d’un actif monétaire en monnaie scriptural par un autre en monnaie fiduciaire, il est tout à fait possible d’aboutir au même résultat par la substitution d’un autre actif monétaire fiduciaire.
C’est le second point qui comporte deux possibilités. L’une, qui consiste à rechercher un support plus rassurant, l’autre, un débiteur convaincant.
La première est la plus simple. Elle a d’ailleurs déjà coûté fort cher à la Grèce. Ce sont des milliards d’euros qui ont quitté les banques de ce pays pour se retrouver en Suisse, libellés en Francs suisses. Ce sont des déplacements massifs de monnaie qu’on retrouvait traditionnellement « autrefois » quand un doute planait sur la parité d’une monnaie. Cette fois-ci, le doute plane sur le maintien de la Grèce dans la zone euro, ce qui revient au même.
Le deuxième est plus complexe dans son principe et plus simple dans ses modalités. Il s’agit, au sein de la zone euro, de changer de débiteur. Ainsi, un Espagnol qui voudrait mettre son argent à l’abri, pourrait-il être tenté de le déposer dans une banque française ou souscrire des bons du trésor allemand en substitution d’actifs monétaires sur des banques espagnoles. Le changement de débiteur ici met en lumière un paradoxe : la fuite devant les banques espagnoles qui trouve son origine dans les doutes concernant leur solidité ne se traduit pas nécessairement pas des placements en Espagne, elle se double donc d’un doute sur la place de l’Espagne dans l’euro.
Et la fuite des Banques !
Un dernier point, relatif au «Bank Run » doit être mentionné : la fuite des banques ! Jusqu’ici on a évoqué la situation de déposants « classiques » : les particuliers, les entreprises, les collectivités… mais pas les banques… peut-on dire de ces dernières qu’elles ne sont pas des déposants ? En aucune façon. Les banques sont des déposants dans les autres banques au titre de leurs encaisses de transactions commerciales et financières et au titre du float que génèrent ces dernières. Une façon, inélégante, mais protectrice de leurs intérêts consiste pour les banques méfiantes quant à la stabilité financière de leurs consœurs à retirer tous leurs dépôts de transaction et de liquidité opérationnelle… et, en Europe, à se reporter sur la Banque Centrale Européenne. C’est en bref ce qui s’est passé pour les banques irlandaises quand elles ont perdu les dépôts de banques allemandes en particulier.
Banques Centrales
Au commencement dans l’histoire de la monnaie et des banques, il n’y a pas de banques centrales. L’émission monétaire est réservé à une autorité souveraine ou quasi-souveraine, une ville, une province, un duché, un monastère. Un peu plus tard le privilège de l’émission sera exercé par une puissance souveraine, en France via le Trésor, la dite puissance se réservant les avantages qui y sont attachés : le seigneuriage.
Les banques centrales apparaissent du jour où la monnaie fiduciaire, le billet de banque, fait sont apparition et surtout, du jour, où par le biais des crédits qu’elles consentent, les billets de banque circulent plus abondamment. Progressivement, parmi les banques d’un pays, apparaissent un ou plusieurs leaders. Plus rassurants que les autres, mieux capitalisés, disposant de ressources sous forme de dépôts en or ou argent solides et abondantes, leurs billets sont appréciés, la confiance des porteurs est forte. Ces banques vont dans certains pays, anglo-saxons le plus souvent, s’orienter vers un rôle de banquier des banques, de préteur de dernier ressort et, finalement, de garant des émissions monétaires qu’ils approuvent ou qu’ils acceptent au paiement de leurs caisses. Ainsi apparaîtront des banques à vocation « centrales ».
L’émission de monnaie a parfois laissé des traces brûlantes. En France (mais, l’Angleterre n’y a pas échappé) on a mal vécu l’expérience de Law ou celle des assignats. Pourtant, commerçants, entrepreneurs, industriels au début du XIX éme siècle estiment que transporter de l’or ou de l’argent c’est coûteux et risqué. Les billets sont plus commodes pour autant que leur émission demeure sous contrôle. Au surplus, les marchands et industriels recherchent des avances sur le paiement des qu’ils détiennent. En France, émission sécurisée de billets et la technique du crédit d’escompte sont ainsi étroitement liés.
Sur cette initiative nait la Banque de France, Banque privée, dont le capital est détenu par les principaux banquiers de la place de Paris. Elle reçoit de l’Etat un privilège d’émission privilège d’émission limité dans le temps et dans l’espace. Or, elle ne sera « centrale » qu’en 1848 lorsqu’elle aura absorbé toutes les banques de province qui avaient reçu un privilège local d’émission, ainsi que leurs guichets d’escompte. La Banque de France restera cependant une affaire privée jusqu’en 1936, date à laquelle elle est quasiment nationalisée. Elle le sera « de jure » en 1945.
Les Etats-Unis, ont connu un cheminement plus compliqué vers l’institution d’une banque centrale. Les Pères Fondateurs n’étaient pas tous d’accord sur son utilité. La monnaie de banque n’avait pas une belle réputation. Une tentative de création de Banque Centrale fut interrompue très tôt au début du XIXème siècle. L’émission de billet et la distribution des crédits demeurèrent des affaires privées jusqu’en 1913, année de la création de la Federal Reserve. Jusque là, les Etats-Unis comptaient plusieurs milliers de banques émettant des billets « les green backs » qui ne s’échangeaient pas contre un poids d’or uniforme. C’est un fédéralisme monétaire qui se mit en place après une succession de crises de confiance bancaire, la Federal Reserve étant propriété de douze banques « centrales » régionales.
La création de monnaie sous forme de monnaie fiduciaire a, évolution économique et bancarisation des économies aidant, été marginalisée par le rôle croissant de l’émission de monnaie scripturale, nouvelles monnaies de banque. La compréhension des mécanismes monétaires et fiduciaires devenue plus fine et la théorie économique ont rapidement posé ce postulat que « les crédits font les dépôts » et non l’inverse. Un corollaire de ce postulat se trouvait dans le pouvoir de transformation des banques et leur puissance multiplicatrice.
Les banques centrales ont donc été conduites à jouer un rôle de supervision dans la distribution des crédits qui se déduisait nécessairement de celui de superviseur de la création monétaire. S’y joignit progressivement un rôle de préteur de dernier ressort, apportant au marché bancaire et financier une liquidité bancaire indispensable au bon déroulement des affaires.
De nos jours, toutes les Banques centrales ne sont pas des entreprises publiques, même si c’est un cas très fréquent. Les dégâts qu’a occasionnés, à plusieurs reprises, la mainmise des Etats sur les Banques Centrales dans le but de faciliter le financement des déficits publics, ont conduit les législateurs, à exiger qu’elles demeurent indépendantes. Investies de la défense de la monnaie, de la conduite de la politique du crédit, elles sont responsables du bon fonctionnement du système bancaire et de la sécurité des moyens de paiement. Pour accomplir leurs missions, elles jouent un rôle clé dans la collecte des statistiques économiques, bancaires et financières et dans la prévision de l’évolution des grands agrégats que sont les « M » et les « P », masse monétaire et placements.
Où en sont les banques centrales ? Lors du Bank Run (voir ce mot) sur les guichets de North Western, en Angleterre, la Banque d’Angleterre s’est vue reprocher, tout d’abord son incapacité à prévoir l’évènement, puis sa lenteur à réagir. Il est vrai qu’il n’était pas de tradition en Angleterre que la Banque Centrale fût interventionniste, à l’inverse de la Banque de France avant que la BCE fut créée.
A l’opposé, la Banque Centrale Européenne qui subissait depuis sa création de vigoureuses critiques sur sa politique de taux et sur sa supposée méconnaissance des réalités des économies européennes, prit presque immédiatement la mesure de la tornade de 2008. Au moment où le marché européen de la liquidité bancaire (voir ce terme) se trouvait la tête à l’envers, la Banque Centrale Européenne a répondu en faisant cascader les milliards. Aurait-elle fait défaut que la catastrophe qui s’annonçait aurait bel et bien éclaté. Pourtant, sa mission officielle était de gérer la monnaie commune, l’euro, et la masse monétaire de l’ensemble de la Zone Euro, en sorte que les prix restent « sages » dans l’Union Européenne.
La question de l’indépendance des banques centrales a pris une dimension particulière avec la Crise de 2008. Lorsque les banques centrales, américaines et anglaises, lorsque la Banque Centrale Européenne ont décidé de se lancer massivement dans des politiques de « financements non conventionnels » laissant de côté les armes traditionnelles qui leur étaient réservées (niveau des réserves, niveau des fonds propres, open market, régulation par les taux etc), elles ont agi « en toute sagesse ». Il y avait un incendie, il fallait l’éteindre et, avant même, il fallait l’empêcher de s’étendre. Il n’empêche qu’elles ont souvent été obligée de mettre de côté leurs principes.
Et la Banque de France, que devient-elle aujourd’hui? Essentiellement, elle demeure responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire nationale dans le cadre de la coordination monétaire décidée au niveau de la BCE. Elle joue un rôle important de supervision du monde bancaire.
Banque électronique, banque en ligne
Depuis que l’électronique et le web ont saisi l’univers financier et bancaire, les esprits semblent désorientés. Quand on cherche la définition de la banque en ligne, on trouve parfois qu’il s’agit d’un ensemble de logiciels édités par une banque ou un de ses fournisseurs. Dans cet esprit, « le livre » pourrait être défini ainsi « des chiffons et de l’encre en un certain ordre assemblés » ! Pour la finance, les choses semblent être réglées, les non-spécialistes ont admis qu’il n’y avait plus de criée à la bourse, ils ont admis qu’il y avait des écrans et des salles de marchés qui font penser à une salle de bandits manchots, ils ont même compris que les traders pouvaient « spieler » avec des logiciels de pures mathématiques qu’ils ne comprennent et que leurs patrons comprennent encore moins. En revanche, ils ont toujours du mal à comprendre ce que peut être une banque électronique, une banque en ligne, une e-banque et un peu plus loin, une e-carte bleue, de l’e-cash….il faut dire qu’au départ, pour toute personne normalement constituée la banque c’est là où est l’argent et si on souhaite retirer son argent, précipitamment ou non, c’est une bonne idée de savoir où elle est ! A ce stade du raisonnement, on indiquera que la première tentative de banque à distance, qui n’avait pas mal marché initialement s’est trouvé contrainte au bout d’un certaines nombres d’années d’existence de créer des agences. Certains clients ou prospects trouvaient désagréable l’idée de ne pas pouvoir localiser leur banque, géographiquement mais aussi physiquement.
Il faut, pour comprendre ce que contiennent ces nouveaux concepts, revenir un peu en arrière sur le plan technologique et sur le plan juridique. La vie des banquiers se déroulait dans le papier avant que l’ordinateur fut. L’ordinateur arrivant, les banquiers ont continué à gérer du papier car l’ensemble des moyens de paiement étaient faits de papier. L’ordinateur était un comptable un peu plus rapide et créditer un compte en banque de l’argent déposé par un client ne supposait plus une armée de scribe pour mettre les comptes à jour. On en a encore quelques survivances et certaines banques ont maintenu des livrets manuels…pour faire ancien peut-être! Le règne du papier n’était pas autre chose sur le plan technologique que l’expression du règne de l’écrit dans le cadre de l’administration de la preuve. Les banques, quand internet n’existait pas encore, quand même le fax n’était qu’un gadget scientifique, pouvaient recevoir des ordres par téléphone. Elles avaient le téléphone ! Sur le plan juridique, elles se trouvaient en risque absolu si elles exécutaient un ordre donné par un client au téléphone. La banque à distance ne pouvait fournir les preuves juridiques, les papiers signés, les ordres visés (en chiffre et en lettres), les effets de commerce, signés, et avalisés et endossés, les chèques, les bons anonymes, toute une kyrielle de documents indispensables parce que les paiements et la preuve des paiements passaient par l’expression écrite (donc papier) des instructions du client et de la réaction du banquier.
Cette étape, a été franchie, durant les 25 dernières années. En un quart de siècle le sacro-saint « papier » a été relégué au rang des antiquités par : l’arrivée du fax, du minitel, la mise en ligne des informations sur les comptes des entreprises, la création de protocoles sécurisés d’échanges d’informations entre banques, puis entre banques et clients entreprises ont bouleversé le monde bancaire. Enfin, l’arrivée d’internet et sa capacité à démultiplier les modes de connections et les connections elles-mêmes entre les clients, les banques et l’ensemble même des partenaires du monde financier et bancaire a fait basculer le monde bancaire de la banque à distance dans la banque électronique. Les foisonnements technologiques se traduisent par des initiatives en tous genres, le milieu bancaire a été un lieu d’expérimentation, d’innovation et de proposition très riche. Il était motivé et d’une certaine façon avait, en lui-même les ressources nécessaires à cette expérimentation. Il serait intéressant de faire un inventaire des solutions technologiques bancaires pour instaurer de nouveau modes de relations avec les clients des banques et avec leur environnement professionnel. On y verrait des tentatives rigolotes, comme cette banque qui proposait une gestion automatique des comptes sans aucun moyen électronique fiable : l’automatisme était le fait d’une multitude de petites mains….on y verrait des impasses, le minitel… Les banques ont à peu prés tout essayé pour mettre la banque au goût du jour, pour permettre à ses clients de traiter à distance et pour demeurer en contact, à distance, avec eux. Elles étaient motivées car c’était un moyen de diminuer les coûts en personnel. Elles disposaient d’une certaine « familiarité » avec ces technologies car, depuis longtemps, la Banque sans ordinateur n’est pas plus imaginable qu’un courtier sans téléphone.
Les premiers services fournis étaient les plus simples, relevant essentiellement des informations sur les comptes et les opérations des clients. La grande difficulté pour les banques étant de mettre en batterie de façon conviviale des informations qui concernent des activités très variées : il n’y a pas de rapport entre obtenir une information comptable du type « date d’encaissement de mon chèque » et l’information « cours touché de mon ordre de bourse. La banque en ligne est née de cette mise à disposition. La banque électronique est née de l’interactivité : le client peut agir sur ses comptes, donner des ordres, aussi bien en bourse que sur son compte bancaire. On l’a dira électronique et non pas seulement en ligne car, chaque fois qu’une opération est initiée par le titulaire du compte, des processus d’identification lourds sont mis en œuvre. Il n’y a plus de papier ? Il faut pourtant que la banque s’assure que c’est bien la bonne personne qui donne les ordres. La relation devenant plus riche et plus complexe, la capacité du client à passer une plus grande variété d’ordres internes à ses comptes mais aussi, externe au profit à de personnes ou de banques extérieures à sa propre banque a fait de la banque électronique une catégorie bancaire bien à part.
En quoi cette évolution a-t-elle impacté les banques traditionnelles, à guichet en particulier ? En fait, elles ont progressivement transféré vers leurs clients la préparation, la vérification, la mise en application et le suivi des opérations ! Les guichets, traditionnels avant-postes du travail « papier des banques », ont perdu une part importante de leurs fonctions. De la capacité d’enter en communication avec des clients et de mettre en place des relations bancaires commerciales à distance, montage de crédit etc. sont nées des e-banques « pure players ». A cet stade, il est bon de rappeler, qu’internet ou pas, web ou pas, électronique ou e-paiements ou pas, une banque ne peut s’installer en France, ne serait-ce que sous la seule forme de son siège social que si elle a reçu l’agrément de la Banque de France. Donc, les banques pure players ont demandé des agréments et sont parties, comme leurs consœurs traditionnelles à la chasse aux clients. Leurs avantages ? Les coûts. Puisque pas de guichets, puisque pas d’employés en contacts avec les clients, puisque n’offrant pas la gamme des produits compliqués à manier, elles purent bâtir des fonds de commerce… jusqu’au jour où les banques traditionnelles se sont avisées qu’elles pouvaient, elles aussi, jouer dans cette cour-là.
Aujourd’hui…. les banques électroniques, en ligne, les e-banks sont des émanations des banques traditionnelles et de compagnies d’assurance qui les unes et les autres proposent des modes multimédia de gestion et d’entretien de leur clientèle. Et si aujourd’hui, il n’est toujours pas possible prendre son ordinateur pour un DAB, demain, l’évolution extrêmement rapide des technologies en matière de moyens de paiements modifiera plus profondément encore l’activité bancaire et les rapports des banques avec leurs clients.
Banques systémiques ou Sifi
Banques systémiques est moins élégant que « SIFI » (systemically important financial institutions) mais c’est la même chose. Cette nouvelle catégorie de banques apparue au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, a été, pendant quelques temps, une espèce d’objet incertain chargé d’énergie négative. Si on avait voulu faire une comparaison avec l’astrophysique, on aurait utilisé une comparaison avec les trous noirs ou les objets astronomiques à masse considérable qui siphonnent toute la matière dans leur environnement et dévie même le parcours de la lumière. Pour ceux qui voient l’univers financier comme celui de toutes les dépravations, une banque systémique aurait des points communs avec des vampires de première catégorie.
Puis, la notion s’est affinée. La réforme des exigences dites des accords de Bâle, sous la dénomination
Bâle III, qui concerne très directement les fonds propres des institutions financières, ceux des banques en premier lieu, a conduit à préciser ce que peut être
une Banque systémique. Pas simplement pour en faire un objet intéressant de l’univers de la finance, mais pour imposer des contraintes à son activité en sorte que les risques qu’elle fait peser
trouvent des contreparties ou des ressources palliatives.
Tout d’abord qu’est-ce qu’une banque systémique, en dehors des imprécations, des accusations de ploutocratie
apatride et du maniement des gousses d’ail ? C’est une banque dont l’activité fait courir des risques systémiques à l’ensemble des activités financières… et
dont les défaillances ne peuvent qu’avoir un impact négatif sur l’ensemble des activités économiques financières et non financières.
Les risques systémiques ne sont pas nécessairement issus des banques les plus considérables, même si la défaillance d’une « macro-banque », comporte nécessairement des risques systémiques. Il suffit d’imaginer une banque qui aurait pour spécialisation mondiale le traitement des OST (opérations sur titres), c'est-à-dire, de tous les évènements qui touchent des valeurs mobilières (paiement des dividendes, livraison sur achat, vote aux assemblées, division des titres etc.) et qui aurait une part considérable du marché. Sa faillite, sans que des capitaux considérables soient en cause, entraînerait des désordres systémiques gravissimes. Un critère important de risque systémique est la non-substituabilité, c'est-à-dire le fait qu’il n’existe pas au moment où le risque éclate, d’organisme, de processus opérationnel ou de produits financiers alternatifs disponibles rapidement et apte à rendre les mêmes services que l’institution ou les processus défaillants. Dans le cas cité plus haut, si la part de marché détenue est un monopole de fait, aucun autre établissement n’étant en mesure de se substituer, le risque systémique est avéré.
Pourquoi le critère de la taille n’est-il pas suffisant par lui-même ? La faillite d’une énorme banque sans aucune connexion avec aucune banque dans le monde y compris dans son pays d’origine serait certainement catastrophique pour ses déposants, pour l’économie de son pays, mais n’aurait pas d’incidence sur le monde financier extérieur.
Il n’en demeure pas moins que le critère de la taille est très important : lorsque Lehmann Brother est mise en état de cessation de paiement, l’impact est considérable sur l’univers bancaire pour deux raisons. La première : c’est une des banques d’affaires les plus considérables qui ne remplit pas ses engagements, la perte de confiance que la défaillance va induire, se répand alors comme une trainée de poudre et se traduit par l’assèchement du marché interbancaire dont le fonctionnement est vital pour le monde financier dans son ensemble. La seconde : les sommes en causes sont tellement importantes que la faillite de Lehmann entraîne des faillites en chaîne, comme une chute de dominos.
En définitive, cinq critères caractérisent une banque systémique: la taille du bilan, l'interconnexion de la banque avec les autres établissements bancaires, la couverture géographique de ses activités, la complexité de ses produits financiers ainsi que la faculté de la banque d'avoir des produits financiers de substitution.
Pour éviter l’effondrement du système bancaire et financier causé par la faillite d’une institution systémique banques les régulateurs du monde entier ont planché et conclu que les quelques trente grandes banques internationales systémiques seront soumises à des surcharges de capital comprises entre 1% et 2,5%. Soit un ratio de fonds propres où le tier one devra atteindre 9,5% au lieu des 7% appliqués aux banques non systémiques. Les banques concernées auront trois ans pour se mettre en conformité avec cette nouvelle exigence. La liste des banques n’était pas officiellement dressée à la mi-2011. Il était cependant évident qu’en Europe, parmi les élus, se trouvaient,BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank et UniCredit, qui devraient trouver 62 milliards d’euros de fonds propres nouveaux. Aux Etats-Unis, 175 milliards de dollars seraient requis pour Bank of America, Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo.
Cette exigence de capital supplémentaire est sans nuance : les fonds propres devront être constitués « d’actions ordinaires ». Ce point est très important : les titres hybrides dont quelques établissements espéraient qu’ils pourraient reprendre du service sont totalement exclus. Les fonds propres levés devront être de « vrais » fonds propres.
Parmi les institutions concernées certains ont poussé un soupir de soulagement : les Hedge Funds ne sont donc pas des banques. Ils craignaient d’être qualifiés ainsi et de se voir imposer des normes en matière de fonds propres.
D’autres se sont insurgés, estimant qu’un risque systémique ne pouvait pas être jugulé par des fonds propres mais par la qualité des actifs…
D’autres ont décidé « contre mauvaise fortune de faire bon cœur ». Un Président d’une banque systémique a vu dans cette qualification et les contraintes qui vont avec, un atout qui pourrait être exploité commercialement par la suite… le recours aux compétences des membres d’un club très fermé devrait avoir un prix !
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau