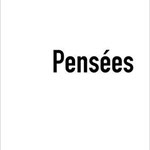- David Lynch et le miroir de l'âme
- La force des contraires: Asger Jorn et Pierre Wemaëre à la Maison du Danemark
- Ombre et désert, Patrick Loste chez GNG
- Jacques Grinberg: les coups de pinceaux grinçants
- Christian Maillard: voir et montrer
David Lynch et le miroir de l'âme

David Lynch à la Maison Européenne de la photographie, jusqu'au 16 mars.
Difficile de commenter l’œuvre photographique d’un cinéaste ! Difficile parce que l’envie est sans cesse présente de comparer l’œuvre cinématographique avec l’œuvre photographique. Difficile parce que, sans cesse, c’est au réalisateur qu’on a envie de revenir. Et puis, tant pis, admettons-le, l’exposition des œuvres de David Lynch à la MEP est intéressante justement parce que les photos exposées viennent d’un homme du cinéma.
A qui appartient David Lynch ? Plutôt que tourner autour des photos pour faire semblant de deviner, il vaut mieux y aller directement : il est de l’univers que partagent des Roger Ballen, Joel-Peter Witkin et quelques autres. La photo y est un miroir de l’âme, avec tout ce qu’elle porte en elle de mal, de déviant, de peur, d’angoisses, de laideurs et d’anormal. Photo miroir pour autant qu’on ait bien posé le miroir où il fallait, dans le bon angle, pour bien refléter ce qu’il faut refléter et non pas le superflu, le sympathique, l’optimiste, le beau, le bon et le bien. C’est aussi pourquoi il est bien difficile de départir dans le travail photographique de David Lynch ce qui est mise en scène de ce qui est montage, collage, superposition de négatifs. « Awaiting Childhood » est justement une belle composition trouble entre un avion dans le lointain et en premier plan un cheval de bois, gigantesque : au milieu entre le plan de l’action et le plan du cheval une petite silhouette. Ce n’est pas un enfant. La photo est « construite » en plans « logiques » en terme de perspective, mais complètement oniriques, dans leur détail, voire inquiétants, entre cheval de bois écrasant et cet avion qui énonce des lointains, des départs, des renoncements. Certaines photos renvoient à des idées de séries, « intériors », « window with head », où sont testés plusieurs reflets : photos réfléchies et pensées où l’artiste ne laisser rien au hasard.
Noir et blanc, la photo de David Lynch que nous propose la MEP, nous jette « Man Laughing » à la figure. Il ne reste du rire que le sous-rire, le rictus. Le propre de l’homme réduit à son essentiel physique. Entre ombre et lumière, le rire s’extrait du noir et s’inscrit sur une face blanche comme celle du clown triste. Y a-t-il parfois du surréalisme qui s’insinuerait ? « Windows with head and seeds » en donne le sentiment. Ou bien il s’agirait d’un rencontre à la Lautréamont ? Ou encore une référence aux grands ancêtres : La « tête » est-elle une lune à la Méliès ? On parlerait encore de Surréalisme avec les « seven candles » ?
A surréalisme, je préfère l’idée du « soleil noir » et celle du reflet de l’âme humaine dans un miroir approprié. Quand la violence est symbolisée, Série des fenêtres, « window with head 11 », mise en boîte ou en bière. Fœtus planant ou replis du cerveau. Ce n’est pas de sur-réalisme qu’il faut parler mais bien d’un réalisme qui s’appliquerait à la vie intérieure, aux penchants, pensées et obsessions qui occupent et s’occupent de notre âme.
Belle exposition d’un artiste en l’état futur d’achèvement ! Car toutes ces œuvres laissent le goût curieux du « devenir », de « l’après » et paraissent annoncer des œuvres à venir.
La force des contraires: Asger Jorn et Pierre Wemaëre à la Maison du Danemark
Ombre et désert, Patrick Loste chez GNG
La Force des contraires : Asger Jorn et Pierre Wemaëre
Ma courte chronique sur Pierre Wemaëre était mal venue. J’avais visité l’exposition en toute fin de cette dernière. J’avais bien reçu un petit mot de la galerie guillaume pour me dire qu’ils avaient décidé de poursuivre pour quelques jours… le temps de rédiger la Chronique au milieu de mille choses à faire et …je la mettais en ligne trop tard pour des regardeurs intéressés par une rare démonstration de « Cobra » français.
Finalement, j’ai eu raison de mettre en ligne cette chronique… sans le vouloir, elle anticipait une exposition à venir : « Wemaëre et Jorn, la force des contraires » qui vient d’ouvrir ses portes à la Maison du Danemark, sur les Champs-Elysées. Pour le coup, ne la ratez pas. Elle est remarquable.
La mise en parallèle, ou plutôt en compagnonnage, des deux peintres correspond à une réalité sympathique et déroutante : Wemaëre et Jorn que tout opposait, nationalités, familles, modes de pensée et de vie, se découvrirent, très jeunes élèves peintres de l’Atelier Léger et ne se quittèrent pratiquement plus, malgré les guerres, malgré les familles qu’ils fondront, malgré les différences profondes de leurs caractères et de leurs ambitions.
Amitiés fortes et amitiés actives, vécues, de travail l’un à côté de l’autre, ou ensemble sur les mêmes œuvres, ne formant plus qu’un peintre et un seul, puis, lorsque la mort de Jorn les aura séparé prématurément, un travail de réflexion de Wemaëre sur les œuvre de Jorn.
C’est sur cette partie de l’exposition que je commencerai : toute une série de dessins à la plume, à l’encre de chine et au crayon d’Asger Jorn, seront repris par Wemaëre plus de 15 ans après la mort du premier, comme, s’il fallait au survivant, continuer un discours, un échange, un travail en commun interrompu, inopinément. Le survivant retrouve exactement les violences du disparu, les rend plus fortes encore, introduisant couleurs acidulées, stridentes, ou sombres.
L’exposition est une façon de rétrospective : des œuvres des deux artistes sont présentés depuis les années de l’Atelier Léger jusqu’à la fin de leurs vies. La période précédant la seconde guerre mondiale est passionnante. Les deux peintres sont nés à un an de distance, l’un en 1913, l’autre en 1914. Ils vivent à Paris dans le bouillon de culture de la capitale artistique du monde : un univers où se côtoient les plus grands artistes de toutes les nations, ceux qui seront les monstres sacrés de demain, les fondateurs des principaux mouvements qui réformeront, révolutionnerons la peinture de l’après-guerre. Aussi ne faut-il pas s’étonner que les deux artistes, suivent, l’un avec l’autre et parfois à s’y méprendre entre l’un et l’autre, le travail de Miro, de Klee, Arp . Des accents surréalistes marquent leurs œuvres. En 1937, formes surréelles et objets impossibles peuplent leurs tableaux et leurs dessins.
Après la guerre, la violence se déchaîne ; c’est le mouvement Cobra dont Jorn est un des principaux fondateurs. Ce sont Dubuffet, Appel, Dotremont. Les formes se libèrent. La couleur se fait forme. Son déferlement, ses jaillissements partent à l’assaut du monde. Wemaëre, homme paisible et d’esprit traditionnaliste poursuit cette incroyable amitié avec le danois, instable, insatiable sans cesse en recherche. Les alternances entre leurs œuvres telles qu’elles sont présentées, frappent par leur profonde parenté, qu’ils soient l’un avec l’autre et font ateliers communs, qu’ils soient séparés par quelques milliers de kilomètres.
Cette fois-ci, impossible de manquer une exposition très intéressante. Jusqu’au 2 mars.
Patrick Loste, oeuvres chez GNG
jusqu’au 22 mars
Gilles Naudin poursuit sur une « ligne éditoriale » marquée du sceau de l’austérité, de la sévérité et du questionnement. L’exposition qu’il présente renvoie aux travaux de texturologie, à la matière, aux recherches sur les supports. Usant de la toile à bâche, à tente, à voile marine, mais aussi travaillant des papiers épais et rugueux, Patrick Loste renvoie à des temps immémoriaux où les surfaces des roches étaient rêches, accidentées, rugueuses. Les couleurs en semblent directement sorties, ocres, bruns, noirs et ivoires. Des cavaliers sont esquissés dans un lointain de brumes rouille ou de matins jaunes. On parlerait d’art pariétal… référence qui garantirait une charge émotionnelle particulière, n’était que les artistes « pariétaux », pensaient peu le désert et ses excès d’espaces. Pourquoi ne pas proposer que les chevaux, leurs cavaliers renverraient les regardeurs au souvenir des cavalcades dans les plaines sans fin du désert des Tartares et sur les rivages des Syrtes ?
Le cheval, est là, présent, et le cavalier, dans des peintures qu’on attribuerait au couteau, à la brosse et pas au pinceau. Ce sont des spectres de fumée qui apparaissent au détour des coulures noires et cendres jetées sur une toile à bâche, flottant librement, étrangère aux contraintes d’un cadre ou d’un encollage, d’un marouflage ou toute technique destinée à tenir fermement les œuvres dans un espace convenu. Convenable ? L’ombre pourrait-elle en profiter et passer la porte que lui a offerte le peintre ?
J’ai toujours la tentation de renvoyer l’inspiration et l’exécution de ces travaux si proches de la terre aux œuvres des peintres qui ont ouvert la voie aux matières et à leur exposition. Rompant avec les couleurs et volant à la sculpture les aspérités, les masses et les reliefs. Recherchant non pas la plage sous les pavés, mais les pavés sous le sable, la terre sous les gazons et la structure des roches comme substitut aux règles de la perspective. Patrick Loste est là mais n’y est pas… tout aux courses suggérées, par quelques traits, traces et esquisses, de troupeaux de chevaux et de leurs cavaliers.
De même que surgissent des ombres dans ses toiles, comme si l’humain pouvait venir de la matière. Les ombres n’ont pas une bonne réputation. On les voit souvent dans le royaume des Enfers. Elles viennent de la fumée ou des brouillards dans les œuvres de Patrick Loste, elles viennent aussi de coulures de plâtres et de terres. Elles émergent de rien et sont là, puissantes et menaçantes, issues de peintures ciment ou de couleurs grattées et griffées sur de papier fait à la main, grossier, rugueux, comme des roches, comme celles qui ont valu à l’art ce mot possible : pariétal.
Jacques Grinberg: les coups de pinceaux grinçants
Christian Maillard: voir et montrer
J’avais déjà écrit une chronique sur une belle exposition rétrospective organisée par la Cité des Arts : Jacques Grinberg (1941-2011) était à l’honneur. Toute une vie de peinture, de passion pour la peinture, pour les moyens qu’elle offre de dire de la meilleure façon les enthousiasmes, les peurs, les dénonciations d’un homme écartelé entre ses origines bulgares, sa vie française, ses affinités israéliennes et un passage à New-York. Jacques Grinberg avait connu toutes les formes d’expression pour, très tôt, s’appuyer sur l’expressionisme allemand, puis reprendre son registre à lui, ses techniques et ses thèmes.
L’exposition organisée par la Maison de la Bulgarie à Paris est aussi, d’une certaine façon, une rétrospective quoique avec une ambition plus limitée que la première. Le linéaire d’exposition moins imposant y est pour beaucoup. Par ailleurs, on trouve moins de peinture à l’huile, moins de « toiles ». La part des encres, des aquarelles et des techniques mixtes est plus grande. Ce n’est pas un mauvais choix. Il est fréquent que les œuvres sur papier paraissent plus « enlevées », spontanées, directes que « les huiles sur toile » où la technique contrait davantage.
On a parlé d’expressionisme allemand au début de la vie d’artiste de Jacques Grinberg. « Le médaillé » en est une illustration presque parfaite. On aurait trouvé cette œuvre dans un musée allemand qu’on n’en aurait pas été surpris. Œuvre forte, personnelle, elle annonce, programmatique, les thèmes et les fureurs de l’artiste. Celui-ci ne se dépeint ni heureux, ni insouciant, son auto-portrait à l’encre de chine le démontre à l’envi. Pas plus qu’il ne dépeint les autres avec le désir de peindre heureux et joli. « Soleil dans la tête » très belle technique, aquarelle et encre de chine, évoque un soleil de mort.
On assiste dans le cours de l’exposition à des hésitations stylistiques entre Picasso et Matisse. Les encres de chine remarquable, sombres et sinistres rehaussées d’aquarelle des années 1970 (« Cheval », « 8 ») témoignent d’une organisation de l’espace du tableau proche des représentations abstraites de l’Ecole de Paris. Plus tard 1985 « tête de rat » viendrait directement de l’image de Darth Vader ! Et toujours, le travail de Jacques Grinberg est constitué de gestes vifs, de coups de peinture à partir desquels le tableau s’élabore. L’impression qui vient, marquée surtout dans ses peintures sur toile, est celle d’un combat avec la toile, avec l’urgence de dire ou de crier. C’est en ce sens qu’on a pu dire plus haut que les œuvres sur papier sont « libérées », « enlevées », plus vivaces et vindicatives que les œuvres sur toile.
Plus tard, les cris et les dénonciations se font moins forts. On dira que l’âge appelle la paix et la sagesse. Je ne sais pas ce qu’il faut dire. Je vois que les bleus se font dominants. Que l’encre de chine noire et charbonneuse s’efface devant de grands traits colorés. Deux œuvres en sont des témoignages forts. L’une date de 1987, une très belle gouache bleue sur papier, et surtout, un travail magnifique: « sans titre », en 2011 l’année de sa mort. Un oiseau, tout fait de traces bleues, coups de pinceaux décidés. Il plane au-dessus d’un monde bleu.
Jusqu’au 22 février 2014, 28 rue de la Boëtie 75008.
Pérégrinations 70. A la galerie Françoise Paviot. 57, rue Sainte Anne. 75003.
Pourquoi pérégrinations 70 ? Parce qu’il y a 70 photos et parce qu’elles ont été prises à l’occasion de pérégrinations ? Je ne sais pas. Je n’ai pas demandé. J’ai passé du temps avec les photos. De deux choses l’une : ou bien les photos prises à l’occasion des pérégrinations sont des photos de souvenirs ; elles ne sont là que pour aider la mémoire à repositionner des lieux, à recadrer des moments en les dépouillant de la tendance à enjoliver ou à confondre ; elles sont aussi un peu là pour montrer aux copains, aux collègues et aux cousins qu’on y est bien allé, que c’était un très beau voyage « il faut le faire tant qu’il est encore temps ; le pays se transforme si vite » et « vous savez, le naturel s’enfuit au galop lorsque la musique des billets de banque vient chatouiller les oreilles des bons sauvages». Dans ce cas-là, mieux vaut oublier l’art et ses diverses manifestations. On se situe au niveau du livret publicitaire genre fêtes des familles ou de la communication RP des pays visités.
Ou bien les photos sont prises parce qu’une situation, un esprit, une lumière sont venus dont ne sait trop où se planter là où on n’attendait rien. Mais il faut être prêt, l’esprit sur le qui-vive. Il faut avoir entraîné son envie de voir, de saisir des moments hors la vue commune, des gestes imperceptibles ou de soudaines variations de lumière. Ces photos-là ne sont pas prises pour montrer, prouver ou attester. Elles sont une contribution à une démarche de liberté et de vérité. C’est une part de soi-même, être pensant, sensible, attentif qu’on livre si on veut montrer ces photos. Un partage, une réflexion qu’on soumet ou une lecture à haute voix. Les conserver pour soi ? Bien sûr aussi. Comme on conserve des confessions intimes, des carnets de notes, des lettres qu’on n’a jamais envoyées.
C’est ce registre-là qu’offre Christian Maillard aux regardeurs de tous poils. Il ne nous conduit pas au spectacle. Il n’offre pas à voir des couchers de soleil quand l’astre du jour va sombrer dans l’onde tranquille. Pas de sourire joyeux qu’illuminerait le bleu des yeux d’un charmant enfant sale au vêtement déchiré. Il nous propose sa part de vérité. Les fétus de beauté qui émergent ici ou là. L’acuité d’un regard en détresse. L’image choc, au-delà de la célèbre «rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie» ! Ainsi de cet homme obèse qui passe insensible aux monstres automobiles qu’il croise et dont les moteurs carrossés valent bien son ventre graisseux qui pendouille. Très belle photo dans le double sens de la qualité de l’image, de sa pertinence et celui de la maîtrise technique qui sous-tend sa puissance expressive.
Et aussi, cette photo au Viêt-Nam, à Hué, noir et blanc, d’une vieille femme, coiffée d’une serviette éponge ou tout autre textile, pour se protéger la tête. La main est levée, vers des touristes, vers des piécettes ? Le visage est tendu. De cette vieille femme on ne voit rien d’autre qu’un mouvement de torsion qui emporte tout le corps pour porter le regard et la main. Plan impeccable. L'ntensité de cette scène est merveilleusement rendue.
Est-on à Naples, dans une des rues étroites du quartier des Espagnols où les fils à faire sécher le linge dessinent des arabesques ou reproduisent les fils noirs de certaines araignées gigantesques ? Non ! Nous sommes dans les rues d’une ville des Balkans qui ajoutent aux fils à vocations « lingères » des napolitaines quelques fils électriques, des antennes pour la télé et d’autres liens non explicités.
A voir jusqu’au 1er mars.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau