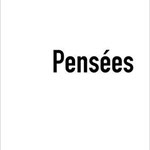Vite 2
- Chroniquer un artiste dont le travail vous laisse dubitatif (deux parties)
- Anouk Grinberg chez GNG
- Erwan Morere et Yusuf Sevincli, chez "Les filles du Calvaire"
- Stanilas Guigui à la Galerie particulière
- Brassaï à l'Hôtel de Ville
Chroniquer un artiste dont le travail laisse dubitatif ou mal à l'aise. 1ère Partie
Chroniquer un artiste dont le travail laisse dubitatif ou mal à l'aise. 2ème Partie

Pourquoi serait-on mal à l’aise en face d’une œuvre ? Comment devient-on, se découvre-t-on dubitatif ? Ne s’agit-il pas ici de la « question du regardeur » ? Pourquoi regarde-t-on une œuvre d’art ? Quand sait-on qu’on regarde une œuvre d’art ? Et pourquoi regarder ? Et qu’est-ce que regarder ? Problématique traditionnelle, enfantine, traitée par tous les critiques et les théoriciens de l’art, direz-vous. Point n’est besoin de s’y attarder ! Il suffit de relire un peu de Freud, quelques morceaux de Jung, des bouts de Lacan. Et aussi, le théoricien en chef de l’art, l’artiste qui manquait de génie et a préféré se réserver le domaine des idées d’où pourraient bien éclore les génies, Duchamp, n’a-t-il pas dit tout ce qu’il fallait dire sur la contribution artistique du regardeur. Pourquoi regarder ? Mais enfin, parce que c’est du regard du regardeur que nait la nécessité de regarder, c’est-à-dire l’œuvre d’art. La boucle est bouclée, l’art nait du regard du regardeur qui regarde l’art. L’artiste n’est que l’accoucheur du regard du regardeur…
La suite de cette chronique en suivant ce lien.

Entre subversion du regard et « trompe l’âme »
Suite de l'article paru le 19 janvier. L'auteur est conduit par son regard de regardeur et s'interroge sur les chemins étranges qu'il suit. Que faut-il regarder pour être regardeur? Qu'est-ce que regarder? Où et quand peut-on se dire "regardeur d'art"? L'art est-il fait par le regardeur? Toutes questions dont on voit bien l'importance au regard de la vie de l'art!
J’entre parce que ce que je vois de sa peinture derrière la vitrine de la galerie m’intrigue. Elle m’appelle aussi d’une curieuse façon. Elle semble me dire qu’elle me connait. Nous nous serions peut-être rencontrés quelque part dans un musée ou à de certains moments où elles étaient accrochées à d’autres cimaises, dans d’autres temps. Cela arrive plus souvent qu’on ne croit. Comme il nous arrive dans la rue de reconnaître quelqu’un qu’on n’a jamais connu: Eric Lepoureau 2013
Anouk Grinberg chez GNG
Erwan Morere et Yusuf Sevincli, chez "Les filles du Calvaire"

GNG, 3 rue Visconti 75003 paris
Jusqu’au 8 février
Félures et déchirures
Il y a près d’un an, j’avais « chroniqué » l’exposition du travail d’Anouk Grinberg dans le même lieu : Gilles Naudin Galerie. ( suivre ce lien) Et j’avais conclu ainsi : « Je ne crois pas aux dons naturels. Les sentiments forts et vrais, des millions de gens en ont. La joie, la peine, la vie, la mort. Des centaines de milliers de gens pour les ressentir. Si peu pour créer et réinventer cette joie, cette peine, et la vie, et la mort… ».
Faire face à la peinture d’Anouk Grinberg c’est prendre deux risques : celui de ne pas chercher d’où elle vient et celui d’être trop convaincu d’avoir compris d’où « cela » venait. Les sentiments forts et vrais, tout le monde en a. Tous les artistes usent de ce qu’ils ont, portent, souffrent en eux pour nourrir leur travail. Et ce qu’ils verraient du monde deviendrait aussi ce qu’ils portent en eux. Si le monde souffre, cette souffrance devient alors la leur. Aussi ne peut-on pas éluder la recherche du « d’où ». Mais, il serait douteux de le vouloir en unique expression d’une fêlure personnelle. Ce qui émerge de la création artistique à partir des morceaux d’eux-mêmes qu’y ont concassés les artistes a trait à tous ceux qui veulent bien s’arrêter et regarder. Les dessins appelleront ces fêlures, ces interstices entre raison et déraison, vouloir et souffrir, aimer et comprendre, qui animent les êtres. Dessins, gravures, traits couleurs, intercesseurs et opérateurs de l’âme et de la vérité.
D’où vient que ces petits dessins, tracés à la plume, paraissent être des notes mentales. Des pense-bêtes. Souffrances à ne pas oublier. Nœuds mis à des mouchoirs encore humides de trop de larmes versées. Brisures de dessins, comme des cartes… à ne pas jouer ? On y verra des coupures. Les bords déchirés d’un papier en morceau. Cartes coupées qu’on n’a pas jouées. L’une est noire et grise, dédoublée. D’où vient qu’un nuage noir et massif, se conçoive comme une énorme menace venue à peser, à écraser une sorte de minuscule chaumière. D’où vient que ce drame se déroule si clairement dans l’espace d’une petite feuille de carton pas tellement plus grande qu’une carte à jouer. Il faudrait convoquer les peurs d’une enfance. Inviter la psychologie des profondeurs ? Je pense qu’on perdrait son temps. Il vient de ces fétus d’art, une force qui n’est pas de ce domaine-là, mais de celui du dire de l’art. Ces traces ne sont pas des mots pour comprendre intimement Anouk Grinberg mais pour comprendre qu’un artiste se sert de lui-même et de ses secrets pour aller au plus profond de ses regardeurs et de leurs secrets. Je ne sais pas si l’artiste parle d’elle-même, en dessinant un être massif et monstrueusement grand par rapport aux enfants qui lui donnent leurs mains. Je sais qu’elle convoque chez chacun des regardeurs, de ceux qui ont voulu affronter ces œuvres et vivre quelques minutes avec elles et fait venir des images très fortes.
Au côté de ces petits formats en façon de billets où naissent des araignées, des dessins ou des encres, les succubes sont-ils au rendez-vous ou bien les diables qui ont peuplés les peurs enfantines. Les monstres sont-ils bleus comme la nuit ? Attendront-ils le matin pour que leurs formes s’évanouissent ? Les ours s’invitent-ils à table ou se proposent-ils d’attendre un peu avant de dévorer les enfants ? Un grand dessin vert tendre montre un visage qui médite, ou qui observe, monstres et griffures. Les visages qui s’extraient de masses sombres, les yeux qui observent comme retranchés dans des vêtements ou des corps trop grands, sont comme ce nuage de fumée qui pourrait être un oiseau, ils énoncent une présence au monde et son épaisseur entre fuites, menaces et distance.
Entre trouble et brouillard
Vite, vite, car l’exposition s’achève ! Vous avez encore une journée et demie. Bien dommage d’être ainsi pressé par le temps car les « Filles du calvaire » présentent jusqu’au 11 janvier deux photographes remarquables.
Yusuf Sevincli, good dog

On va dire qu’il faut bien donner un nom aux expositions. C’est le titre que porte le livre qui rassemble toutes les photos de l’exposition. Yusuf propose une vision qui m’a séduit instantanément. Il est jeune encore et pourtant tout ce qu’il propose est bien posé. Fort, depuis ces portraits de deux jeunes femmes qui regardent intensément le regardeur, jusqu’à la recomposition dans des photos parfaitement construites, d’immeubles, de rues et de bâtiments. Son goût pour le halo « argentique » et le flou maîtrisé de certaines compositions donne un accent de mystère a son travail.
La photo d’un réverbère en cours de réparation renvoie à celle de fleurs dans un vase. Deux œuvres mystérieuses attirent le regard : une petite fille grimée dans une robe blanche, une autre, point focal d’une mise en scène où tout est construit autour de l’ombre et de la lumière. Entre clarté et noirceur, une fillette émerge et darde un regard intense et lumineux. Des immeubles émergent de la nuit et du brouillard et prennent des poses de sculptures ou de défis à la vue. Rien à dire. Une photo impeccable. Très proche encore de sources d’inspiration allemandes et suédoises. On sent ici des influences. Ackermann, Stromhölm, Petersen ? Peu importe. L’art se déploie dans l’art. L’artiste qui avance est accompagné de tous ceux qu’il admire. Et puis un jour le talent coupe les liens et il faut avancer tout seul. C’est le pire que je peux souhaiter à Yusuf Sevincli.
Erwan Molere, Wildside

29 ans et une maturité exceptionnelle. Le travail d’Erwan Morere à l’inverse de Yusuf Sevincli n’est pas traçable dans celui des Allemands ou Suédois qu’on a mentionnés. Il me parait « inclassable » ou bien ressortissant d’une école française où le regard en fouillant ce qui est à portée de vue dégage l’essentiel. Pas de photos de détails : si un chien passe sur une grève, il faut y voir un signe de vie dans un espace qui a vocation à l’infini. Les choses et les paysages sont de très belles constructions pour qui ne veut pas se laisser distraire par les feuilles des arbres ou les myriades de gouttes d’eau du torrent qui dévale. Par moment, son goût pour les perspectives, où se devinent des lignes de fuite qui convergent vers l’infini m’a rappelé Anselm Kieffer. Mais aussi, chez Erwan Morere un travail « théorique » est là, présent, qui conduit l’action. On le trouve en particulier dans un paysage, noir, fond de forêt, coupé par une bande blanche. Les dimensions traditionnelles sont chahutées. Se dessine sur le blanc du paysage, l’ombre portée d’un avion. Dans quel type d’univers se trouve-t-on où bas, haut, devant et derrière se percutent ? Un peu plus loin, c’est un arc en ciel, en noir et blanc qui dessine un parfait demi-cercle. Tout est noir autour ou gris et sombre autour de l’arc en ciel et conduit le regardeur à interroger l’image. A rechercher les « Pourquoi ? ». A entrer dans la photo pour aller vers son plus profond.
A suivre de près. Talent en cours de construction.
Stanilas Guigui à la Galerie particulière
Brassaï à l'Hôtel de Ville

Certaines promenades s’achèvent en vous laissant le sentiment que vous avez fait une bonne pioche !
Parce que vous êtes « tombés » par hasard sur une galerie que vous ne connaissiez pas. Parce que, pour une raison qui vous a échappé, vous êtes entrés. Quelques gouttes de pluie ou cette galerie-là, ouverte en tout début d’année alors que toutes les autres sont fermées ? Un geste de reconnaissance à l’égard des gens qui travaillent quand tous les autres se sont mis au « repos hivernal » comme les pelouses des parcs de Paris ?
Une fois dans la galerie, la découverte ! L’étonnement ! Une exposition de photos en tout point remarquable. L’auteur est Stanislas Guigui. Français qui a décidé de travailler à Bogota et de portraiturer toute une faune. Faune, pas du tout au sens de « l’après-midi », mais au sens animal. Des hommes et des femmes des bas-fonds de Bogota. Déchirés, démolis, abîmés, cassés, défoncés. Habillés ? Pas vraiment, plutôt recouverts de haillons en tous genres. Stanislas Guigui les a photographiés adossés à un mur blanc. Un mur recouvert de chaux. Et tous, se sont laissé « tirer le portraits » après s’être fait attirer devant ce mur, impersonnel, qui ne dit rien comme un décor, ou un fond ou un intérieur. Le mur anéantit tout : temps, lieux, circonstances et parce qu’il est blanc projette en avant, les misérables et leurs couleurs, leurs têtes sales, leurs vêtements troués, leurs bouteilles de gnoles. On dira que l’auteur a su leur donner une sorte de dignité, les faisant poser devant l’appareil, ils se sont posés, quelques instants dans l’existence à leurs propres yeux. Disons-le. Disons surtout que ces photos sont bien faites, intéressantes, parfois lumineuses, parfois très sombres. Toujours intéressantes. Merci au hasard.
Vite, il faut aller Galerie particulière, 16 rue du Perche dans le 3ème arrondissement, jusqu’au 12 janvier.

Vite pour écrire ce texte, lentement pour déambuler parmi les photos de Brassaï, dans Paris la nuit, dans la lumière des phares et dans les halos de brouillards. Lentement pour retrouver des images si proches et pourtant si lointaines d’un Paris d’autrefois qu’on connait comme aujourd’hui. Brassaï ne cesse de le porter à nos yeux. Allez donc à Montmartre, descendre quelque escalier. Revenez me dire que vous avez rencontré un vieux monsieur qui ressemble à Brassaï et qui photographie comme on caresse.
Aimer un pays, aimer une ville impose de s’y donner tout entier. C’est ce qu’à fait Brassaï tout en inventant une façon de regarder et en faisant émerger de l’obscurité, un Paris nouveau tout fait des quartiers malfamés, des belles avenues, des façons de vivre de gens qui ne se rencontraient pas, les façons d’être ensemble des gens du même acabit, apaches, belles de nuit, dames aux rangs de perles, voitures de luxe, Maxim’s et Montmartre, Ménilmontant et quelques amoureux. Pouvez-vous me dire où se trouve Tabarin ? Taxi, vite au Vel’div, je dois absolument y être pour dîner.
Vite pour n’avoir pas à répéter tous ce qui été dit, bien dit, sur le noir si lumineux de Brassaï, sur les ombres qui ne servent qu’à mettre en valeur la clarté, sur le clair-obscur des journées brouillardeuses et les fleuves de feux qui dévalent sur les boulevards et submergent Paris nocturne ; effets de perspectives, escaliers qui dévalent, murs de prison qui fuient dans un lointain sans fin, enfants de riches, enfants de pauvres.
Rien de plus à dire sur un géant et le regard qu’il a lancé et qui ne cesse de poursuivre sa course.
Vous avez jusqu’au 8 mars. C’est à l’hôtel de Ville.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau