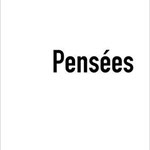Walker Evans à Beaubourg

Retrospective de l’œuvre de Walker Evans.
Musée Beaubourg. Jusqu’au 14 août
L’homme qui a changé l’orientation des objectifs
Bien sûr, l’œuvre photographique de Walker Evans comporte des photos magnifiques. Certaines sont devenues iconiques. Le couple de métayer, les Burroughs, d’Alabama, les photos de mineurs cubains, celles d’objets utilitaires, de magnifiques photos d’outils à la beauté épurée, objets dont on dira, pour suivre les poncifs, qu’ils retrouvent grâce au photographe, leur honneur d’outils devenus beaux à force d’être utiles!
Bien sûr… mais aussi quelques-unes de ces images mythiques ont été parfois extraites d’images plus générales. Tel personnage a été comme arraché au groupe auquel il appartenait pour être mis en valeur, parce qu’il y avait là une belle photo, un beau portrait qui pouvait être individualisé. Je ne suis pas sûr que c’est le meilleur de Walker Evans. En fait, au lieu de « meilleur » j’ai envie de dire que ce n’est pas vraiment du Walker Evans. Ce n’est pas son style que de faire du style. Ce n’est pas non plus sa photo que de faire de la belle photo. Là est le nœud. Là est la question Walker Evans.
Il faut prendre le problème autrement. Pourquoi s’intéresser à un photographe compulsivement obsédé par les images, les siennes qu’il prend comme un boulimique absorbe des hamburgers, et celles des autres qu’il accumule comme s’il avait été atteint de cette affection caractérielle nommée « le syndrome de Diogène » ? Pourquoi s’intéresser à un photographe qui ne se contentait pas d’accumuler les photos mais aussi les objets qui avaient été, auraient pu être, seraient peut-être des sujets de photos ou… pas ? Qu’est-ce qu’il a d’exceptionnel ce type, en dehors de quelques belles photos, comme d’autres bons photographes en ont prises, et des milliers de photos de choses sans intérêt, entassées avec toutes sortes de collections d’objets sans intérêt ?
Essayons de trouver des points d’appui. Ça y est! On a trouvé : sûrement, il y avait du Duchamp dans cette démarche. Du Duchamp rustique. Un Duchamp qui n’avait pas la chance d’avoir le catalogue de la Manufacture des Armes et Cycles de Saint Etienne sous la main. Un Duchamp qui se serait mis à travailler pour trouver des tas d’objets intéressants. Ou bien, un André Breton, qui se serait efforcé de rassembler des objets en tous genres afin, dans un geste splendidement poétique d’extraire le beau à partir du rien ou de l’incongru comme celui que Lautréamont chantait « la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ». Rien de tout cela. Ceux-là sont les intellectuels d’une société qui cherchent de nouveaux Alcools. Walker Evans n’en fait pas partie. Le génie de cet homme est ailleurs. Génie ? Pourquoi, ici et maintenant, évoquer ce mot gênant qu’est « génie ». Pourquoi, introduire subrepticement un soupçon d’homme providentiel, une once de héros artistique ?
Hopper. Je ne veux pas dire que Walker Evans est un génie comme Hopper. Je veux dire que Hopper a été à la rencontre d’une forme de réalité pour y exprimer ses angoisses et que c’est bien de cette réalité-là que Walker Evans est le génie. Hopper est un des premiers peintres à introduire la modernité dans les images proposées aux regardeurs. Il y avait eu Monet et ses gares floutées dans des volutes de fumées, de vapeurs et de brumes matinales ou vespérales. Il y avait eu toute l’école réaliste belge en particulier qui avait su montrer les ouvriers, les laboureurs, la misère, les petits boulots et les grandes usines. Mais finalement peu de gens pour montrer ce que la vie montre couramment, banalement, habituellement dans les pays modernes. Sans autre intention que de montrer. Sans intention nécessaire de dénoncer, pas plus que d’annoncer. Hopper, montre des pompes à essence, dans le soir, pareils à des grands arbres d’un genre particulier. Il affirme la vérité de l’illumination d’une rue par le moyen d’un bar totalement vitré : on ne sait plus bien de quelle réalité on parle, celle du bar qui écarte la nuit ou celle de la nuit qui fait le siège du bar.
Hopper, fait partie de ces gens qui font venir devant le regardeur les objets qu’on ne regarde plus tant ils font partie du paysage. Voilà le génie de Walker Evans : il a, un jour, décidé de regarder le paysage. Or, le paysage d’un pays moderne, industriel, consommateur de choses et d’images et plein de gens en mouvement dans les rues, les chemins, les métro, ce n'est pas exactement le paysage de Thoreau à Walden, ou celui dont les peintres du grand ouest faisaient une description parfois méticuleuse. Où est le génie ? Il est dans ce simple fait que le photographe a, ce jour-là, changé la direction de son objectif. La nature, a-t-il décidé, ce ne sont pas ces jolies petites fleurs sur le bord des chemins, ce ne sont pas les meules de foin, ni les vaches dans les prés, ni les beaux ciels, ni les bestioles qui déambulent de façon merveilleusement surprenante, ni les paysages durs et ingrats des grandes plaines américaines après les tornades de poussière. La réalité de notre monde est pleine du discours des hommes sur leurs œuvres les plus banales, affiches, avertissements, panneaux de signalisation. Ce sont ces églises qui s’égrènent toutes pareilles, construites comme des maisons à quoi on a ajouté deux ou trois détails qui en feront des temples. Si on avait ajouté un autre type de décoration cela aurait été un garage, une devanture de pièces détachées pour automobiles…
La réalité du monde que le photographe saisit, ce sont aussi ces zones où sont échouées de vieilles bagnoles, des détritus, des choses qui n’ont plus que le souvenir d’un nom ou d’une fonction. Ils sont bien loin les égouttoirs et les porte-bouteilles et les urinoirs de Duchamp. Walker Evans ne glorifie, ni n’abaisse : il répertorie l’univers des vivants et, si urinoir il y a, il ne vaut pas mieux et ne dit pas davantage que la porte ouvragée d’une maison de bois, ou d’une autre un peu différente mais pas tant que ça, ou d’une autre encore...
En quoi est-ce génial que d’avoir fait venir à la vue ce qu’on avait sous le nez ? Car à qui fera-t-on croire que les affiches ne se voient pas, même quand elles sont déchirées. Et puis, qui n’a vu dans son existence ces paysages estampés d’un panneau, « no trespassing », d’un « no gunning » ou de ces maisons chargées de « to let » ? Qui peut prétendre qu’on ne voit pas les magasins de n’importe quoi et leurs affiches, leurs enseignes, leurs offres toutes mirobolantes dont la seule raison d’être est justement d’attirer le regard?
Walker Evans a retourné l’objectif de sa caméra et, ce faisant, a fait surgir dans le champ de vision des regardeurs toutes ces choses dont ils avaient pris l’habitude parce qu'ils en étaient à la fois cause et effet. Il n’a pas vraiment donné de lettres de noblesse à la photographie documentaire. Il ne documente pas. Ou, quand il donne le sentiment qu’il documente, c’est une fausse excuse : il accumule. On pourrait dire alors qu’il accumule des preuves, des indices, des faits, qui, sous peu, seront corroborant et montreront comme le déroulé d’une enquête. Ce n’est pas du tout ça : comme le collectionneur, il entasse, il stocke, il enferme des milliers de choses, des milliers d’images ramassées, achetées, récupérées, des milliers d’images qu’il a prises pour compléter l’empilement qu’il a entrepris. Ce faisant, il annonce que tout ce qu’il a décidé de voir mérite le regard. Et il bouleverse d’un seul coup, sans le vouloir, sans l’avoir recherché, les codes de la représentation et du regard. Après lui, tout sera possible à ceux qui veulent avoir le courage de voir. Il n’aura pas rompu avec le regard, il aura simplement un jour décidé de tourner sa caméra vers d’autres réalités, d’autres détails, signes, indices, ceux qui nous accompagnent tous les jours, comme autrefois, les coquelicots étaient dans les prés, les laitières dans les tableaux des flamands et les Christ en croix en appelaient au regard des croyants.
Il a fait venir à notre conscience que le monde dans lequel nous vivons et que nous avons fabriqué peut être vu tel qu’il est. Tel que nous le faisons.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau