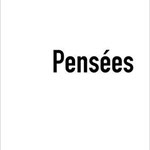Irving Penn, au Grand Palais

Exposition Irving Penn
Grand Palais,
Jusqu’au 29 janvier
C’est une très belle exposition. Il faut approuver le retrait des « commissaires d’exposition » et des organisateurs devant l’œuvre. Ils la laissent parler d’elle-même. Elle est frappante par elle-même et dès le début de l’exposition énonce ce qui va être un fil conducteur de toute une vie : l’objectivisation du voir.
Cela fait très prétentieux ! Pourtant, j’ai été subjugué très rapidement par ce que la photographie d’Irving Penn comporte de distanciation par rapport au sujet. Il est étonnant de voir à quel point aussi, tant pour ce qui concerne les photos de personnes (les portraits, en pieds ou non) que les photos d’objets, ses photos, qu’elles soient prises en 1940 ou 1990 expriment toutes une volonté de montrer des formes, d’organiser et de mettre en scène leur « monstration », et d’éliminer tout ce qui pourrait être contextuel : temps, lieux, et même thèmes et cultures.
La photographie d’Irving Penn est une fantastique mise en place et installation de ce qu’on nomme dans les pays anglo-saxons : « Still Life », « La vie tranquille », comme il en est de la « still water », l’eau qui ne bouge pas, par opposition à l’eau pétillante, celle qui saute et vit, qui jaillit et s’échappe. « Still life » ne veut pas dire pas de vie, mais, une vie sous contrôle, qu’on ne laisse pas aller, à laquelle on imposera des brides courtes .
Cette vie aurait-elle des prétentions au naturel ? Elle en appellerait au temps qui passe ? Elle voudrait qu’on lui rende son royaume, la rue, les grands espaces, le sables du désert et
l’eau des rivières ? Irving Penn en a décidé autrement. Il définit précisément la nature dont il a besoin et si celle-ci doit ressembler à une encoignure de porte, ou à un tapis élimé, ou à
un rideau pas très propre, il les choisira quitte à ce que ce qui se passe dans la vie en sorte mutilé ou moins dramatiquement quitte à cela se déroule toujours dans une sorte de boîte
aveugle : l’atelier. La nature serait ce qui reste quand on a tout oublié. C’est-à-dire pas grand-chose. Même lorsqu’il est au Pérou, les montagnes s’effacent derrière un studio bricolé dans
une cabane où tout est ce qui est naturel est aboli.
Au profit de quoi cette évacuation du « naturel » ? Pourquoi le photographe a-t-il à ce point écarté la nature ? Comment comprendre qu’il ait préféré photographier des célébrités, des « beautiful people » tout autant que les gens ordinaires dans des studios fermés, sans autre lumière que des sun-lights, sans autre décor que des machins bidouillés ou usagés ? La réponse n’est-elle pas limpide, dès ses premières photos ? Des « nature morte » justement qui apparaissent au tout début de sa carrière et qui sont les premières œuvres qu’on rencontre lors de cette magnifique exposition.
Or, ces natures mortes, sont de purs chefs d’œuvre : construction pure, cadrage impeccable, équilibre des formes et des volumes, accords des nuances de gris et de noirs, accord aussi des couleurs. Sans compter la part d’humour. « Still life, with watermelon » est un grand sourire de satisfaction après avoir bien dîner, les restes, les morceaux de pain à moitié consommés, la mouche que personne ne chasse… On peut extrapoler et montrer qu’il exprime l’absence d’un convive qui avait été là mais qui n’y est plus… la vérité est que ces « nature morte » sont des compositions confinant l’abstraction au sens où rien n’est moins naturel, rien n’est moins subjectif ni émotionnel que ces accumulations calculées d’objets mis en scène par un artiste volontariste. Paraphrasons : « la photo ce serait des formes dans un certain ordre, disposées »….
Faut-il démontrer cet impératif d’objectivisation ? On prendra deux exemples qui, à des années d’intervalle montre comment le photographe « dégage » de sa prise de vue toute recherche autre que celles sur les rapports entre forme, masse, ordre et rapports de lumière. Ce sont « Harlequin dress » qui date de 1950 et « Four Guedras » 1971. Espace totalement maitrisé, décontextualisation absolue, au point qu’on s’interroge sur le mannequin de Harlequin et sa réalité. Même considération pour les « quatre guedras » dont seul le titre français indique qu’il s’agit de danseuses et qui pourraient être n’importe quelles formes de n’importe quoi. Il faut l’exception d’un visage, qui se devine derrière un voile pour qu’on en vienne à l’idée qu’il ne s’agit pas de formes abstraites posées, là, devant l’objectif en « un certain ordre » décidé par le photographe.
Cette manifestation de totale indépendance du photographe par rapport au sujet qu’il traite se voit dans bon nombre de portraits ou de représentations humaines. La « femme de Cuczo, baissant la tête » est-elle une ombre qui le photographe a réussi à faire tenir debout ou une version « américaine » de la femme de Loth, une fois statufiée. Dans les faits, elle est « forme » tout autant que les « butts », les mégots de cigarettes, ramassés dans le caniveau et qu’Irving Penn a photographiés comme des objets aussi dignes d’intérêt que ses « corps nus ». Écartons les interprétations de type « philosophie sociale ». Oublions les magnifiques envolées sur le thème « il a voulu dénoncer » « il montre que la société se délite… ». C’est ailleurs qu’il faut les retrouver ces cigarettes : elles prennent leur dimension d’objet d’art dans la fascination qu’éprouve Irving Penn pour l’objet en tant que forme et non pas pour l’image d’un objet qui pourrait prétendre à être porte-parole, porteur de message, énonciateur de situations et reflet d’autres choses que le regardeur devrait aller chercher dans sa mémoire ou dans ses phobies.
Irving Penn traite de ces bouts de cigarettes comme il traite des métiers qu’il a portraituré. Regardons-les de près. A des milliers d’années-lumière de ceux qui ont valu tant de commentaires laudateurs à August Sanders. Regardons-les de près tous ceux-là qui ne représentent pas des métiers mais qui les jouent au sens le plus artificiel et le plus désincarné. Sa photo de chiffonnier anglais 1950, celle du facteur français ne sont pas autres choses que des images de pantomimes. Ils sont aussi sincèrement « facteur » et « chiffonnier » que les « enfants de Cuczo » sont des enfants « à Cuczo »: comme le postier de France est à peine postier, ce ne sont pas des enfants, ce sont des objets que le photographe a posés et qui, à peu de choses près, se rapprochent des « still life » qu’on a commentées au tout début de cette chronique.
Héroïsme de la forme où les canons de la peinture abstraite sont presque totalement et fidèlement transcrits ? Il faut aller vers les photos de mode, après avoir visité les « mégots de cigarettes ». Les compositions d’Irving Penn sont grandioses dans ce domaine « de commande ». "Spanish Hat by Tatiana… 1949 ", est à peine plus récent que les «still life» et... c’est une "still life". Plus exactement, c’est une composition qui se rapproche au plus près des compositions de l’abstraction d’entre-deux guerres. On dira qu’on voit bien qu’il s’agit d’un portrait et qu’un personnage émerge. C’est donner vraiment beaucoup d’importance au visage dont on perçoit tout le schématisme et une mise en scène dépersonnalisante. (Jusqu’aux lèvres qui participent « nécessairement » de cette « dépersonnalisation »). La photo ici est une composition de noirs et de blancs, exceptionnellement bien structurée comme on pourrait le dire d’un tableau de Braque.
Les plus magnifiques portraits que livre Irving Penn sont à mon sens représentés par celui de Marlène Dietrich et son pendant, celui de Louis Jouvet, où les masses noires emplissent presque entièrement la photo. Où, les visages, perdus dans ces masses parlent si fortement. Il y a aussi la masse du portrait de Colette. Fait-elle pendant à « Harlequin »? On pourrait le penser. Colette serait « l’après » d’ « Harlequin » quand l’âge introduit le désordre dans les formes, quand l’humain essaie de reprendre ses droits.
Irving Penn aurait choséifié son environnement ? Il aurait voulu le monde, statique, immobile, épais, lourd ? Il est vrai que rien n’est léger dans son œuvre. Tout est pondéreux, massif, les corps comme les fleurs. Les photos de nus renvoient à la sculpture et quand il les tord et les maltraite, il renvoie à la sculpture moderne. Ce qu’il fait aux corps, il l’inflige aussi aux fleurs. Peut-être, pour photographier les « pavots » a-t-il introduit ce qu’il n’avait accepté que très rarement : la transparence, cette irruption de la légèreté des choses, de leur fragilité, symboles du temps qui passe… Mais, toujours, ces photos sont l’expression d’un désir de pure représentation au-delà de tout réel : représentation abstraite où la forme, colorée ou non, règne ne maîtresse. (au fait: évitons les interprétations sexuelles...)
Irving Penn a réussi toute sa vie à bâtir opiniâtrement un monde où les sujets de l’artiste sont en vérité des objets « ordonnables » et qui doivent la puissance de leur représentation à ce statut, pour l’éternité.
A voir et à revoir.
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau