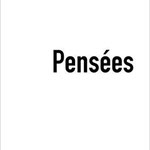Baselitz au musée Pompidou
Quelques notes en guise d’introduction
Baselitz est, une fois de plus, exposé à Paris. Cette fois, c’est une sorte de couronnement, la consécration d’une œuvre exceptionnelle, faite de sculptures gigantesques et d’une peinture violente. Dans mon panthéon de la peinture allemande règne après l’immense Kiefer, un trio fantastique, Baselitz, Lüpertz et Immendorf. Je serais tenté de dire du premier qu’il est un romantique de la désolation.

Quelques notes en guise d’introduction
Baselitz est, une fois de plus, exposé à Paris. Cette fois, c’est une sorte de couronnement, la consécration d’une œuvre exceptionnelle, faite de sculptures gigantesques et d’une peinture violente. Dans mon panthéon de la peinture allemande règne après l’immense Kiefer, un trio fantastique, Baselitz, Lüpertz et Immendorf. Je serais tenté de dire du premier qu’il est un romantique de la désolation.
Puisque j’entame cette chronique par des comparaisons, toujours abusives lorsqu’il s’agit de pures œuvres de l’esprit, je suis condamné à continuer pour épuiser ce sujet précis.
Il est justifié de comparer les œuvres de Kiefer et de Baselitz. Il est, pour une fois, légitime de rappeler qu’elles ne viennent pas du tout du même univers bien que ce soit d’art allemand et d’artistes « d’après-guerre » qu’il est question. Kiefer est né aux confins de l’Alsace et de la Suisse, dans l’Allemagne la plus à l’ouest, la moins touchée par la guerre. Baselitz, tout à l’opposé, en Saxe, est né à deux pas de Dresde en Allemagne de l’Est. Si on croit à l’influence de la géographie sur la création artistique, ces deux éléments, expliqueraient à eux seuls les choix artistiques radicalement opposés des deux hommes. Pour Baselitz, enfant, la traversée de Dresde totalement détruite par des raids aériens américains et anglais aurait été profondément marquante. On devrait à cet évènement son romantisme post expressionniste. Quand l’œuvre de Kiefer, en appelle, non pas à la destruction des hommes et des choses mais aux drames de la pensée et à la sévérité des poêtes.
Ces comparaisons sont vraiment trop faciles. C’est du « making of » à la petite semaine !
Quittons-le, et retournons vers Baselitz et à la magnifique exposition du musée Pompidou.
On y trouvera un peintre « dans tous ses états », dont l’œuvre parle d’un monde qui s’absente et réapparait sans cesse. L’œuvre de Baselitz vit une vie d’œuvre avec ses contradictions et aussi ses certitudes : c’est une œuvre de dénonciation et de souffrance, expressionniste et romantique à la fois. Car, elle ne se conçoit qu’en tant que dénonciation, objective et pédagogique à ses débuts, hurlante et désespérée dans les dernières années. Dessinée au tout début de la création des œuvres, peinte à coup de couteaux et de couleurs virulentes dans une deuxième partie, quand les jaunes, les violets, les couleurs de la nuit et de l’ombre viennent donner formes au temps qui passe et à la mémoire qui revient imposer ses cauchemars et le spectacle de l’humanité, désespérée et trahie.
Les artistes allemands de la génération d’après-guerre, ceux aussi qui la suivent, parmi les artistes du monde entier, sont ceux qui ont eu le plus à dire et qui ont eu, davantage que les autres, le droit de dire quelque chose. Lorsqu’on vient d’un pays qui est devenu l’image du mal. Lorsqu’on est né dans un pays qui, dans ses accents, dans ses vêtements et dans ses passions est devenu le symbole du mal en action ; lorsqu’on est né après que le pays auquel on appartient a été reconnu coupable du pire, on est en droit de parler et de hurler la double horreur qu’il faut vivre, celle d’avoir été enfanté par un monstre et celle qui fait que le monde vous regarde comme un monstre.
Regardant un vieux film où « l’Allemand d’Après-Guerre », celui de la casquette nazie et des passementeries en forme de tête de mort, était déjà bien élaboré, écoutant l’accent « tudesque » d’un personnage Allemand rudoyer le français, marquant par-là que toute langue parlée avec un accent de salaud devient détestable, je cauchemardais ce que devait être une vie de jeune allemand prisonnier de sa langue. Le seul fait de parler allemand induisait qu’il était un coupable et un salaud. Il était finalement plus grave d’être un fils de salaud qu’un salaud tout court. Le salaud, savait peut-être pourquoi il s’était comporté en salaud ! Le fils de salaud, lui, restait là, salaud par la génétique, par immanence, naturellement salaud, sans avoir d’autre choix que de l’être, au surplus impuni et, pour le demeurer, plus scandaleux encore.
Comment peut-on être allemand ?
Je décrypte souvent l’art allemand de la seconde moitié du XXème siècle avec ces codes et ces cauchemars-là. Baselitz, Lûperz, Kiefer et les autres en sont les géants. Ils ont voulu crier ce qu’être Allemand après la Guerre, voulait dire ! Après l’horreur surtout, après l’effondrement de ce qu’il y a de beau et de fort dans la pensée, la culture et l’art allemands. Ils ne pouvaient pas le dire en peintures ni en sculptures aimables, ou charmantes ou belles. Petits formats à regarder à la loupe, peintures de paysages reposés ou, pourquoi pas, romantiques. Leurs œuvres devaient être des blessures encore ouvertes, leurs pensées, des os brisés, leurs regards, ceux qui sont jetés par des yeux arrachés. Ces œuvres venaient de tous ceux-là, les enfants de l’après-guerre, à qui on demandait sans cesse de témoigner des choses qu’ils n’avaient pas vues, d’assumer les évènements qu’ils n’avaient pas voulus et de taire toutes les plaintes venues de la trahison des valeurs et des forces d’une société qu’ils n’avaient pas connue.
L’exposition des sculptures de Baselitz au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris avait été, à cet égard, exemplaire. Par la qualité des œuvres d’abord, par l’importance que revêt ce pan considérable de son œuvre. Elles sont à l’endroit, les sculptures de Baselitz, à l’encontre de nombre de ses portraits. C’est une chose qui frappe lorsqu’on va et vient entre les statues, les têtes, les membres, depuis un bout de l’exposition vers l’autre. Le renversement des œuvres, leur retournement n’est plus ici nécessaire pour démontrer l’inversion du sens et la renonciation à dire les choses selon les codes habituels. Elles sont en bois pour le droit que cette matière laisse à l’homme de la violenter, de la frapper et de la déchiqueter sans qu’elle ne perde rien d’elle-même, quoi qu’il lui soit ôté, arraché, découpé. Bien au contraire ! plus que le marbre ou la pierre, le bois martyrisé retient les coups, les coupes, les déchirements à la scie, les arrachements des ciseaux, les défoncements au maillet. Il les rend plus forts : émotions, expressions, souffrances, apaisements.
On a évoqué l’art Africain. Baselitz en serait un collectionneur et un admirateur. Comme Picasso, n’est-ce pas ? et comme tant d’autres qui sont allés y retrouver les formes qu’ils pensaient avoir perdues depuis des temps immémoriaux ? Pourtant, je ne suis pas convaincu que l’art de Baselitz soit en quoi que ce soit à rapprocher de celui de quelque artisan africain. L’aspect massif, la taille gigantesque des statues, des visages, des membres rendent cette comparaison superflue. On devrait citer les Grecs et les Romains qui, suivant en cela Egyptiens et mésopotamiens, ont mis le gigantisme au service de l’expression artistique. Ce sont eux qui ont inventé que le « montrer en Grand » transcende la parole et permet d’interpeller les dieux.

Dans une sculpture se trouvent à la fois le dieu, l’orant et l’œuvre
« Dans le fond toutes ces sculptures sont empreintes d’une haute culture. Elles sont très loin de la forme naturelle, ce sont des inventions (Baselitz 1983) ».
Les « penseurs » (autoportraits) de Baselitz, assis, casquette vissée sur la tête et tête appuyée sur la main, sont-ils pensants ou les gardiens ambigus de quelques Persépolis contemporaines. Affalés penseurs, mâles aux chaussures à talon, affublés de grand chapeaux ou de chignons casquettes, les gardiens sont fatigués et se grattent la tête. Quand la dimension est surhumaine, le message est-il nécessairement celui des dieux et des idées universelles ? Le Gigantisme de ces formes en bois invoque-il, comme les grands Staline et les Mao gigantesques, l’éternité ou l’écrasement du présent ? La Sculpture « Meine neue Mûtze » (ma nouvelle casquette), en forme de garçonnet monstrueux de quatre mètres de haut, représente-t-elle, elle aussi, « un gardien » ? Baselitz démontre ici qu’un garçonnet gigantesque conserve toujours son statut de garçonnet à casquette et, ne peut raconter, autre chose que des histoires sans sens, sans queue ni tête, comme les statues colossales des héros totalitaires.
Par la taille gigantesque de ses statues, par le matériau utilisé, Baselitz renvoie à une statuaire d’invocation. Le colosse d’Alexandrie était un phare. Ce sont des phares pour l’humanité que l’Allemand installe et dont il subvertit le sens, des phares faits de gueules cassées, visages écrabouillés, mains dessinées à la scie électrique, pieds coupés à coups de hache. Monuments dédiés à l’humanité, gigantesques balises qui n’envoient pas un rai de lumière pour guider mais une lumière noire pour avertir. Au David de Michel Ange qui nous parlait d’un homme à l’égal des dieux, Baselitz répond par des formes à l’image du néant.
Au beau milieu du parcours de l’exposition, sont posées, en groupe compact et fort, les « femmes de Dresde ». Si le gigantisme des sculptures renvoie aux phares, les têtes, gigantesques de ces femmes, mais pourtant à notre mesure, renvoie à cette idée de balises disposées sur le chemin de vie que nous empruntons. Sublime jaune violent, dont on nous dit qu’il est là posé sur les sculptures pour en atténuer les violences… Quelle étrange idée que de conférer à un jaune strident, la vertu de l’apaisement ! Au contraire, effaçant fausses ombres, couleurs des veines du bois ou, tout simplement, effets de matières après le passage du ciseau et de la scie, cette couleur jaune renvoie à l’expressionisme allemand. Elle est ici posée comme un haut-parleur devant des bouches hurlantes, devant ces têtes en creux et bosses, en faces défoncées, déchirées, renvoyées à l’inhumanité. Hurlements figés, pleurs vaporisés, les visages de ces femmes ne peuvent plus rien dire. Les « Femmes de Dresde » sont-elles les restes de corps jetés dans la fournaise du pire des bombardements ? Sont-elles des monuments à voir ou le dire d’un vide ? Néant massif succédant à la vaporisation des corps qui oppose sa pesanteur pour dire plus fort qu’il n’y a plus rien, ni la beauté, ni la laideur...
Les formes sont déformées. Le sourire de « la rieuse Carla » est figé dans ce jaune, couleur de souffre avant incendie. Leurs Orbites creuses regardent sans paix et nous envoient des regards sans yeux. Sous leur poids et leur intensité peut-on être spectateur ? Mon regard s’abaisse. Contempler l’innommable ? Pourtant, il me vient ce sentiment que l’humanité de la « rieuse, Carla », parvient à s’imposer, malgré l’incendie et les cendres, par la magie du bois et des coups de hache.
"J’ai toujours suivi une idée qui se termine autrement." (Baselitz)

Une gigantesque galerie pour des œuvres gigantesques
Je ne sais pas trop bien ce qui était admirable dans cette exposition. La galerie ou l’artiste. On peut commencer par l’inhabituel : la Galerie ! Pas le galeriste dont, classiquement, on chanterait les mérites, raconterait ses hauts faits et gestes et dont on dirait que, parti de rien, il est devenu ce grand marchand parmi les grands marchands qui font le marché. A la Galerie Thaddaeus Ropac envahie de poupées gigantesques et noires.
En fait, si on devait parler de lui, à cet instant, ce serait surtout pour la galerie qu’il a eu le culot d’installer dans un coin bien reculé de la proche banlieue parisienne, Pantin ! Remarquez, il aurait pu aller encore plus loin. Certains de ses confrères sont allés jusqu’au Bourget ! Mais, Pantin, à un peu plus de 500 mètres de toute station de métro, c’est déjà audacieux. Premier coup de chapeau à la galerie, elle est loin de toute présence artistique. Pas d’autres galeries audacieuses dans les environs. L’audace n’est pas le fait des foules mais de quelques illuminés. Cette galerie en est la preuve.
Le lieu aussi est un coup d’audace ! deuxième coup de chapeau : ce doit être une ancienne usine ou des ateliers de montage ou n’importe quoi d’industriel et qui nécessitait d’impressionnantes hauteurs « sous ferme ». Le résultat entre les mains d’un galeriste audacieux est un espace gigantesque et totalement blanc. Si blanc que, parfois, le fameux malaise des montagnes vous saisit et vous fait vaciller, équilibre fragilisé, malaise du « temps blanc » quand on ne sait plus où est le bas, où est le haut, où est la pente. A quelques centimètres, menace un précipice mais aussi tout peut être plat sur des centaines de mètres ! La galerie est éclairée de telle sorte que les ombres ont été supprimées et avec elle l’inscription des choses dans l’espace et peut-être même le mouvement !
Exceptionnelle galerie située dans un cadre totalement improbable, ailleurs, à l’écart de tout mouvement artistique et pourtant écrin gigantesque pour des œuvres imposantes.
Ecrin gigantesque ? Œuvres imposantes ? L’artiste exposé est bien dans le contexte de ce lieu et ses œuvres trouvent leur place comme naturellement.

Soleil noir ou dark side ?
Georg Baselitz offre à voir, dans un univers totalement, parfaitement blanc, tout un pan de sa nouvelle production sous le titre « Le côté sombre ». On l’a dit, il n’y a pas d’ombre dans la galerie, le lieu est immaculé et si blanc qu’il en paraît intemporel. « Côté sombre ? ». « Dark Side » of the force ? Les Statues sont noires ou pratiquement, les tableaux sont d’un bleu si sombre qu’il en parait noir. Dans cet univers si parfaitement blanc. Soleil noir, Baselitz est-il devenu Mélancolique ? L’Etoile Noire pèse-t-elle de toutes ses menaces maléfiques ?
J’avais donné une chronique sur les œuvres sculptées de Baselitz. Et surtout sur cet ensemble exceptionnel, les femmes de Dresde. Baselitz avait en effet, il y a quelques temps, exposé au MAMVP (musées d’art moderne de la ville de Paris, un ensemble considérable de statues en bois, et en bronze, peintes et toutes d’une taille considérable, trois, quatre, cinq mètres de haut. Massives, lourdes, pesantes. Ici ces statues extraites du bois à coup de tronçonneuse et de hache ont été converties en bronze, noirci par l’artiste. Ces statues énormes, noires, se détachant sur le blanc absolu de la galerie, sont-elles le « côté sombre ». Les titres des œuvres font très « guignol Band », très hourloupéen. Yellow song, BDM Gruppe et contrastent totalement avec la puissance, sombre, maléfique, noire, lourde du bronze dont elles sont faites et des coups de hache qui les ont extraites du bois, au début de leur création.
Posées lourdes, sur le sol blanc, obligeant, par leur taille le regardeur à élever au plus haut possible son regard, elles symbolisent des forces, des présences irrésistibles et des masses incontournables. La disposition des statues est–elle le fruit du hasard ou exprime-t-elle la volonté de l’artiste d’associer les œuvres deux à deux ? Le résultat est là : un couple, homme botté à casquette, femme perchée sur de hauts talons constituent-ils un tout dominant et autoritaire posé en regard de cette statue à taille plus modeste installée à l’opposé où on devine un personnage enserré dans une succession d’anneaux comme dans une succession de chaines, menottes et entraves.

Quand la grâce se fait pesante
A ce couple de statues étranges répond, une salle plus loin, d’autres statues tout aussi monumentales : les trois grâces, sûrement, sont là, esquissant un puissant mouvement de danse, sourire tracé d’un coup de serpe comme une blessure du bois, droite, comme une simple fente sur la face. A l’opposé de ce groupe, enserrée d’anneaux massifs, une danseuse entamerait un mouvement de ballerine où se lirait la difficulté de se mouvoir et de s’extraire d’une matière sombre et puissante.
Au centre de l’espace d’exposition de la galerie, les peintures. Une nouvelle série de peintures : A nouveau le « côté sombre ». Plus rien n’est vide dans ces tableaux de très grand format. Les toiles, sont totalement emplies de couleurs : noir, bleu couleur de nuit, violet sombre des aubes vénéneuses. Peintures qui appellent le regardeur à bien regarder. A chercher dans l’obscurité l’histoire qui se déroule ou la fuite de toutes les histoires. Baselitz n’a pas cessé de représenter l’envers des choses en les représentant tête en bas. L’inversion continue sans qu’on soit vraiment sûr du déroulement de l’évènement. La disparition de la lumière ôte au regard ses derniers repères. La chute, s’il y a chute, se confond avec les grandes ailes des vautours qui rôdent autour de nous.
Baselitz offre-t-il au regard le combat nocturne de quelques animaux nyctalopes ou à la tombée de la nuit l’improbable duel des chauves-souris et des charognards ? Raconte-t-il à nouveau, dans des termes encore plus tragiques, l’histoire de toutes les chutes humaines et divines, celle de Prométhée, celle des hommes, chute aussi des anges malfaisants dans un déploiement d’ailes noires que la nuit obscure rend à peine discernables. Niemandsland, Dunkel age schwarzim…
Exposition tout en un contraste étrange entre la blancheur de l’espace qui engloutit toute différence, toute dimension et qui, pourtant, porte et magnifie les taches noires des œuvres réunies sous un titre difficile « Côté sombre » !
Comprendre le Métavers en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau