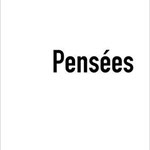Les tribulations de Mélinez et de Martenchon, février- mars 2021
Covid Et si on laissait faire,laissait passer ?
Covid : C’est le tour des jeunes !
Sie Fahren !!!
La furia francese
Covid Et si on laissait faire,laissait passer ?
Nos deux amis étaient perplexes : le covid qui
livre à l’espèce humaine un combat sans merci, est-il invincible ? Les gouvernements peuvent-ils sans cesse rassembler leurs citoyens pour livrer un combat perdu d’avance ? Ne
risquent-ils pas de déclencher des lassitudes suicidaires ? En 1917, on a vu qu’au bout d’un certain temps, les meilleures énergies s’épuisaient : le combattant le plus vaillant
déraillait et mettait des fleurs dans son fusil.
Se battre disent les citoyens ? Oui, certes, mais pourquoi à la fin ? C’est que le covid égare les esprits après avoir supprimé quelques sens essentiels. Il fait perdre le goût et
l’odorat ? Qui dit qu’il ne fait pas perdre d’autres choses tout aussi importantes : le sens de l’orientation, l’idée que les Anglais sont nos ennemis héréditaires et même la ligne
d’horizon, ruinant par sa disparition, la recherche des futurs qui seront meilleurs (« le bonheur est à l’horizon »).
Donc, tous repères perdus et lassés de se battre, les peuples s’exclameraient comme le poète « tant pis, je m’en fous » et, renonçant à la lutte, laisseraient la place au covid.
Nos amis Mélinez et Martenchon savent depuis longtemps que tout est affaire de perspective. Réfléchissant aux avantages et aux inconvénients de cette défection de l’esprit de lutte, il leur est
venu des idées non-orthodoxes : n’ayant plus d’adversaires, le covid n’aurait plus à se mesurer à la volonté d’éradication forcenée des gouvernants. Il en perdrait le besoin de muter
pour acquérir davantage d’agressivité et enfoncer les barrières, les vaccins et toutes ces choses que l’humanité prétend lui opposer. Le covid se croirait à Capoue. N’ayant plus d’effort à faire
pour profiter au mieux de l’aubaine d’une humanité devenue poussive et aboulique, il se mettrait à ronronner et à prendre son temps pour se diffuser. Il deviendrait paresseux sans se rendre
compte que d’autres virus l’attendent au tournant. Celui de la grippe par exemple qui est fou de rage qu’on lui ait pris la place et qu’on ne parle plus de lui.
Les virus en viendraient aux mains (c’est une image) et, détournant de l’homme leur létalité, l’oublieraient. Mieux encore le covid devenu gras ne saurait pas se défendre et serait défait.
Tout redeviendrait comme avant avec les bons vieux virus qui traînent depuis des milliers d’années.
Sie Fahren !!! (Exact opposé du célèbre "Sie kommen!")
Mélinez n’avait pas eu besoin de se rendre à la Gare Montparnasse, il
lui avait suffi d’entendre au milieu de tous les bruits de la ville, ce bruit de roulement caractéristique des valises un peu lourdes qui pèsent sur des roulettes trop petites et tressautent au
moindre obstacle. Il avait su qu’ils partaient. Pas tous, mais un bon nombre certainement.
Il se retourna vers son ami Martenchon qui, pour tromper l’ennui d’une journée pluvieuse, s’acharnait en origamis de toutes sortes :
« Ils partent ! » dit-il, doucement.
« Ils font du bruit, ce n’est pas comme avant » remarqua Martenchon tout en pliant avec acharnement des bouts de papier de toutes les couleurs.
« Comme avant ? » interrogea Mélinez.
« Eh oui! avant, ils n’avaient pas de valises à
roulettes. Des charrettes pour certains ; des landaus ; ou des baudets ; et une ou deux voitures brinquebalantes et teufteufantes. Tout ceci peu bruyant, des sons assourdis, des
bruits d’efforts physiques, les mères qui portent leurs enfants, les pères, des valises fermées avec des ficelles, les enfants quelques sacs à dos pleins de
vêtements ».
Martenchon, se tut, souriant dans le vague au souvenir de ces années
d’autrefois quand le monde était plus simple et s’abstenait de pétarader à tous vents.
« L’exode, en ce temps-là, ne ressemblait pas à une virée en Week-end dans des TGV de première classe ou en classe éco d’Air France »
continua Martenchon. « Et pourtant, on fuyait le même genre de danger »
Mélinez interrompit son ami, choqué par ses propos
cyniques :
« Tu ne veux quand même pas dire que tu ne fais pas la différence entre un Allemand et un virus… »
« Différence, différence » marmonna son ami, « Le résultat est le même : les Français s’en vont précipitamment hors de chez eux ! »
Covid : C’est le tour des jeunes !
C’est peu dire que Martenchon avait aujourd’hui une
vilaine tête. On y lisait comme si un très grave souci avait creusé son visage de rides plus profondes que d’habitude. Pire, il se servit un plein verre de whisky contrairement à ses frugales et
tempérantes rasades usuelles.
« Mélinez, il faut que je te dise que l’heure est grave : L’âge moyen des hospitalisés, et donc des décédés du covid décroit. Ils
entrent de plus en plus souvent dans la fleur de l’âge et non plus dans le crépuscule de leurs vies. Il y a là une statistique terrorisante. Que conclure de cette tendance tout à l’inverse de ce
qu’on relevait depuis un an quand la mort fauchait les plus vieux et épargnait les plus jeunes ? »
Il continua sur ce registre lugubre. « Où sont-ils donc passés, ces ancêtres auprès desquels des dizaines de soignants se pressaient au risque eux-mêmes de contracter le virus ? Ont-ils
disparu, tous mortellement atteints ? Une génération aurait été avalée par le monstrueux covid? »
Martenchon décida de se porter au secours de son ami : « le
vaccin, Mélinez ! Le vaccin ! Y as-tu pensé ? Finalement, le miracle tant attendu se produit. Ils sont covid-résistants nos vieux. Ils sont tous touchés mais ils n’en meurent
pas tous. Et ils peuvent, après quelques soins, rentrer dans leurs ephad et embrassouiller leurs petites familles ».
Mélinez ne se déridait pourtant pas. « Tu ne dis pas le pire. Tu te
contentes d’être content de quelques signaux verdoyants. Nos ainés sont protégés, eux ! Mais les autres. On s’est précipité au secours des plus faibles. On n’a pas vu que les virus (ne
devrait-on pas dire « les viri »?) sont de fins stratèges. Avec les vieux, c’était une façon de s’entraîner. Ils sont aguerris. Ils s’en prennent maintenant aux plus
jeunes.
Martenchon souriait maintenant : « Eh bien, la voilà
l’explication ! Tu n’as plus de soucis à te faire : tes statistiques ne t’ont pas trompé. Maintenant que les vieux ne sont plus des proies disponibles en quantités et qualités
suffisantes, c’est au tour des jeunes. Donc, comme tu l’observais : ils arrivent en masse et remplacent leurs ainés. Les hôpitaux ne risqueront aucune rupture de charges, si
néfastes à la régularité des prestations.
"Et, by the way, de cet effet, « l’arrivée des jeunes » on a trouvé la cause, "le déclin des vieux ! "
La furia francese
Mélinez fut pris d’une crise de lyrisme et ouvrit son
cœur :
« Quelques pays s’honorent de grands moments d’héroïsme et c’est bien ; c’est bien pour l’estime d’eux-mêmes qu’ils en tirent, c’est bien pour l’exemple qu’ils donnent au monde,
qui, en l’état actuel, en a bien besoin ».
Martenchon ( laconique): « Certes ! »
Et Mélinez de continuer sur ce même registre:
« Je ne peux pas ne pas frémir d’admiration au spectacle, sans cesse renouvelé grâce aux prises vidéo qui l’ont immortalisé, de cet homme chinois, qui, planté devant le premier char d’une
colonne, l’obligea à interrompre sa marche, creusant ainsi une mince fissure dans un mur politique qu’on croyait sans défaut.
Martenchon: « Indéniablement »
Mélinez (encore plus lyrique):
« Chaque fois que je vois cette séquence, un bravo subliminal éclate en moi.
Et aussi, cet homme, infirmier de l’armée américaine, qui s’oppose héroïquement à la violence japonaise, et, au risque de sa vie, sauve nombre de blessés.
Et Léonidas ! Bien sûr, il n’était pas seul, mais sans lui, aurait-on pu écrire « passant va dire à Sparte… »
Martenchon, (spartophile de toujours) : « J’applaudis à ces
propos »
Mélinez, sur un ton cette fois-ci méditatif :
« Un seul être, à certains moments critiques, n’a pas manqué et l’Humanité en a été honorée.
Et en France ? Avons-nous de ces héros solitaires qui savent tancer les dangers, menacer les puissances hostiles et repousser les malheurs, avec leurs mains nus ou une épée et
leur courage en bandoulière »
Martenchon (intéressé) : « en effet, en avons-nous ? ».
Mélinez (redevenu enthousiaste):
« Oui ! En ce temps de Covid, nous avons vu de ces hommes et femmes courageux.
Ils se sont fermement opposés à l’arrivée de certains vaccins.
Repoussant le repoussant vaccin, ils ont empêché que mort et désolation s’ensuivent. Ils clamaient: "plutôt mourir sous les coups de la nature que sous les erreurs de la science".
Courageusement, ils ont su faire prendre des risques énormes à leurs concitoyens.
Le petit chinois devant les chars a trouvé ses challengers, durement installés au fond de leurs canapés devant la télé, ils lèvent le poing et crient : le vaccin ne passera
pas ! »
Comprendre les Non Fungible Tokens (NFT) en 20 questions

Il vous suffira de tendre la main, vers les librairies du net,
Babelio, Amazon, Fnac, books.google, BOD librairie et l'éditeur: Arnaud Franel Editions
Quelques ouvrages de Pascal Ordonneau
Panthéon au Carré est disponible aux éditions de la Route de la Soie.
Promotion est disponible chez Numeriklivre et dans toutes les librairies "digitales"
Au Pays de l'Eau et des Dieux est disponible chez Jacques Flament Editeur ainsi que
La Désillusion, le retour de l'Empire allemand, le Bunker et "Survivre dans un monde de Cons".
"La bataille mondiale des matières premières", "le crédit à moyen et long terme" et "Les multinationales contre les Etats" sont épuisés.
En collaboration: Institut de l'Iconomie
S'inscrire
chaque semaine "La" newsletter (tous les lundis)
et "Humeur" (tous les jeudis)
Il vous suffit de transmettre vos coordonnées "Mel" à l'adresse suivante
pordonneau@gmail.com
 Pascal Ordonneau
Pascal Ordonneau